UIT télécommunications en cas de catastrophe Manuel utilisateur
Vous trouverez ci-dessous de brèves informations sur les Manuel de télécommunications en cas de catastrophe. Le manuel couvre la planification et l'utilisation des communications dans des conditions de catastrophe, les services de télécommunications utiles et un cadre pour l'analyse des forces et des faiblesses en matière de communications. Il met également l'accent sur la nécessité d'un cadre international pour la mise à disposition de ressources de télécommunication.
*19155* Imprimé en Suisse Genève, 2001 ISBN 92-61-009272-1 Sans titre-1 2 28.05.2001, 09:02 LES COMMISSIONS D'ÉTUDES DE L'UIT-D Les Commissions d'études de l'UIT-D ont été créées aux termes de la Résolution 2 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) organisée à Buenos Aires, Argentine, en 1994. Pour la période 1998-2002, la Commission d'études 1 est chargée d'examiner onze Questions dans le domaine des stratégies et politiques de développement des télécommunications. La Commission d'études 2 est, elle, chargée d'étudier sept Questions dans le domaine du développement et de la gestion des services et réseaux de télécommunication. Au cours de cette période, pour permettre de répondre dans les meilleurs délais aux préoccupations des pays en développement, les résultats des études menées à bien au titre de chacune de ces deux Questions sont publiés au fur et à mesure au lieu d'être approuvés par la CMDT. Pour tout renseignement Veuillez contacter: Mme Fidélia AKPO Bureau de Développement des Télécommunications (BDT) UIT Place des Nations CH-1211 GENÈVE 20 Suisse Téléphone: +41 22 730 5439 Fax: +41 22 730 5884 E-mail: [email protected] Pour commander les publications de l'UIT Les commandes ne sont pas acceptées par téléphone. Veuillez les envoyer par téléfax ou par e-mail. UIT Service des ventes Place des Nations CH-1211 GENÈVE 20 Suisse Téléphone: +41 22 730 6141 anglais Téléphone: +41 22 730 6142 français Téléphone: +41 22 730 6143 espagnol Fax: +41 22 730 5194 Télex: 421 000 uit ch Télégramme: ITU GENEVE E-mail: [email protected] La Librairie électronique de l'UIT: www.itu.int/publications Ó UIT 2001 Tous droits de reproduction réservés. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l’accord écrit de l’UIT. Rapport sur la Question 16/2 iii PRÉFACE La première édition du Manuel sur les télécommunications en cas de catastrophe, tel qu'il a été adopté par la Commission d'études 2 de l'UIT-D pour les pays en développement, est une publication de l'UIT-D divisée en trois parties pour faciliter la consultation par le lecteur. La Partie 1 fournit des renseignements d'ordre général aux décideurs qui exercent des responsabilités dans la planification des télécommunications en cas de catastrophe. La Partie 2 s'adresse à ceux qui ont un rôle opérationnel à jouer, alors que la Partie 3 est une annexe technique contenant notamment des graphiques utiles ainsi que d'autres informations importantes. Le texte du Manuel a été élaboré pour l'UIT par une équipe internationale d'experts recrutés essentiellement par le biais du Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence (WGET) de l'Organisation des Nations Unies. Le secrétariat de ce groupe, qui est assuré par le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, a permis d'organiser les travaux. Il convient en particulier de les remercier ainsi que deux autres groupes, L.M. Ericsson qui a offert une contribution financière généreuse aux travaux et l'Union internationale des radioamateurs (IARU), à l'origine de la proposition initiale, qui a en outre donné l'impulsion requise du projet. Le Bureau de développement des télécommunications remercie toutes les administrations qui ont participé et contribué à cette publication. Hamadoun I. Touré Directeur Bureau de développement des télécommunications Union internationale des télécommunications Rapport sur la Question 16/2 1 Manuel sur les télécommunications en cas de catastrophe PARTIE 1 Table des matières Page CHAPITRE 1 – Télécommunications dans le cadre de l'assistance humanitaire 1.1 Introduction ......................................................................................................................... 3 1.2 Objet du présent Manuel ..................................................................................................... 4 1.3 Nécessité d'un Manuel......................................................................................................... 4 1.4 Qui doit lire ce Manuel........................................................................................................ 4 CHAPITRE 2 – Cadre organisationnel et réglementaire des communications en cas de catastrophe 2.1 Atténuation des effets des catastrophes: prévention et état de préparation ......................... 5 2.2 Réactions aux catastrophes.................................................................................................. 5 2.3 Niveaux des réactions aux catastrophes .............................................................................. 5 2.4 Télécommunications dans la réaction aux catastrophes ...................................................... 2.4.1 Les réseaux publics existants .................................................................................. 2.4.2 Réseaux spécialisés existants .................................................................................. 2.4.3 Le service de radioamateurs.................................................................................... 2.4.4 Eléments indispensables supplémentaires en matière de télécommunications en cas de catastrophe à genèse soudaine ................................................................. 5 6 6 6 6 CHAPITRE 3 – Cadre international de réglementation 3.1 Cadre international de réglementation des communications en cas de catastrophe ............ 7 3.2 La Convention de Tampere ................................................................................................. 3.2.1 Contenu de la Convention de Tampere................................................................... 3.2.2 Directives pour la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion................................................................................................................. 3.2.3 Les implications principales pour les signataires.................................................... 8 8 9 10 CHAPITRE 4 – Le rôle des organisations internationales dans les communications en cas de catastrophe 4.1 L'Union internationale des télécommunications (UIT) ....................................................... 11 4.2 Autres organisations et institutions internationales............................................................. 4.2.1 Entités des Nations Unies ....................................................................................... 4.2.2 Organisations non gouvernementales (ONG) internationales................................. 4.2.3 Institutions gouvernementales assurant l'assistance internationale......................... 4.2.4 Le Comité international de la Croix Rouge (CICR) ............................................... 4.2.5 Organisations régionales ......................................................................................... 11 11 12 12 12 13 2 Rapport sur la Question 16/2 Page CHAPITRE 5 – Cadres nationaux 5.1 Structures nationales de gestion des opérations en cas de catastrophe................................ 14 5.2 Cadre national de réglementation en matière de communications en cas de catastrophe.... 14 5.3 Développement du concept national de communications en cas de catastrophe................. 15 5.3.1 5.4 Concept global d'un examen et d'un plan national de communications en cas de catastrophe............................................................................................................... 15 Méthodes et portée d'une étude ........................................................................................... 15 5.4.1 Considérations de confidentialité ............................................................................ 15 5.4.2 Opérateurs des télécommunications........................................................................ 16 5.4.3 Résultats .................................................................................................................. 16 5.4.4 Capacité du réseau................................................................................................... 16 5.4.5 Vulnérabilités supplémentaires ............................................................................... 17 5.4.6 Rétablissement ........................................................................................................ 17 Application du plan ............................................................................................................. 17 Bibliographie ................................................................................................................................. 17 ANNEXE 1 – Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe.......................................................................... 18 ANNEXE 2 – Résolution 7 – Communications en cas de catastrophe ....................................... 32 ANNEXE 3 – Résolution 19 – Ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe............ 35 ANNEXE 4 – Résolution 644 (CMR-97) – Moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours ...................................... 37 ANNEXE 5 – Résolution 36 (Rév. Minneapolis, 1998) – Les télécommunications au service de l'aide humanitaire ............................................................................................ 39 ANNEXE 6 – Résolution adoptée par l'Assemblée Générale – 54/233. Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles: de la phase des secours à celle de l'aide au développement................................. 41 5.5 Rapport sur la Question 16/2 3 PARTIE 1 CHAPITRE 1 Télécommunications dans le cadre de l'assistance humanitaire Rapport sur la Question 16/2 1.1 Introduction Il a fallu 38 années à la radio pour atteindre 50 millions de personnes, 13 ans à la télévision et bien moins à l'Internet. La technologie et les applications des télécommunications progressent à une vitesse toujours de plus en plus rapide. Toutefois, il en va de même avec le fossé, le «fossé numérique» qui existe dans le monde: il y a autant de téléphones à Tokyo que dans toute l'Afrique et il y a autant d'ordinateurs aux Etats-Unis d'Amérique que dans tout le reste du monde. Afin de combler ce fossé, de nouvelles visions et de nouveaux concepts ont été imaginés par la communauté internationale ainsi que par le secteur privé. La reconnaissance de l'importance de la technologie, affirmée dans le rapport du Secrétaire général des Nations Unies présenté à la cinquante quatrième session de l'Assemblée générale, et les initiatives provenant d'entités commerciales dans leurs programmes d'entreprises citoyennes illustrent la prise de conscience de la nécessité de combler le fossé. Dans leur rapport aux Nations Unies, les experts ont exprimé l'espoir que «vers la fin de l'an 2004, un paysan de l'Afrique saharienne devrait pouvoir atteindre un point d'accès, après environ une demi-journée de marche ou sur un char à bœufs». Ces experts ont toutefois admis que d'autres formes d'aide – relatives à la nourriture ou à la santé, par exemple – devraient être prioritaires. Encore une fois, les statistiques confirment cet avertissement. Selon l'Organisation internationale du travail, un quart des six milliards de personnes de la population mondiale vit avec un revenu inférieur à un dollar par jour. Même dans le pays ayant la plus forte densité de téléphones du monde, à savoir la Finlande, il y avait, en 1999, seulement 107 ordinateurs connectés à l'Internet pour 1 000 habitants – ce qui est aussi le taux le plus élevé au monde. Les visions technologiques deviennent réalité presque aussi vite que nous en prenons connaissance mais le développement global va à sa propre cadence. Il est donc essentiel de donner la priorité aux besoins les plus urgents. Pour les télécommunications, ces besoins dépendent du rôle des communications dans notre vie quotidienne et de notre environnement socioculturel. Pour les missions humanitaires, en ce qui concerne la prévention des catastrophes, l'état de préparation et la réaction aux catastrophes en particulier, la différence de type et de quantité de ces besoins est aussi profonde que le «fossé numérique». D'ordinaire, les communications en cas de catastrophe étaient centrées dans la fourniture d'information depuis, vers et dans le site-même du sinistre, principalement pour les besoins des prestataires d'assistance. Ce n'est que récemment, lors de tragédies survenues dans des pays où la disponibilité permanente des liaisons locales et mondiales était considérée comme acquise, que l'accès aux télécommunications a été reconnu comme un produit arrivant juste après la nourriture, le couvert et les services médicaux. La connaissance par sa seule existence ne suffit pas en soi – il est nécessaire de la rendre disponible à travers la formation et d'encourager son application au lieu de la restreindre. Il convient de fournir cette formation non seulement à ceux qui développent et mettent en œuvre des technologies et des applications appropriées mais également aux usagers, afin de leur permettre d'utiliser au mieux ce qui est disponible. Les limitations comprennent des restrictions réglementaires basées sur la seule paranoïa: depuis que les 4 Rapport sur la Question 16/2 communications existent, la peur qu'elles puissent nuire si elles ne sont pas contrôlées ou si elles sont entre de mauvaises mains a déclenché des réglementations restrictives. Des progrès ont été réalisés tant dans le champ de la formation que dans celui de la réglementation. Si le présent manuel, limité qu'il est aux applications humanitaires des télécommunications, contribue à des développements supplémentaires dans ces deux aspects, il sera un outil de valeur placé dans les mains de ceux qui, directement ou indirectement, sont au service du plus noble des buts: La prévention et, lorsque ce n'est pas possible, l'atténuation de la souffrance humaine en cas de catastrophe. 1.2 Objet du présent Manuel La présente publication essaye de combiner suffisamment d'informations relatives aux communications en cas de catastrophe afin de permettre au lecteur d'évaluer, de planifier et d'utiliser les communications dans les conditions extraordinaires qui accompagnent souvent les catastrophes tant naturelles que dues à l’homme et leurs conséquences sur les communications. Elle est conçue pour présenter un aperçu général du champ des communications en cas de catastrophe, en décrivant les divers services et réseaux de télécommunications qui peuvent être utiles au planificateur tout en fournissant dans le même temps un cadre pour l'analyse des points forts et des points faibles. 1.3 Nécessité d'un Manuel Les télécommunications se situent dans une période où se produisent un certain nombre des changements les plus rapides que l'on puisse imaginer en matière de réglementations, de technologie et d'accès. Ces nombreux changements soulèvent la question de savoir quelle est l'application la plus efficace possible des ressources des télécommunications à l'assistance humanitaire et à l'atténuation des effets des catastrophes. Les réseaux de télécommunications deviennent de plus en plus complexes et difficiles à comprendre complètement, même pour les experts. Le présent Manuel fournit au planificateur de communications en cas de catastrophe, tout autant qu'à l'opérateur radio sur le terrain, les connaissances pour étudier efficacement les éléments indispensables aux communications en cas de catastrophe, et pour faire le meilleur usage des réseaux spéciaux existants qui viennent à l'appui des efforts de secours. 1.4 Qui doit lire ce Manuel Il convient que le Manuel sur les communications en cas de catastrophe soit lu, étudié et compris par toute personne dont les responsabilités sont liées à la planification, l'utilisation, l'évaluation ou l'enquête sur les systèmes de communications en cas de catastrophe ou sur leurs vulnérabilités. Il s'agit d'un projet du Secteur de développement des télécommunications de l'Union internationale des télécommunications (ITU-D). L'idée du Manuel émane de la Commission d'études 2 de l'ITU-D et constitue un effort d'un certain nombre de participants représentant diverses entreprises gouvernementales, ONG et entreprises privées. Le Manuel a été rédigé par des partenaires de l'assistance humanitaire, en tant qu'aide à la diffusion élargie des connaissances sur le sujet des communications en cas de catastrophe. On peut le lire comme un texte autonome ou l'utiliser en association avec des opportunités de formation formelle sur le terrain. Rapport sur la Question 16/2 5 CHAPITRE 2 Cadre organisationnel et réglementaire des communications en cas de catastrophe 2.1 Atténuation des effets des catastrophes: prévention et état de préparation La prévention des catastrophes vaut mieux qu'une réaction aux catastrophes; toutefois, les meilleures mesures de prévention ne peuvent pas remplacer l'état de préparation aux catastrophes et, malgré tout, le plus haut niveau de préparation ne couvrira jamais tous les aspects liés à la réaction aux catastrophes. Il est nécessaire que les communications en cas de catastrophe se concentrent à la phase de réaction mais leur efficacité dépend de l'état de préparation. 2.2 Réaction aux catastrophes Les catastrophes sont généralement classées soit catastrophes naturelles et en catastrophes dues à l’homme. Pour les opérations de secours aux sinistrés, il est plus pratique d'adopter une classification en catastrophes à genèse soudaine et en états d'urgence complexes, car c'est moins la cause de la catastrophe que l'enchaînement des événements qui dicte la réaction à lui apporter: le déclenchement d'une guerre civile (Exemple: Rwanda 1994) peut être aussi soudain qu'une éruption volcanique et il en va de même pour la plupart des catastrophes technologiques ou industrielles (Chernobyl 1986). Par contre, une sécheresse se développe lentement dans la plupart des cas et ses conséquences peuvent être fortement complexes (déplacement de populations, troubles civils). Pour les communications en cas de catastrophe, les catastrophes à genèse soudaine constituent une préoccupation majeure, car elles créent des besoins très spécifiques. Les éléments généraux indispensables aux communications en cas d'urgences complexes à long terme sont souvent similaires à ceux des pays en développement en général. 2.3 Niveaux des réactions aux catastrophes La réaction locale constitue, pour des raisons de temps et d'emplacement, le premier élément des opérations de secours dans pratiquement tous les cas. Nulle assistance nationale ou internationale ne peut remplacer la réaction des services d'urgence locaux. Les autorités nationales ont la responsabilité globale principale de l'atténuation des effets des catastrophes, de l'état de préparation aux catastrophes et de la prévention des catastrophes, ainsi que de la réaction apportée. A chaque fois que les ressources locales sont insuffisantes, l'intervention au niveau national est nécessaire. L'assistance internationale n'est mobilisée que dans les cas où ce deuxième niveau n'a pas la capacité de réaction nécessaire pour faire face à la situation. Alors que les communications en cas d'urgence au niveau local et national peuvent poser d'énormes problèmes, la nécessité des systèmes de communications par satellite est plus évidente dans ce troisième niveau. 2.4 Télécommunications dans la réaction aux catastrophes Les catastrophes ont généralement des implications multiples simultanées sur l'offre et la demande de télécommunications car elles créent des besoins temporaires supplémentaires à un moment de disponibilité réduite et de surcharge des réseaux permanents. Pour les responsables de la fourniture des télécommunications, cela signifie qu’ils doivent faire un meilleur usage de ce qui reste disponible tout en constituant dans le même temps une capacité supplémentaire. 6 Rapport sur la Question 16/2 2.4.1 Les réseaux publics existants Dans la mesure où des réseaux publics existent et survivent à l'impact d'une catastrophe, ils sont utilisés dans les opérations de secours. L'utilisation fréquente de la haute technologie, en particulier celle des communications par satellite dans les liaisons internationales, a augmenté la vulnérabilité des réseaux publics. Leurs structures hautement centralisées peuvent aboutir à une interruption totale des communications avec «le monde extérieur» si un élément vital (par exemple: l'antenne de la probablement unique station terrienne de télécommunication par satellite d'un pays) est endommagé. Cela s'est réellement produit dans les îles Maurice et Rodriguès, dans l'Océan Indien, pendant le cyclone «Hollanda» en février 1994, et l'isolement résultant peut manifestement avoir des conséquences dramatiques, s'il fallait recourir à l'assistance internationale. La vulnérabilité des réseaux domestiques a augmenté de façon similaire: le nombre croissant d'abonnés aboutit, en cas de dégâts étendus causés à un réseau, à un nombre élevé de dérangements dont chacun augmente vraisemblablement les délais de rétablissement des communications, même avec des établissements vitaux tels que les hôpitaux. 2.4.2 Réseaux spécialisés existants Les services d'urgence, au niveau local et national, disposent dans la plupart des cas de leurs propres réseaux permanents. S'ils sont bien entretenus, ces réseaux ont tendance à être moins vulnérables que les systèmes publics mais leur utilité est souvent limitée par un manque de compatibilité entre les spécifications techniques des équipements utilisés dans des services différents. Ce problème spécifique est fortement aggravé dans les cas où l'assistance internationale est assurée par des services étrangers, tels que des équipes de recherche et de sauvetage qui arrivent avec leur propre support de communications, généralement incompatibles entre eux ainsi qu'avec les réseaux du lieu sinistré. 2.4.3 Le service de radioamateurs Le service de radioamateurs joue un double rôle en tant que réseau permanent spécialisé et aussi en tant que fournisseur d'opérateurs et de personnel de ressources techniques ayant les compétences et l'expérience de la meilleure utilisation des moyens disponibles. Les communications en cas de catastrophe ont beaucoup de points communs avec les radioamateurs en ce qui concerne les procédures opérationnelles et les conditions techniques. Par conséquent, l'annexe technique du présent Manuel est largement basée sur le travail fourni par la communauté internationale des radioamateurs. 2.4.4 Eléments indispensables supplémentaires en matière de télécommunications en cas de catastrophe à genèse soudaine Aux fins de coordination, les liaisons entre les trois niveaux (local, national et international) et au sein de ceux-ci sont vitales. Il est nécessaire que le type et la structure des réseaux correspondent aux structures des opérations de réaction, tant entre tous les niveaux qu'à l'intérieur de ceux-ci. • Au niveau local, les membres individuels des équipes de secours et d'autres services ont besoin de communiquer avec leurs chefs d'équipe, ceux-ci avec le centre de coordination des opérations sur le terrain (OSOCC) et le centre sur site avec les sièges locaux des services publics, avec la police et avec les hôpitaux impliqués dans les opérations de secours. Ce trafic utilise essentiellement la voix. • Au niveau national, le centre sur site a besoin de liaisons avec l'équipe de gestion des opérations en cas de catastrophe et avec le centre national des opérations d'urgence et il lui faut souvent fournir des liaisons entre les chefs d'équipe sur le site de la catastrophe et leurs sièges nationaux respectifs. • Au niveau international, les communications en cas d'urgence par satellite sont complémentaires des liaisons radio à ondes courtes. De nombreux partenaires dans l'assistance humanitaire internationale entretiennent et étendent les réseaux qu'ils ont construits sur une longue période et ont considérablement augmenté leur efficacité par le biais de l'utilisation de modes avancés de communication de données. Rapport sur la Question 16/2 7 CHAPITRE 3 Cadre international de réglementation 3.1 Cadre international de réglementation des communications en cas de catastrophe Alors que les communications de sécurité et de détresse en mer ont joui traditionnellement de privilèges tels que la priorité absolue sur tout autre trafic, il n'en va pas de même pour les télécommunications terrestres en cas d'urgence. Le statut traditionnel des télécommunications en tant que monopole d'un état souverain restreint l'utilisation de tous les équipements de télécommunication autres que ceux qui font l'objet d'un enregistrement et d'une licence dans le pays où ils doivent être utilisés. Il faut noter qu'une assistance humanitaire internationale efficace et appropriée ne peut pas être assurée sans des télécommunications qui fonctionnent, spécialement lorsque les ressources disponibles sur le plan national ne peuvent pas souvent couvrir tous les besoins avant, pendant et après les catastrophes. Au fil des ans, les diverses parties impliquées dans les opérations de secours aux sinistrés et dans l'atténuation des effets des catastrophes ainsi que dans le développement des télécommunications ont reconnu la nécessité d'un cadre international pour la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. En 1991, une conférence internationale sur les communications en cas de catastrophe a été convoquée à Tampere en Finlande et des experts en catastrophes et en télécommunications y ont assisté. Cette conférence a adopté la Déclaration de Tampere sur les communications en cas de catastrophe, qui souligne la nécessité de créer un instrument légal international relatif à la mise à disposition de télécommunications pour les secours en cas de catastrophe. Cela a été fait en reconnaissant que les liaisons de communications régulières étaient souvent interrompues pendant les catastrophes et que des obstacles réglementaires entravaient souvent l'utilisation des équipements de communication en cas d'urgence à travers des frontières artificielles. La Déclaration prie le coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe de coopérer avec l'Union internationale des télécommunications (ITU) et d'autres organisations concernées, conformément aux buts et objectifs de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles (IDNDR). Elle les invite à convoquer une conférence intergouvernementale en vue de l'adoption d'une convention sur les communications en cas de catastrophe. La Déclaration de Tampere a été annexée à la Résolution 7 (Communications en cas de catastrophe) adaptée à l'unanimité par la première Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-94, Buenos Aires, 1994). La Résolution prie instamment toutes les administrations de lever les obstacles réglementaires nationaux afin de permettre la libre utilisation des télécommunications dans les opérations de secours en cas de catastrophe. Elle prie également le Secrétaire général de l'UIT de collaborer étroitement avec l'Organisation des Nations Unies dans le cadre de l'IDNDR en vue d'une convention internationale sur les communications en cas de catastrophe. Dans la même année, la Résolution 7 a été entérinée à son tour par la Résolution 36 (Communications en cas de catastrophe) de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (PP-94, Kyoto, 1994). La Résolution 36 réaffirme la nécessité d'une convention internationale sur les communications en cas de catastrophe et fait écho à la Résolution 7 en priant instamment les administrations de réduire et/ou lever les obstacles réglementaires afin de faciliter la mise à disposition rapide et l'utilisation efficace des ressources de télécommunications en vue de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe. Dans le sens de ces résolutions et sous le mandat donné par la Commission permanente interagence (IASC, l'organisme consultatif de l'ONU pour les affaires humanitaires), le Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence (WGET) a été mis en place. Ses réunions sont convoquées par 8 Rapport sur la Question 16/2 l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et ses prédécesseurs, UNDRO et DHA, et il sert de forum ouvert pour la discussion de toutes les questions liées aux télécommunications en cas d'urgence. Le groupe WGET comprend tous les partenaires des télécommunications de l'assistance humanitaire et des télécommunications en cas d'urgence, des entités de l'Organisation des Nations Unies, des organisations gouvernementales et non gouvernementales internationales et nationales majeures ainsi que des experts venant de l'université et du secteur privé. Depuis 1995, le groupe WGET a développé et examiné des projets d'une convention internationale sur les télécommunications en cas d'urgence. Le Secrétaire général de l'UIT a distribué un premier projet officiel de la «Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe» à tous les Etats Membres de l'UIT en 1996. La Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97, Genève, 1997), par sa Résolution 644 adoptée à l'unanimité, a vivement encouragé les administrations à appuyer sans réserve l'adoption de la Convention ainsi que son application sur le plan national. De même, la deuxième Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-98, La Valette) a adopté la Résolution 19. En plus de faire sienne toutes les résolutions susmentionnées, cette résolution invite le coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence à collaborer étroitement avec l'UIT en vue de l'assistance offerte aux administrations ainsi qu'aux organisations de télécommunication régionales et internationales concernant l'application de la Convention. Le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT a été invité à faire en sorte que les télécommunications d'urgence soient dûment prises en compte en tant qu'élément du développement des télécommunications, notamment, en encourageant l'utilisation de moyens de communication décentralisés. Le présent Manuel est un exemple de la réponse fournie par l'UIT. 3.2 La Convention de Tampere Les efforts internationaux sur les télécommunications en cas de catastrophe ont porté leurs fruits lorsque, du 16 au 18 juin 1998, à l'invitation du gouvernement finlandais, 76 pays et diverses organisations intergouvernementales et non gouvernementales ont participé à la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98) à Tampere en Finlande. Le 18 juin 1998, trente-trois des états participants ont signé le traité, qui porte désormais le nom de Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Au cours de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Minneapolis, 1998), les plénipotentiaires nationaux, par la Résolution 36 adoptée à l'unanimité, ont vivement encouragé les administrations nationales à signer et à ratifier la Convention de Tampere dès que possible. La résolution appelle instamment aussi à une application rapide de la Convention. En outre, la 54ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies, 1999, a appelé, par sa Résolution 54/233, à la ratification et à l'application de la Convention de Tampere. 3.2.1 Contenu de la Convention de Tampere La structure de la Convention suit le format caractéristique des traités internationaux et son texte contient, en plus des paragraphes de fond, les stipulations requises pour un traité déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. • Le Préambule de la Convention prend note du rôle essentiel des télécommunications dans l'assistance humanitaire et de la nécessité de les faciliter et il rappelle les instruments légaux majeurs, tels que les Résolutions de l'Organisation des Nations et de l'Union internationale des télécommunications, qui ont préparé le terrain pour la Convention de Tampere. Rapport sur la Question 16/2 9 • L'Article 1 définit les termes utilisés dans la Convention. Les définitions «d'organisation non gouvernementale» et «d'entités autres que des états» ont une signification particulière car la Convention de Tampere est le premier traité dans son genre à accorder des privilèges et des immunités à leur personnel. • L'Article 2 décrit la coordination des opérations qui doit être assurée par le coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe (par le biais de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA)). • L'Article 3 définit le cadre global de la coopération entre les Etats parties et tous les partenaires de l'assistance humanitaire internationale, y compris les entités autres que des Etats. • L'Article 4 décrit les procédures pour la demande et la mise à disposition de l'assistance en matière de télécommunications, en reconnaissant spécifiquement à un Etat partie le droit de diriger, de contrôler et de coordonner l'assistance fournie selon les termes de la présente Convention sur son territoire. • L'Article 5 définit les privilèges, immunités et facilités que doit fournir l'Etat partie demandeur, en précisant encore une fois que rien dans le présent Article ne doit porter atteinte aux droits et obligations en application d'accords internationaux ou d'une législation internationale. • Les Articles 6, 7 et 8 définissent des éléments et aspects spécifiques de la mise à disposition de l'assistance en matière de télécommunications tels que la cessation de l'assistance, le paiement ou le remboursement de coûts ou de droits, et la mise en place d'un inventaire de l'assistance en matière de télécommunications. • L'Article 9 peut être considéré comme l'élément central de la Convention de Tampere car la levée des obstacles réglementaires a été l'objectif premier des travaux en vue de ce traité depuis 1990. • Les Articles restants, 10 à 17, contiennent les dispositions standard relatives à la relation entre les accords de la Convention et d'autres accords internationaux, ainsi que le règlement des différends, l'entrée en vigueur, les amendements, les réserves et la dénonciation. Ils indiquent que le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la Convention et que les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe de la Convention font également foi. 3.2.2 Directives pour la signature, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion La «Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe» est un traité international entre Etats. Elle est contraignante pour les Etats qui ont déclaré leur adhésion à ladite Convention mais tout ou partie de son contenu peut être également appliqué(e) à tout moment en y faisant référence dans des accords bilatéraux ou multilatéraux régissant l'assistance humanitaire internationale. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention (Art. 16). Le Bureau des Affaires légales, situé dan la Section des traités, au Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, est chargé des procédures applicables. Le coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et sous-secrétaire général aux affaires humanitaires est le coordonnateur des opérations pour l'application de ladite Convention (Art.2). L'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), Bureau de Genève, est chargé de l'application et de l'exécution des fonctions et travaux respectifs, en collaboration étroite avec l'Union internationale des télécommunications (UIT). Le Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence (WGET), convoqué régulièrement par l'OCHA et comprenant tous les partenaires de l'assistance humanitaire internationale ainsi que l'UIT, fait office de commission consultative pour ces travaux. L'OCHA assure, aux termes de son projet sur les télécommunications en cas de catastrophe avec et sur le terrain, le secrétariat du WGET. 10 Rapport sur la Question 16/2 Un Etat peut exprimer son consentement à être lié par la présente Convention: • par signature définitive; • par signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; • par dépôt d'un instrument de ratification. Un Etat peut exprimer à tout moment son consentement à être lié par la Convention; devant l'urgente nécessité d'une application complète de la Convention, il est cependant souhaitable que la procédure à cet effet soit achevée auprès du Dépositaire au plus tôt. Il convient que les procédures relatives à la signature suivent les instructions indiquées dans la note jointe par le Conseil juridique de l'Organisation des Nations Unies. Pour toutes les questions apparentées, il est conseillé de rechercher l'assistance de la Section des traités de l'Organisation des Nations Unies. La Convention entrera en vigueur trente jours après le dépôt de ces instruments par trente Etats. 3.2.3 Les implications principales pour les signataires En fonction de la législation nationale applicable, l'adhésion à un traité international peut nécessiter la consultation et/ou l'approbation de différents organismes législatifs et exécutifs. Il en va de même pour l'ajustement de lois, règles et réglementations nationales qui pourrait être nécessaire pour la conformité aux articles de fond du traité. Au cours de ces procédures, les aspects ci-après mériteraient une attention spéciale: • La Convention a pour objectif d'accélérer et de faciliter l'utilisation des télécommunications en cas de catastrophe dans le cadre de l'assistance humanitaire internationale. Cette assistance en matière de télécommunications peut être assurée en tant qu'assistance directe, fournie à des institutions nationales et/ou à une localité ou région sinistrée, voire fournie en tant que partie ou soutien d'autres activités de secours en cas de catastrophe. • La Convention définit le statut du personnel des divers partenaires de l'assistance humanitaire, y compris celui des entités gouvernementales, des organisations internationales, des organisations non gouvernementales et autres entités autres que des états et définit leurs privilèges et immunités. • La Convention protège complètement les intérêts des Etats demandant et recevant l'assistance. Le gouvernement hôte détient le droit de superviser l'assistance. • La Convention prévoit l'établissement d'accords bilatéraux entre le(s) prestataire(s) de l'assistance et l'état qui demande/reçoit celle-ci. Le groupe WGET développera des cadres standard pour de tels accords. Afin de prévenir des retards dans la fourniture de l'assistance, des «bonnes pratiques» seront codifiées dans un langage d'application commun. L'utilisation de tels modèles d'accords, qui seront disponibles dans le format papier et électronique, permettra l'application immédiate de la Convention de Tampere en cas de n'importe quelle catastrophe soudaine. Rapport sur la Question 16/2 11 CHAPITRE 4 Le rôle des organisations internationales dans les communications en cas de catastrophe 4.1 L'Union internationale des télécommunications (UIT) L'UIT est une agence spécialisée du système de l'Organisation des Nations Unies. L'Article 1, Section 2 g de la Constitution de l'UIT stipule que l'UIT doit «favoriser l'adoption de mesures pour assurer la sécurité de la vie par le biais de la coopération des services de télécommunications». Ce mandat a été encore plus renforcé par des résolutions des récentes Conférence mondiale des télécommunications et Conférence mondiale des radiocommunications, et a été plus récemment entériné dans la Résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires (Minneapolis, 1998). L'UIT travaille en étroite coopération avec le coordonnateur des Nations Unies en cas d'urgence et chef de l'Office pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), et est membre du Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence (WGET). Le rôle de l'Union aux termes de la Convention de Tampere et des instruments qui lui sont liés est spécifié au Chapitre 3 ci-dessus. 4.2 Autres organisations et institutions internationales La réaction initiale à une catastrophe est de la responsabilité de la communauté locale. Les mécanismes pour l'assistance régionale, nationale et, finalement, internationale sont mobilisés seulement si et lorsque l'assistance nécessaire dépasse les capacités et ressources des mécanismes de réaction locale. Toutefois, il est important de noter que toute cette réaction dépend d'une demande d'assistance ou de l'acceptation d'une offre d'assistance par le pays sinistré et qu'il est nécessaire que toute l'assistance provenant de l'étranger soit étroitement coordonnée avec les autorités nationales. Un large éventail d'institutions gouvernementales et non gouvernementales nationales et internationales fournit une assistance humanitaire internationale. Afin de mener à bien leurs tâches, ces institutions dépendent toutes de la disponibilité de communications fiables dans des conditions imprévisibles et souvent extrêmement difficiles. 4.2.1 Entités des Nations Unies Le système des Nations Unies comprend des agences spécialisées dans les différents aspects de la mission humanitaire, y compris la réaction aux catastrophes. Leur coopération est assurée par le biais de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), dirigé par le coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, avec des bureaux à Genève et à New York et des bureaux régionaux dans un certain nombre de pays. A l'aide d'un système de service permanent, 24 heures sur 24, 365 jours par an, l'OCHA utilise tous les moyens de télécommunications disponibles pour surveiller les catastrophes et alerter immédiatement la communauté internationale afin de mobiliser les ressources appropriées dans les cas où il sera vraisemblablement nécessaire de faire appel à l'assistance internationale. En cas d'urgence, l'OCHA dépêche des équipes des Nations Unies pour la Coordination et l'évaluation des catastrophes (UNDAC) vers le pays sinistré. Ces équipes arrivent généralement en quelques heures au site de la catastrophe pour apporter leur appui aux autorités nationales dans la coordination de l'assistance internationale. 12 Rapport sur la Question 16/2 Dans les pays sinistrés, les diverses entités de l'Organisation des Nations Unies collaborent avec l'équipe de gestion des opérations en cas de catastrophe (EGO). Une telle équipe est convoquée par le coordonnateur résident, dans la plupart des cas il s'agit du représentant du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), qui a des bureaux dans la plupart des états membres de l'Organisation des Nations Unies. En fonction de la nature de la catastrophe, les diverses agences et institutions fournissent l'assistance dans un domaine spécifique. Les entités de l'Organisation des Nations Unies les plus communément engagées dans la réaction aux catastrophes comprennent, en plus de l'OCHA, le Programme alimentaire mondial (PAM) qui fournit de la nourriture en cas de catastrophe ainsi que des services logistiques pour d'autres biens de secours, l'Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR), qui fournit le couvert et l'assistance aux populations sinistrées, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF), qui fournit des services sanitaires en particulier aux groupes les plus vulnérables. En fonction de la nature de l'assistance nécessaire, d'autres agences participent dans leurs domaines spécifiques. Tout au long du processus de surveillance, d'alerte, de mobilisation et de réaction, les télécommunications ont une importance vitale. Toutes les entités de l'Organisation des Nations Unies possèdent des réseaux propres et communs et ont la capacité d'étendre ces réseaux au cas où d'autres moyens de communications seraient affectés par une catastrophe. L'interaction de tous les réseaux est assurée par le mécanisme du Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence, et, dans le pays sinistré, un Fonctionnaire chargé de la coordination des télécommunications (TCO) est responsable de l'utilisation optimale de tous les réseaux disponibles. 4.2.2 Organisations non gouvernementales (ONG) internationales Les organisations non gouvernementales (ONG) internationales jouent un rôle clé dans la mise à disposition de l'assistance opérationnelle. Un exemple bien connu d'ONG internationale est la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge (IFRC) avec ses sociétés membres nationales dans le monde entier. La Fédération IFRC et d'autres ONG possèdent leurs propres réseaux de télécommunications et apportent leur appui à leurs homologues nationaux lorsque les voies normales de communication sont interrompues par une catastrophe. Les entreprises commerciales, Ericsson par exemple, constituent un nouveau groupe important parmi les ONG qui mettent les ressources d'expertise de leurs sièges et de leurs bureaux dans plusieurs pays à la disposition des opérations de secours aux sinistrés. 4.2.3 Institutions gouvernementales assurant l'assistance internationale Tout comme les organisations non gouvernementales, les institutions nationales de nombreux pays fournissent des opérations de secours à l'étranger. Des exemples en sont l'Agence suédoise des services de secours (SRSA), l'Unité suisse d'opérations de secours (SDR), et la «Technisches Hilfswerk» allemande. Elles offrent souvent leurs services dans des domaines spécifiques et peuvent fournir leur assistance selon des arrangements bilatéraux avec le pays d'accueil ou en tant que partenaires d'application dans les opérations de secours des Nations Unies. Les organisations nationales pour l'assistance internationale fournissent habituellement des télécommunications pour leurs propres besoins mais elles peuvent, dans certains cas, venir à l'appui d'autres institutions, telles que les Nations Unies, les ONG et les services nationaux de secours, en leur fournissant un soutien lié aux télécommunications. 4.2.4 Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) Le CICR jouit d'un statut spécifique dans la législation internationale, ce qui différencie cet organisme des ONG. Tout en étant dans bien de cas un fournisseur d'assistance humanitaire opérationnelle, le CICR a pour fonction première l'application des conventions de Genève qui régissent la législation humanitaire en cas de conflit. Les délégations du CICR dans de nombreux pays à travers le monde sont reliées par leur propre réseau de télécommunications, qui peut être renforcé en cas de besoin créé par l'impact d'une catastrophe. Rapport sur la Question 16/2 4.2.5 13 Organisations régionales Tant dans le secteur humanitaire que dans celui des télécommunications, l'importance des organisations régionales à caractère gouvernemental ou non gouvernemental ne cesse de croître. Des exemples en sont l'Agence caraïbe de réaction aux catastrophes (CDERA), l'Union caraïbe des télécommunications (CTU, autorités chargées des télécommunications) et l'Association caraïbe des opérateurs nationaux des télécommunications (CANTO, opérateurs de réseaux). C'est à travers ces mécanismes que la coopération régionale, dans des domaines comme la formation à la réaction aux catastrophes entre les secteurs, peut le mieux être assurée. 14 Rapport sur la Question 16/2 CHAPITRE 5 Cadres nationaux 5.1 Structures nationales de gestion des opérations en cas de catastrophe L'attribution de fonctions liées aux opérations de secours en cas de catastrophe diffère d'un pays à l'autre. Dans la plupart des cas, l'attribution de fonctions suit les structures administratives du pays, avec un coordinateur des opérations de secours en cas de catastrophes pour chaque district, état, comté ou division géographique similaire. La coopération «horizontale» parmi les services spécialisés sur chacun des niveaux est aussi essentielle que les «chaînes de commandement» verticales; pour la communication en cas de catastrophe, il est nécessaire d'établir des liens entre les coordonnateurs des opérations de secours et les autorités chargées des télécommunications et les fournisseurs de services sur chaque niveau. Ce besoin de coordination à travers toutes les structures nationales s'applique également à l'assistance humanitaire internationale, dans laquelle le gouvernement national est le correspondant principal des fournisseurs étrangers d'assistance, tandis qu'il est nécessaire que leurs activités opérationnelles soient complètement intégrées à celles placées sous la responsabilité des niveaux respectifs. Une «Equipe de gestion des opérations en cas de catastrophe», normalement convoquée par le représentant local de l'Organisation des Nations Unies et constituée de toutes les organisations internationales présentes dans le pays sinistré, est mise en place dans la capitale. Son homologue est l'entité ou le fonctionnaire qui assume la fonction de gestionnaire national des opérations en cas de catastrophe. Au niveau local, un centre opérationnel de coordination sur le terrain (OSOCC), généralement mis en place par une équipe des Nations Unies pour la coordination et l'évaluation en cas de catastrophes (UNDAC), assure l'intégration de l'assistance internationale avec les partenaires nationaux et locaux sur le site de la catastrophe. Des communications fiables sont une condition nécessaire au fonctionnement de chacun de ces mécanismes ainsi qu'à leur interaction. 5.2 Cadre national de réglementation en matière de communications en cas de catastrophe Les législations et réglementations régissant les télécommunications dans n'importe quel pays sont souvent complexes et les mécanismes législatifs ne peuvent pas toujours suivre les avancées rapides de la technologie. Parmi les télécommunications nationales et les restrictions légales qui leur sont liées et qui présentent une importance particulière pour les communications en cas de catastrophe, on trouve les prescriptions pour les licences radio, l'approbation de type des équipements de télécommunications, les attributions de fréquence, les restrictions à l'importation ou les droits de douane. Lorsqu'une équipe internationale de recherche et de sauvetage, munie de son propre équipement de télécommunications, arrive dans un pays affecté par une catastrophe, cet équipement peut faire l'objet d'une évaluation par des fonctionnaires des douanes. Ce même équipement peut devoir obtenir une approbation de type avant son utilisation. Les fournisseurs d'assistance étrangers ainsi que les opérateurs de réseau public nationaux doivent satisfaire aux conditions d'obtention de licences. Tout ou partie de ces processus peut prendre beaucoup de temps et faire perdre un temps précieux pour des activités telles que la recherche et le sauvetage. La Convention de Tampere recommande donc la levée ou la réduction des obstacles réglementaires pour la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Dans l'esprit de la Convention de Tampere, les Etats parties sont en outre priés de prévoir les privilèges et immunités du personnel chargé des communications en cas de catastrophe, y compris les formalités d'immigration et il convient que ces états assurent un inventaire des informations sur l'assistance en matière de télécommunications nationales. Rapport sur la Question 16/2 5.3 15 Développement du concept national de communications en cas de catastrophe En tant que partie de l'application de la Convention de Tampere, des projets pilotes dans plusieurs pays ont été réalisés dans des pays en développement afin d'évaluer les points forts, les faiblesses, les opportunités et les menaces qui concernent les réseaux de communications en cas de catastrophe. Ces projets essayent généralement de saisir et évaluer les informations de base sur les catastrophes courantes dans un pays, sur les problèmes et contraintes des communications en cas de catastrophe, sur la structure opérationnelle existante pour la réaction aux catastrophes ainsi que sur les équipements et personnel impliqués. En s'appuyant sur ces informations, des recommandations – institutionnelles, réglementaires, techniques et financières – sont proposées pour un examen par les autorités nationales appropriées afin d'améliorer ou de mettre en place un concept national de communications en cas de catastrophe. 5.3.1 Concept global d'un examen et d'un plan national de communications en cas de catastrophe La situation spécifique dans chaque pays doit déterminer la structure de l'étude et le rapport et les plans qui en résultent, les études énumérées dans l'annexe à la présente publication et des éventuelles études complémentaires, qui seront disponibles auprès du Secrétariat du WGET peuvent servir de lignes directrices. Le secrétariat du WGET peut en outre aider à l'identification d'experts ayant une expérience de l'évaluation des structures de communications nationales en cas de catastrophes et du développement de concepts. 5.4 Méthodes et portée d'une étude L'implication des gestionnaires des opérations en cas de catastrophe ainsi que celle des entités chargées des télécommunications à chaque niveau et sur toute l'étude sont essentielles à l'applicabilité des résultats. Les paragraphes ci-après énumèrent un certain nombre d'éléments clés de ce travail, dont chacun peut revêtir une importance plus grande ou plus faible pour chaque cas particulier. Il est nécessaire d'analyser tous les réseaux de communications disponibles; les considérations ci-après se rapportent aux réseaux publics, qui sont généralement les plus complexes. Toutefois, avec les nécessaires modifications, elles s'appliquent également aux réseaux privés tels que ceux d'institutions chargées de la sécurité publique, d'autres réseaux spécialisés, de liaisons aux réseaux maritimes et aéronautiques et aux concepts des services de radioamateurs pour la préparation aux catastrophes. 5.4.1 Considérations de confidentialité L'expérience montre que la collecte d'informations sur la vulnérabilité des réseaux ne peut pas être réalisée sans l'approbation de dirigeants et hauts fonctionnaires gouvernementaux. L'information sur la vulnérabilité des systèmes nationaux de télécommunications serait d'un grand intérêt pour d'éventuels saboteurs. Par conséquent, une information précise sur la disposition exacte des réseaux est dans le meilleur des cas un «secret commercial» et peut être classée comme secret national, avec tout ce que cela implique. Le personnel des télécommunications peut donc être réticent à fournir des informations lorsque l'on pose des questions en vue de la préparation aux catastrophes. Les opérateurs de réseaux peuvent ne pas accepter de fournir des informations sauf si les résultats ne sont mis à la disposition que d'un groupe spécifié sur la base de «l'accès sélectif». L'autorisation d'une étude de la vulnérabilité des systèmes doit généralement émaner des niveaux les plus élevés des autorités et entités concernées. Avant qu'une étude ne puisse être entreprise, il peut être nécessaire de s’engager dans un «Accord de non-divulgation», un «Forum de non-divulgation» ou un «Mémorandum d'accord» avec leurs services législatifs. 16 5.4.2 Rapport sur la Question 16/2 Opérateurs des télécommunications Dans de nombreux pays, la dérégulation et la privatisation des télécommunications ont eu lieu et n'importe quel opérateur est susceptible de se trouver en concurrence avec d'autres entreprises. Pour un concurrent, des informations concernant la capacité d'un réseau peuvent présenter un intérêt commercial et induisent par conséquent la réticence à répondre à des questions liées à cette capacité. Il est nécessaire que l'ordre de divulguer de telles informations provienne du niveau le plus élevé de responsabilité. La société exploitante peut avoir un «Responsable de la continuité des affaires» qui fait rapport directement au président-directeur général (PDG). Cette personne est responsable de la restauration rapide de la capacité d'affaires de la société et a vraisemblablement une bonne connaissance des vulnérabilités du système. De nombreuses sociétés ont un «plan de continuité des affaires», qui fournit le détail de la localisation des pièces de rechange et celui des plans logistiques aux fins d'une restauration rapide des services et des données. 5.4.3 Résultats Les résultats de l'étude, fournis par l'opérateur de réseau, peuvent être difficiles à interpréter. Cet opérateur fera probablement référence à des valeurs «d'Erlang» et à des capacités PCM de haut niveau mais peut éviter de mentionner les méthodes de transmission ou les systèmes d'alimentation électrique de secours. D'autre part, les hommes d'affaires peuvent avoir tendance à souligner les points forts et à minimiser les points faibles de leurs réseaux et donc un chercheur indépendant devra garder cela en tête lorsqu'il procède à une évaluation. Il convient que l'étude tienne compte de trois questions liées mais différentes: • la capacité • la vulnérabilité • le rétablissement rapide. 5.4.4 Capacité du réseau Très peu de systèmes de télécommunications sont conçus pour transporter tout le trafic qu'en toute vraisemblance les usagers sont susceptibles de générer, car cela serait assurément anti-économique et donc les concepteurs font diverses hypothèses sur ce que pourrait vraisemblablement être la charge la plus lourde pendant un jour de travail chargé. Un commutateur type dans une zone résidentielle est conçu en supposant qu'environ 5% des utilisateurs vont l'utiliser simultanément à un moment donné. Dans les zones d'affaires, ce chiffre peut être plus proche de 10%. Par exemple, un centre type de 10 000 lignes dans une zone résidentielle peut être à même de transporter seulement 500 appels téléphoniques en même temps. La 501e personne qui compose un appel recevra une tonalité d'encombrement ou une tonalité de manœuvre. Il est probable que le trafic va considérablement s'accroître sur tout réseau qui fonctionne encore après l'impact d'une catastrophe. Il est donc important d'étudier le comportement des systèmes pendant des situations de surcharge aiguë. Dans un certain nombre de systèmes, un commutateur public réagit à une situation de surcharge en envoyant un signal aux commutateurs environnants afin de les informer de la fermeture des voies d'acheminement d'entrée à ce commutateur. Dans ce cas, il est possible d'atteindre n'importe quel abonné sur ce commutateur à partir de l'extérieur mais il sera toujours possible aux usagers de ce commutateur de composer des appels vers l'extérieur. Il convient que les planificateurs reflètent cela au moment de concevoir les flux d'informations dans leurs organisations. La priorité peut être accordée à un certain nombre d'usagers du réseau mais les détails sur la procédure à cet effet et sur la façon d'identifier les usagers prioritaires sont des questions extrêmement sensibles. Dans le cas des systèmes «câblés», il peut s'agir de classer des lignes individuelles par ordre de priorité. Dans les systèmes mobiles, il peut s'agir d'un «indicateur de classe de service» affecté au téléphone ou d'une caractéristique «d'indication de fonction prioritaire» attribuée au compte, ce qui permet à certains usagers de sauter la file d'attente. Dans les systèmes de données, il peut s'agir de différencier la classe de service «sous-réseau». Dans tous les cas où la concurrence entre opérateurs existe, l'application obligatoire des mêmes critères de désignation pour tous les fournisseurs de services du réseau public est indispensable. Rapport sur la Question 16/2 5.4.5 17 Vulnérabilités supplémentaires L'impact des catastrophes naturelles peut réduire davantage la capacité d'un réseau de télécommunications en endommageant les éléments dont elle dépend, tels que les centrales électriques et l'infrastructure de distribution qui leur est liée, les réseaux par câble, les commutateurs et les centres de transmissions. La perte d'alimentation électrique qui en résulte peut nuire au système de télécommunication. Un tel dommage fera l'objet d'un exposé ci-après. 5.4.6 Rétablissement Lorsque des équipements sont endommagés ou détruits, il faut les remplacer ou les réparer rapidement. L'opérateur aura besoin de l'assistance rapide du fournisseur des systèmes, qui peut se trouver à l'étranger. Etant donné que leur contribution au rétablissement rapide des communications est dans l'intérêt national, l'assistance diplomatique, peut-être sur la base de la Convention de Tampere, peut être nécessaire pour accélérer l'importation des équipements. L'extrême urgence de la situation signifie que la législation internationale prévoit «la réduction ou la levée» des restrictions normales à l'importation afin d'accélérer cette mission vitale. 5.5 Application du plan Un plan développé en étroite coopération avec toutes les entités nationales concernées par la gestion des opérations en cas de catastrophe ou par les télécommunications a les meilleures chances d'être totalement appliqué. L'expérience montre que la conscience de la nécessité d'un plan en cas de catastrophe est toujours la plus élevée après le contrecoup d'une catastrophe et baisse rapidement avec le temps qui passe sans que se produise une catastrophe majeure. Il est donc essentiel de mettre en place, en tant que partie du plan lui-même, un mécanisme de revue périodique de toutes les mesures prises dans l'application du plan de communications en cas de catastrophe. Bibliographie Les documents énumérés dans cette bibliographie figurent dans les annexes. UIT, Union internationale des télécommunications et OCHA, Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe (Convention de Tampere), Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98), Tampere, Finlande. (Annexe 1) UIT, Union internationale des télécommunications, Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-94, Buenos Aires, 1994), Résolution 7, Communications en cas de catastrophe. (Annexe 2) UIT, Union internationale des télécommunications, Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT-98, La Valette), Résolution 19, Ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. (Annexe 3) UIT, Union internationale des télécommunications, Conférence mondiale des radiocommunications (CMR-97, Genève, 1997), Résolution 644, Moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours. (Annexe 4) UIT, Union internationale des télécommunications, Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (PP-98, Minneapolis, 1998), Résolution 36, Les télécommunications au service de l'aide humanitaire. (Annexe 5) 54e Assemblée générale des Nations Unies, Résolution 54/233, Coopération internationale en matière d'aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles: de la phase des secours à celle de l'aide au développement, 1999. (Annexe 6) 18 Rapport sur la Question 16/2 ANNEXE 1 Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catasTrophe Article 1 – Définitions Article 2 – Coordination Article 3 – Dispositions générales Article 4 – Mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication Article 5 – Privilèges, immunités et facilités Article 6 – Cessation de l'assistance Article 7 – Paiement ou remboursement des frais ou des droits Article 8 – Inventaire des informations concernant l'assistance en matière de télécommunication Article 9 – Obstacles réglementaires Article 10 – Relations avec d'autres accords internationaux Article 11 – Règlement des différends Article 12 – Entrée en vigueur Article 13 – Amendements Article 14 – Réserves Article 15 – Dénonciation Article 16 – Dépositaire Article 17 – Textes faisant foi Rapport sur la Question 16/2 19 LES ÉTATS PARTIES À LA PRÉSENTE CONVENTION, reconnaissant que les catastrophes sont d'une gravité croissante par leur ampleur, leur complexité, leur fréquence et leur impact et ont des conséquences particulièrement graves dans les pays en développement, rappelant que les organismes de secours et d'assistance humanitaires ont besoin de ressources de télécommunication fiables et souples pour mener à bien leurs tâches vitales, rappelant également que les ressources de télécommunication jouent un rôle essentiel en permettant d'assurer plus facilement la sécurité du personnel chargé des secours et de l'assistance humanitaires, rappelant en outre que la radiodiffusion joue un rôle déterminant dans la diffusion d'informations précises destinées aux populations sinistrées, convaincus que la mise en œuvre judicieuse et à brefs délais de ressources de télécommunication et la circulation efficace et rapide d'informations précises et fiables sont essentielles pour réduire les pertes en vies humaines, les souffrances et les dégâts causés par les catastrophes aux biens et à l'environnement, préoccupés par les conséquences des catastrophes sur les installations de télécommunication et la circulation des informations, conscients des besoins particuliers des pays les moins avancés sujets à des catastrophes naturelles en matière d'assistance technique pour mettre en place des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, réaffirmant la priorité absolue accordée aux télécommunications d'urgence destinées à sauver des vies humaines dans plus de cinquante instruments réglementaires internationaux, dont la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, notant les antécédents de la coopération et de la coordination internationales pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, et en particulier le fait que la mise en œuvre et l'utilisation rapides de ressources de télécommunication peuvent contribuer à sauver des vies humaines, notant en outre les travaux de la Conférence internationale sur les communications en cas de catastrophe (Genève, 1990) relatifs au rôle joué par les systèmes de télécommunication pour remédier aux catastrophes et faire face à leurs conséquences, 20 Rapport sur la Question 16/2 notant en outre que les auteurs de la Déclaration de Tampere sur les communications en cas de catastrophe (Tampere, 1991) ont instamment demandé que des systèmes de télécommunication fiables soient utilisés pour atténuer les effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et que soit rédigée une Convention internationale sur les communications en cas de catastrophe pour faciliter l'emploi de ces systèmes, notant en outre la Résolution 44/236 de l'Assemblée générale des Nations Unies proclamant la période 1990-2000 Décennie internationale de prévention des catastrophes naturelles, et la Résolution 46/182 demandant le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence, notant en outre le rôle prépondérant joué par les ressources de communication dans la Stratégie de Yokohama pour un monde plus sûr et le Plan d'action adoptés par la Conférence mondiale sur la prévention des catastrophes naturelles (Yokohama, 1994), notant en outre la Résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994), entérinée par la Résolution 36 de la Conférence de plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications (Kyoto, 1994), par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de prendre toutes les mesures envisageables dans la pratique pour faciliter la mise à disposition rapide et l'utilisation efficace d'équipements de télécommunication en vue de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe, en réduisant et, lorsque cela est possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la coopération transfrontière entre les Etats, notant ou outre la Résolution 644 de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements d'apporter leur concours plein et entier à l'adoption de la présente Convention et à sa mise en œuvre au niveau national, notant en outre la Résolution 19 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998) par laquelle la Conférence priait instamment les gouvernements de poursuivre leur examen de la présente Convention en vue d'envisager d'apporter leur concours plein et entier à son adoption, notant en outre la Résolution 51/94 de l'Assemblée générale des Nations Unies encourageant la mise au point d'une procédure transparente et rapide pour l'établissement de modalités de coordination efficaces en matière de secours en cas de catastrophe et le développement du réseau ReliefWeb en tant que système d'information à l'échelon mondial pour la diffusion d'éléments d'information fiables et actuels sur les situations d'urgence et catastrophes naturelles, se référant aux conclusions du Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence en ce qui concerne le rôle essentiel joué par les télécommunications dans l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours, Rapport sur la Question 16/2 21 avec l'appui des travaux de nombreux Etats, organismes des Nations Unies, organisations gouvernementales, intergouvernementales ou non gouvernementales, agences d'aide humanitaire, fournisseurs d'équipement et de services de télécommunication, représentants de la presse, universités et organisations œuvrant dans le domaine des communications ou des secours en cas de catastrophe, afin d'améliorer et de faciliter les communications liées aux opérations de secours en cas de catastrophe, désireux de faire en sorte de mettre rapidement à disposition des ressources de télécommunication fiables pour atténuer les effets des catastrophes et permettre le déroulement des opérations de secours, et désireux en outre de faciliter la coopération internationale visant à atténuer les effets des catastrophes, décident de ce qui suit: Article 1 Définitions Sauf indication contraire suivant le contexte dans lequel ils sont utilisés, les termes ci-dessous ont la signification suivante aux fins de la présente Convention: 1. Un «Etat partie» est un Etat qui a accepté d'être lié par la présente Convention. 2. On entend par «Etat partie prêtant assistance» un Etat partie à la présente Convention prêtant à ce titre une assistance en matière de télécommunication. 3. On entend par «Etat partie demandeur» un Etat partie à la présente Convention demandant à ce titre une assistance en matière de télécommunication. 4. On entend par «la présente Convention» la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. 5. On entend par «dépositaire» le dépositaire de la présente Convention tel qu'il est désigné dans l'article 16. 6. On entend par «catastrophe» une grave perturbation du fonctionnement de la société causant une menace réelle et généralisée à la vie ou à la santé humaine, aux biens ou à l'environnement, que la cause en soit un accident, un phénomène naturel ou une activité humaine et qu'il s'agisse d'un événement soudain ou du résultat de processus complexes se déroulant sur une longue période. 7. On entend par «atténuation des effets des catastrophes» les mesures conçues pour prévenir, prévoir ou surveiller les catastrophes, s'y préparer, y faire face et en atténuer les conséquences. 8. On entend par «risque sanitaire» le brusque déclenchement de maladies infectieuses, telles que les épidémies ou les pandémies, ou tout autre événement causant une menace réelle à la vie ou à la santé humaine et susceptible de déclencher une catastrophe. 9. On entend par «risque naturel» un événement ou un processus, tels que séisme, incendie, inondation, vent, glissement de terrain, avalanche, cyclone, tsunami, invasion d'insectes, sécheresse ou éruption volcanique qui sont susceptibles de déclencher une catastrophe. 22 Rapport sur la Question 16/2 10. On entend par «organisation non gouvernementale» toute organisation, y compris les entités privées et les entreprises, autre qu'un Etat, une organisation gouvernementale ou une organisation intergouvernementale, travaillant dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe. 11. On entend par «entité autre qu'un Etat» toute entité, autre qu'un Etat, y compris les organisations non gouvernementales et le Mouvement de la Croix Rouge et du Croissant Rouge, travaillant dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe et/ou de la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. 12. On entend par «opérations de secours» les activités destinées à réduire les pertes humaines, les souffrances et les dégâts aux biens et/ou à l'environnement causés par une catastrophe. 13. On entend par «assistance en matière de télécommunication» la mise à disposition de ressources de télécommunication ou d'autres ressources ou supports destinés à faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication. 14. On entend par «ressources de télécommunication» le personnel, les équipements, les matériels, les informations, la formation, le spectre des fréquences radioélectriques, la capacité de réseau ou de transmission ou toute autre ressource nécessaire aux télécommunications. 15. On entend par «télécommunications» toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, fibre optique ou autres systèmes électromagnétiques. Article 2 Coordination 1. Le coordonnateur des Nations Unies pour les secours d'urgence est le coordonnateur des opérations pour la présente Convention et s'acquitte des responsabilités du coordonnateur des opérations définies dans les articles 3, 4, 6, 7, 8 et 9. 2. Le coordonnateur des opérations demande la coopération des institutions compétentes des Nations Unies, notamment de l'Union internationale des télécommunications, pour l'aider à réaliser les objectifs de la présente Convention et, en particulier, à remplir les responsabilités visées aux articles 8 et 9, et pour fournir tout appui technique nécessaire, conformément à leur objet. 3. Les responsabilités du coordonnateur des opérations se limitent, au titre de la présente Convention, aux activités de coordination d'un caractère international. Article 3 Dispositions générales 1. Les Etats parties collaborent entre eux ainsi qu'avec les entités autres que des Etats et les organisations intergouvernementales, conformément aux dispositions de la présente Convention, afin de faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe. Rapport sur la Question 16/2 2. a) 23 Cette utilisation peut comprendre, mais non exclusivement: la mise en œuvre d'équipement de télécommunication de Terre et par satellite pour prévoir et surveiller les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes et pour fournir des informations y relatives; b) le partage des informations concernant les risques naturels, les risques sanitaires et les catastrophes entre les Etats parties et avec d'autres Etats et des entités autres que des Etats, et la diffusion de ces informations auprès du public et notamment des communautés exposées; c) la mise à disposition rapide d'une assistance en matière de télécommunication pour atténuer les effets d'une catastrophe; et d) l'installation et la mise en œuvre de ressources de télécommunication fiables et souples qui seront utilisées par les organisations de secours et d'assistance humanitaires. 3. Pour faciliter cette utilisation, les Etats parties peuvent conclure des accords ou des arrangements internationaux ou bilatéraux additionnels. 4. Les Etats parties demandent au coordonnateur des opérations, en consultation avec l'Union internationale des télécommunications, le dépositaire, les autres institutions des Nations Unies et les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, de tout mettre en œuvre, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour: a) élaborer, d'entente avec les Etats parties, des modèles d'accords sur lesquels pourront se fonder les accords internationaux ou bilatéraux facilitant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe; b) mettre à la disposition des Etats parties, des autres Etats, des entités autres que les Etats et des organisations intergouvernementales des modèles d'accord, des meilleures pratiques et autres informations pertinentes concernant la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, par moyens électroniques ou autres mécanismes appropriés; c) élaborer, exploiter et tenir à jour les procédures et systèmes de collecte et de diffusion d'informations nécessaires à la mise en œuvre de la présente Convention; et d) informer les Etats des conditions énoncées par la présente Convention et faciliter et soutenir la coopération entre les Etats parties prévue dans ladite Convention. 5. Les Etats parties coopèrent entre eux en vue de renforcer la capacité des organisations gouvernementales, des entités autres que des Etats et des organisations intergouvernementales pour leur permettre de mettre sur pied des mécanismes de formation à l'utilisation et à l'exploitation des équipements ainsi que des stages d'apprentissage des techniques de développement, de conception et de construction d'installations de télécommunication d'urgence propres à faciliter la prévention et la surveillance des catastrophes ainsi que la réduction de leurs effets. Article 4 Mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication 1. Un Etat partie demandant une assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe peut s'adresser à tout autre Etat partie, soit directement, soit par l'intermédiaire du coordonnateur des opérations. Dans le deuxième cas, le coordonnateur des opérations communique immédiatement ladite demande à tous les autres Etats parties concernés; dans le premier cas, l'Etat partie demandeur informe au plus tôt le coordonnateur des opérations. 24 Rapport sur la Question 16/2 2. Un Etat partie demandeur d'une assistance en matière de télécommunication précise l'ampleur et le type d'assistance requise et les mesures prises en application des articles 5 et 9 de la présente Convention et, lorsque cela est réalisable, fournit à l'Etat partie auquel il s'adresse et/ou au coordonnateur des opérations toute autre information nécessaire pour déterminer dans quelle mesure ledit Etat partie peut répondre à sa demande. 3. Chaque Etat partie auquel est adressée une demande d'assistance en matière de télécommunication, que ce soit directement ou par l'intermédiaire du coordonnateur des opérations, détermine et fait savoir immédiatement à l'Etat partie demandeur s'il est prêt à fournir l'assistance requise, soit directement, soit autrement, et indique la portée, les termes, conditions et restrictions applicables à cette assistance ainsi que, le cas échéant, les coûts y afférents. 4. Tout Etat partie, décidant de fournir une assistance en matière de télécommunication en informe au plus tôt le coordonnateur des opérations. 5. Aucune assistance en matière de télécommunication ne sera fournie par un Etat partie au titre de la présente Convention sans le consentement de l'Etat partie demandeur. Ce dernier a le droit de refuser la totalité ou une partie de l'assistance en matière de télécommunication que lui propose un autre Etat partie conformément à sa législation et à sa politique générale. 6. Les Etats parties reconnaissent en vertu du présent article aux Etats parties demandeurs le droit de demander une assistance en matière de télécommunication directement à des entités autres que des Etats ou à des organisations intergouvernementales et reconnaissent aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales le droit, conformément aux dispositions légales auxquelles elles sont soumises de fournir une assistance en matière de télécommunication aux Etats parties demandeurs. 7. Une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale peut ne pas être un «Etat partie demandeur» et ne pas être autorisée à demander une assistance en matière de télécommunication au titre de la présente Convention. 8. Aucune disposition de la présente Convention n'altère le droit d'un Etat partie, en application de sa législation nationale, de diriger, de gérer, de coordonner et de superviser l'assistance en matière de télécommunication fournie sur son territoire au titre de la présente Convention. Article 5 Privilèges, immunités et facilités 1. L'Etat partie demandeur accorde, dans les limites permises par sa législation nationale, aux personnes autres que ses ressortissants et aux organisations autres que celles qui ont leur siège ou sont domiciliées sur son territoire, qui agissent aux termes de la présente Convention et qui ont été dûment notifiées à l'Etat partie demandeur et acceptées par lui, les privilèges, immunités et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions y compris, mais non exclusivement: a) l'immunité en matière d'arrestation, de détention et de juridiction, y compris en ce qui concerne la compétence en matière civile, pénale et administrative de l'Etat partie demandeur eu égard aux actes ou omissions liés spécifiquement et directement à la fourniture d'assistance en matière de télécommunication; b) l'exonération d'impôts, de taxes ou autres droits, à l'exception de ceux qui sont habituellement compris dans le prix des biens et des services, dans l'exercice de leurs fonctions d'assistance ou pour les équipements, le matériel et les autres biens amenés ou achetés sur le territoire de l'Etat partie demandeur afin de fournir une assistance en matière de télécommunication au titre de la présente Convention; et c) l'immunité contre la saisie, la saisie-arrêt ou la réquisition de ces équipements, matériel et biens. Rapport sur la Question 16/2 25 2. L'Etat partie demandeur fournit, dans la mesure de ses capacités, des installations et des services sur place pour la gestion appropriée et efficace de l'assistance en matière de télécommunication; il doit entre autres faire en sorte que les équipements de télécommunication amenés sur son territoire au titre de la présente Convention soient agréés dans les plus brefs délais ou exemptés de l'agrément conformément à ses dispositions légales et réglementaires. 3. L'Etat partie demandeur garantit la protection du personnel, des équipements et du matériel amenés sur son territoire au titre de la présente Convention. 4. La propriété des équipements et du matériel fournis au titre de la présente Convention ne doit pas souffrir de l'usage qu'il en sera fait au titre de la présente Convention. L'Etat partie demandeur fait en sorte que ces équipements, ce matériel et ces biens soient rendus dans les meilleurs délais à l'Etat partie qui prête assistance. 5. L'Etat partie demandeur ne peut orienter la mise en œuvre ou l'utilisation de quelque ressource de télécommunication que ce soit fournie au titre de la présente Convention à des fins qui ne soient pas directement liées à la prévision ou à la surveillance des catastrophes, ou aux mesures visant à s'y préparer, y faire face, en atténuer les effets ou fournir des secours pendant les catastrophes ou à la suite de celles-ci. 6. Aucune disposition du présent article n'exige d'un Etat partie demandeur qu'il octroie à ses ressortissants ou à ses résidents permanents, ou encore aux organisations ayant leur siège ou domiciliées sur son territoire des privilèges et immunités. 7. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités conformément aux dispositions du présent article, toutes les personnes pénétrant sur le territoire d'un Etat partie afin de fournir une assistance en matière de télécommunication ou de faciliter de toute autre manière l'utilisation de ressources de télécommunication au titre de la présente Convention, et toutes les organisations fournissant une assistance en matière de télécommunication ou facilitant de toute autre manière l'utilisation de moyens de télécommunication au titre de la présente Convention sont tenues de respecter la législation et la réglementation dudit Etat partie. Ces personnes et ces organisations ont également un devoir de noningérence dans les affaires intérieures de l'Etat partie sur le territoire duquel elles ont pénétré. 8. Aucune disposition du présent article ne doit préjuger des droits et obligations relatifs aux privilèges et immunités accordés aux personnes et aux organisations qui participent directement ou indirectement à l'assistance en matière de télécommunication, conformément à d'autres accords internationaux (dont la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies adoptée par l'Assemblée générale le 13 février 1946 et la Convention sur les privilèges et immunités des Institutions spécialisées adoptée par l'Assemblée générale le 21 novembre 1947) ou au droit international. Article 6 Cessation de l'assistance 1. L'Etat partie demandeur ou l'Etat partie prêtant l'assistance peut, à tout moment, mettre fin à l'assistance en matière de télécommunication reçue ou fournie au titre de l'article 4 par notification écrite. Dès réception de cette notification, les Etats parties concernés procèdent à des consultations en vue de mettre fin de manière appropriée et rapide à l'assistance, en tenant compte des risques pour la vie humaine que comporte la cessation de l'assistance et de ses conséquences sur les opérations en cours de secours en cas de catastrophe. 2. Les Etats parties fournissant ou recevant une assistance en matière de télécommunication en vertu de la présente Convention demeurent liés par les dispositions de la présente Convention après la cessation de l'assistance en question. 3. Tout Etat partie demandant la cessation de l'assistance en matière de télécommunication notifie le coordonnateur des opérations de cette demande. Le coordonnateur fournit l'aide demandée et nécessaire pour faciliter la cessation de l'assistance en matière de télécommunication. 26 Rapport sur la Question 16/2 Article 7 Paiement ou remboursement des frais ou des droits 1. Les Etats parties peuvent soumettre la fourniture d'une assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe à un accord relatif au paiement ou au remboursement des coûts ou des droits spécifiés, en gardant toujours à l'esprit les dispositions du paragraphe 8 du présent article. 2. Au cas où une telle condition s'applique, les Etats parties établissent par écrit, avant la fourniture d'assistance en matière de télécommunication: a) l'obligation de paiement ou de remboursement; b) le montant de ce paiement ou remboursement ou encore les modalités selon lesquelles il est calculé; et c) les autres termes, conditions ou restrictions applicables à ce paiement ou remboursement, y compris, mais non exclusivement, la monnaie dans laquelle ce paiement ou ce remboursement est effectué. 3. Les conditions énoncées aux paragraphes 2 b) et 2 c) du présent article peuvent être satisfaites par référence aux tarifs, taux ou prix publiés. 4. Afin que la négociation des accords relatifs au paiement et au remboursement ne retarde pas de manière indue la fourniture d'assistance en télécommunication, le coordonnateur des opérations élabore, d'entente avec les Etats parties, un modèle d'accord de paiement et de remboursement qui peut constituer la base de la négociation des obligations de paiement et de remboursement aux termes du présent article. 5. Aucun Etat partie n'est tenu de procéder au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes de la présente Convention sans avoir au préalable exprimé son accord aux conditions établies par un Etat partie prêtant assistance conformément au paragraphe 2 du présent article. 6. Lorsque la fourniture d'assistance en matière de télécommunication est dûment soumise au paiement ou au remboursement de coûts ou de droits aux termes du présent article, ce paiement ou ce remboursement est effectué immédiatement après présentation de la demande de paiement ou de remboursement par l'Etat partie prêtant assistance. 7. Les fonds payés ou remboursés par un Etat partie demandeur dans le cadre de la fourniture d'assistance en matière de télécommunication sont librement transférables en dehors de la juridiction de l'Etat partie demandeur et ne doivent être ni l'objet de retards ni retenues. 8. Pour déterminer s'il convient de soumettre la fourniture d'assistance en matière de télécommunication à un accord prévoyant le paiement ou le remboursement de frais ou de droits spécifiés, le montant de ces coûts ou de ces droits et les termes, conditions et restrictions associés à leur paiement ou remboursement, les Etats parties tiennent notamment compte: a) des principes des Nations Unies en matière d'assistance humanitaire; b) de la nature de la catastrophe, du risque naturel ou du risque sanitaire; c) des conséquences ou des conséquences potentielles de la catastrophe; d) du lieu d'origine de la catastrophe; e) de la région touchée ou potentiellement touchée par la catastrophe; f) d'éventuelles précédentes catastrophes et de la probabilité de futures catastrophes dans la région touchée; g) de la capacité de chaque Etat touché par la catastrophe, le risque naturel ou le risque sanitaire de se préparer ou de faire face à un tel événement; et h) des besoins des pays en développement. Rapport sur la Question 16/2 27 9. Le présent article s'applique en outre aux cas où une assistance en matière de télécommunication est fournie par une entité autre qu'un Etat ou par une organisation intergouvernementale, à condition: a) que l'Etat partie demandeur ait consenti à ce que cette assistance en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe soit mise à sa disposition et n'y ait pas mis fin; b) que l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en matière de télécommunication ait informé l'Etat partie demandeur de son acceptation du présent article et des articles 4 et 5; et c) que l'application du présent article ne soit pas incompatible avec tout autre accord concernant les relations entre l'Etat partie demandeur et l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale fournissant cette assistance en matière de télécommunication. Article 8 Inventaire des informations concernant l'assistance en matière de télécommunication 1. Chaque Etat partie notifie au coordonnateur des opérations le nom de son autorité ou de ses autorités: a) chargée(s) des questions relevant de la présente Convention et autorisée(s) à demander, à offrir, à accepter l'assistance et à y mettre fin; et b) habilitée(s) à déterminer les ressources gouvernementales, intergouvernementales et/ou non gouvernementales pouvant être dégagées pour faciliter l'utilisation des ressources de télécommunication pour atténuer les effets des catastrophes et pour permettre les opérations de secours en cas de catastrophe, ainsi que pour fournir une assistance en matière de télécommunication. 2. Chaque Etat partie doit s'efforcer d'informer promptement le coordonnateur des opérations de toute modification apportée aux informations communiquées conformément aux dispositions du présent article. 3. Le coordonnateur des opérations peut accepter qu'une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale lui notifie les procédures qu'elle applique pour autoriser à offrir une assistance en matière de télécommunication et à y mettre fin conformément au présent article. 4. Un Etat partie, une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale peut, à sa discrétion, inclure dans le dossier qu'il ou elle dépose auprès du coordonnateur des opérations des informations concernant des ressources de télécommunication particulières ou des plans relatifs à l'utilisation de ces ressources pour répondre à une demande d'assistance en matière de télécommunication présentée par un Etat partie demandeur. 5. Le coordonnateur des opérations tient à jour des exemplaires de toutes les listes d'autorités et diffuse rapidement ces informations aux Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales compétentes, à moins qu'un Etat partie, une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale n'ait précédemment spécifié par écrit que la diffusion des informations qu'il ou elle a fournies doit être limitée. 6. Le coordonnateur des opérations traite la documentation déposée par des entités autres que des Etats ou par des organisations intergouvernementales selon les mêmes modalités qui sont applicables à la documentation déposée par des Etats parties. 28 Rapport sur la Question 16/2 Article 9 Obstacles réglementaires 1. Les Etats parties réduisent ou éliminent, si possible et en conformité avec leur législation nationale, les obstacles réglementaires à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, y compris la fourniture d'assistance en matière de télécommunication. 2. Les obstacles réglementaires peuvent comprendre les obstacles suivants, mais cette liste n'est pas limitative: a) dispositions réglementaires limitant l'importation ou l'exportation d'équipements de télécommunication; b) dispositions réglementaires limitant l'utilisation des équipements de télécommunication ou du spectre des fréquences radioélectriques; c) dispositions réglementaires limitant les mouvements des personnels qui exploitent les équipements de télécommunication ou qui sont indispensables à leur utilisation efficace; d) dispositions réglementaires limitant le transit des ressources de télécommunication en direction ou en provenance du territoire d'un Etat partie ou à travers ce territoire; e) retards dus à l'administration de dispositions réglementaires de ce type. 3. La réduction des obstacles réglementaires peut prendre la forme des mesures suivantes, mais cette liste n'est pas limitative: a) révision de la réglementation; b) exemption de ressources de télécommunication spécifiées de l'application de ces dispositions réglementaires pendant l'utilisation de ces ressources aux fins d'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe; c) autorisation préalable d'utiliser des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces dispositions réglementaires; d) reconnaissance de l'homologation à l'étranger des équipements de télécommunication et/ou des licences d'exploitation; e) examen rapide des ressources de télécommunication en vue de leur utilisation pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, dans le respect de ces dispositions réglementaires; et f) levée temporaire de ces dispositions réglementaires en vue de l'utilisation de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et des opérations de secours en cas de catastrophe. 4. Chaque Etat partie facilite, à la demande de tout autre Etat partie et dans les limites permises par sa législation nationale, le transit à destination ou en provenance de son territoire ou à travers son territoire du personnel, des équipements, des matériels et des informations associés à l'utilisation des ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe. 5. Chaque Etat Membre notifie au coordonnateur des opérations et aux autres Etats parties, directement ou par l'intermédiaire de celui-ci: a) les mesures prises, au titre de la présente Convention, en vue de réduire ou d'éliminer les obstacles réglementaires de ce type; b) les procédures mises à la disposition, au titre de la présente Convention, d'Etats parties, d'autres Etats, d'entités autres que des Etats et d'organisations intergouvernementales, en vue d'exempter les Rapport sur la Question 16/2 29 ressources de télécommunication spécifiées et utilisées pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en cas de catastrophe, de l'application de ces réglementations, pour procéder à l'autorisation préalable ou à l'examen accéléré de ces ressources dans le respect des réglementations applicables, la reconnaissance de l'homologation étrangère de ces ressources, ou la levée temporaire des réglementations normalement applicables à ces ressources; c) les termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à l'utilisation de ces procédures. 6. Le coordonnateur des opérations fournit régulièrement et rapidement aux Etats parties, aux autres Etats, aux entités autres que des Etats et aux organisations intergouvernementales une liste actualisée de ces mesures, de leur champ d'application, et des termes, conditions et restrictions associés, le cas échéant, à leur utilisation. 7. Nulle disposition du présent article n'autorise la violation ou l'abrogation d'obligations et de responsabilités imposées par la législation d'un pays, par le droit international ou bien par des accords multilatéraux ou bilatéraux, notamment en matière de douanes et de contrôles à l'exportation. Article 10 Relations avec d'autres accords internationaux La présente Convention n'altère pas les droits et obligations des Etats parties découlant d'autres accords internationaux ou du droit international. Article 11 Règlement des différends 1. En cas de différend entre des Etats parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Etats parties au différend procèdent à des consultations afin de régler le différend. Ces consultations commencent immédiatement après la déclaration écrite, remise par un Etat partie à un autre Etat partie, concernant l'existence d'un différend au titre de la présente Convention. L'Etat partie formulant une déclaration écrite concernant l'existence d'un différend remet immédiatement copie de cette déclaration au dépositaire. 2. Si un différend entre des Etats parties ne peut être réglé dans les six (6) mois à compter de la date de remise de la déclaration écrite à un Etat partie au différend, les Etats parties au différend peuvent demander à tout autre Etat partie, à une entité autre qu'un Etat ou à une organisation intergouvernementale d'utiliser ses bons offices pour faciliter le règlement du différend. 3. Si aucun des Etats parties ne cherche à s'assurer les bons offices d'un autre Etat partie, d'un Etat, d'une entité autre qu'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale ou encore si les bons offices ne permettent pas de faciliter le règlement du différend dans les six (6) mois à compter de la demande de bons offices présentée, l'un ou l'autre Etat partie au différend peut alors: a) demander que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant; ou b) soumettre le différend à la Cour internationale de justice pour décision, sous réserve que l'un et l'autre Etats parties au différend aient, au moment où ils ont signé ou ratifié la présente Convention ou bien au moment où ils y ont adhéré, ou bien encore à tout autre moment ultérieurement, accepté la juridiction de la Cour internationale de justice pour les différends de ce type. 4. Au cas où les Etats parties au différend demandent que le différend soit soumis à un arbitrage contraignant et soumettent le différend à la Cour internationale de justice pour décision, la saisine de la Cour internationale de justice a priorité. 30 Rapport sur la Question 16/2 5. En cas de différend entre un Etat partie demandeur d'une assistance en matière de télécommunication et une entité autre qu'un Etat ou une organisation intergouvernementale, dont le siège ou le domicile est situé hors du territoire de cet Etat partie, concernant la mise à disposition d'une assistance en matière de télécommunication conformément à l'article 4, l'Etat partie sur le territoire duquel l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale a son siège ou son domicile peut directement faire sienne la réclamation formulée par ladite entité comme réclamation d'Etat à Etat aux termes du présent article, à condition que cette substitution ne soit pas incompatible avec tout autre accord conclu entre l'Etat partie et l'entité autre qu'un Etat ou l'organisation intergouvernementale concernés par le différend. 6. Lors de la signature, de la ratification, de l'acceptation, de l'approbation de la présente Convention ou lors de l'adhésion à la présente Convention, un Etat peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre des procédures de règlement des différends visées au paragraphe 3 ci-dessus. Les autres Etats parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends visées au paragraphe 3 vis à vis d'un Etat partie auquel s'applique une déclaration de ce type. Article 12 Entrée en vigueur 1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou de l'Union internationale des télécommunications à la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence à Tampere, le 18 juin 1998 et ensuite au siège de l'Organisation des Nations Unies, New York, à compter du 22 juin 1998 jusqu'au 21 juin 2003. 2. a) Un Etat peut exprimer son consentement à être lié par la présente Convention: par signature (définitive); b) par signature soumise à ratification, acceptation ou approbation suivie du dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou c) par dépôt d'un instrument d'adhésion. 3. La Convention entre en vigueur trente (30) jours après que trente (30) Etats auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion ou apposé leur signature définitive. 4. Pour chaque Etat ayant signé définitivement ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois satisfaite la condition énoncée au paragraphe 3 du présent article, la présente Convention entre en vigueur trente (30) jours après la date de la signature définitive ou de l'expression du consentement à être lié. Article 13 Amendements 1. Un Etat partie peut proposer des amendements à la présente Convention en soumettant lesdits amendements au dépositaire, qui les communique aux autres Etats parties pour approbation. 2. Les Etats parties informent le dépositaire s'ils approuvent ou non les amendements proposés dans les cent quatre-vingt (180) jours suivant leur réception. 3. Tout amendement approuvé par les deux tiers de tous les Etats parties est présenté dans un protocole qui est ouvert à la signature, auprès du dépositaire, par tous les Etats parties. Rapport sur la Question 16/2 31 4. Le protocole entre en vigueur selon les mêmes modalités que la présente Convention. Pour chaque Etat ayant signé définitivement ledit protocole ou déposé un instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, une fois satisfaites les conditions applicables à l'entrée en vigueur du protocole, ledit protocole entre en vigueur pour ledit Etat partie trente (30) jours après la date de la signature définitive ou de l'expression du consentement à être lié. Article 14 Réserves 1. Au moment de la signature définitive, de la ratification de la présente Convention ou de tout amendement y relatif, ou de l'adhésion à ladite Convention, un Etat partie peut formuler des réserves. 2. Un Etat partie peut à tout moment retirer sa réserve antérieure par notification écrite au dépositaire. Le retrait d'une réserve prend effet immédiatement après notification au dépositaire. Article 15 Dénonciation 1. Un Etat partie peut dénoncer la présente Convention par notification écrite au dépositaire. 2. écrite. La dénonciation prend effet quatre-vingt-dix (90) jours après la date de dépôt de la notification 3. A la demande de l'Etat partie dénonçant la présente Convention, tous les exemplaires des listes des autorités ainsi que des mesures adoptées et des procédures disponibles pour réduire les obstacles réglementaires, qu'il aura précédemment communiqués, sont retirés à la date à laquelle prend effet ladite dénonciation. Article 16 Dépositaire Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire de la présente Convention. Article 17 Textes faisant foi L'original de la présente Convention, dont les versions anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe font également foi, est déposé auprès du dépositaire. Seuls les textes faisant foi en anglais, français et espagnol seront disponibles à la signature à Tampere, le 18 juin 1998. Le dépositaire élabore les textes faisant foi en arabe, chinois et russe dès que possible après cette date. 32 Rapport sur la Question 16/2 ANNEXE 2 RÉSOLUTION 7 Première Conférence mondiale de développement des télécommunications (CMDT) de l'Union internationale des télécommunications (UIT) Buenos Aires, avril 1994 Communications en cas de catastrophe La Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 21-29 mars 1994), notant la Déclaration de Tampere, ci-annexée, sur les communications en cas de catastrophe formulée par le Groupe d'experts en communications et gestion des catastrophes participant à la Conférence sur les communications en cas de catastrophe qui s'est tenue à Tampere, Finlande, (20 au 22 mai 1991), notant en outre a) l'appui que de nombreuses autres organisations nationales, régionales et internationales ont apporté à la Déclaration de Tampere; b) la Résolution N° 209 de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles (Mob-87) Etude et mise en œuvre d'un Système mondial de détresse et de sécurité sur terre et en mer; c) les études faites par les Commissions d'études de l'UIT-R en réponse à la Résolution N° 209 (Mob-87); d) le champ d'application des études faites par les Commissions d'études de l'UIT-T dans le domaine des communications en cas de catastrophe notamment par les Commissions d'études I, II, III, IV, reconnaissant a) que les catastrophes ont provoqué et continueront vraisemblablement de provoquer des souffrances importantes, des pertes en vies humaines, et des dommages matériels et écologiques ; b) que les catastrophes peuvent avoir des conséquences particulièrement désastreuses dans les pays en développement; c) que, pour parer aux catastrophes, il est nécessaire de disposer de moyens de communications décentralisés, y compris, mais pas uniquement, de terminaux portables et mobiles par satellite et de services de radioamateur, pour pallier les lacunes éventuelles des réseaux nationaux, régionaux et mondiaux, Rapport sur la Question 16/2 33 convaincue a) qu'un flux d'informations efficace et rapide est essentiel pour prévoir les catastrophes, pour en atténuer les conséquences ainsi que pour assurer les secours, b) que les télécommunications peuvent être vitales pour rétablir la continuité du processus de développement, préoccupée a) de voir que le processus de développement s'interrompt à l'occasion de catastrophes, b) et que lorsqu'une catastrophe se produit, les installations de télécommunication existantes sont souvent détruites ou inutilisables, décide d'inviter l'UIT-R: a) à continuer d'étudier, en priorité, les aspects techniques, opérationnels et réglementaires des radiocommunications pour limiter les effets des catastrophes et faciliter les opérations de secours, b) d'envisager de recommander d'inscrire à l'ordre du jour d'une Conférence mondiale des radiocommunications compétente, l'étude de dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, relatives aux communications en cas de catastrophe; d'inviter l'UIT-R à étudier en priorité: a) les moyens permettant de faciliter des communications efficaces propres à permettre d'atténuer les conséquences des catastrophes et de faciliter les opérations de secours, b) les principes de taxation et de comptabilisation des communications intérieures et internationales établies en cas de catastrophe, y compris la suppression de la taxation et une structure tarifaire appropriée, charge le Directeur du BDT d'aider les pays en développement, en particulier les pays les moins avancés, à préparer leurs services de télécommunication à l'éventualité des catastrophes et à en rétablir le fonctionnement en cas d'interruption, charge en outre le Directeur du BDT, dans le cadre de la Décennie internationale de la prévention des catastrophes, à aider les pays en développement particulièrement exposés à mettre au point des systèmes d'avertissement immédiat en utilisant les télécommunications, y compris la radiodiffusion, dans le cadre du Programme volontaire spécial de coopération technique, prie le Secrétaire général de collaborer étroitement avec le Département des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies pour accroître la participation de l'UIT au développement des communications en cas de catastrophe, prie en outre le Secrétaire général de communiquer la présente Résolution aux organisations internationales concernées, 34 Rapport sur la Question 16/2 invite le Département des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies à contribuer activement, en collaboration étroite avec l'UIT et en particulier avec le BDT, au développement et au renforcement des capacités de communication des pays en développement en cas de catastrophe, prie instamment les administrations d'adopter toutes les mesures envisageables dans la pratique pour faciliter la distribution rapide et l'utilisation efficace d'équipements de télécommunication affectés aux secours en cas de catastrophe en limitant et, lorsque cela est possible, supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la coopération transfrontières entre les Etats. Rapport sur la Question 16/2 35 ANNEXE 3 RÉSOLUTION 19 Ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe La Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998), considérant a) que la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994) a adopté la Résolution 7 relative aux télécommunications pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, relançant ainsi un processus engagé par la Conférence sur les communications en cas de catastrophe de Tampere, 1991; b) que la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994) a fait sienne cette Résolution en adoptant la Résolution 36 relative aux télécommunications pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe; c) le rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications, (Buenos Aires, 1994); d) que la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997), par sa Résolution 644, a encouragé vivement les administrations à appuyer sans réserve l'adoption d'une Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe ainsi que son application sur le plan national, reconnaissant a) le potentiel des techniques modernes de télécommunication comme outil essentiel pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours ainsi que le rôle vital des télécommunications pour la sécurité des secouristes sur le terrain; b) les besoins particuliers des pays en développement, notamment ceux des habitants des zones isolées, notant avec satisfaction l'organisation, à l'invitation du Gouvernement de la Finlande, de la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98) du 16 au 18 juin 1998 à Tampere (Finlande), qui devrait adopter la Convention visée au point d) du considérant ci-dessus, décide d'inviter le Secteur du développement des télécommunications de l'UIT à faire en sorte que les télécommunications d'urgence soient dûment prises en compte en tant qu'élément du développement des télécommunications, notamment, en coordination et en collaboration étroites avec le Secteur des radiocommunications de l'UIT, en facilitant et en encourageant l'utilisation de moyens de communication décentralisés, qui sont appropriés et généralement disponibles, y compris ceux offerts par le service de radioamateur et les services GMPCS, 36 Rapport sur la Question 16/2 charge le Directeur du BDT a) de soutenir les administrations dans leur travail en vue de la mise en œuvre de la présente Résolution et de la Convention; b) de faire rapport à la prochaine Conférence mondiale de développement des télécommunications concernant la mise en œuvre de la Convention, charge le Secrétaire général de travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, en vue d'accroître l'intervention de l'Union dans les communications d'urgence et son appui à ces communications et de rendre compte des résultats de l'ICET-98 à la Conférence de plénipotentiaires de 1998, pour que celle-ci ou le Conseil de l'UIT puisse prendre les mesures éventuelles qu'il ou elle jugera nécessaires, invite le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence à collaborer étroitement avec l'UIT pour la suite des travaux en vue de la mise en œuvre de la présente Résolution, de l'adoption de la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe et de l'assistance offerte aux administrations ainsi qu'aux organisations de télécommunication régionales et internationales concernant l'application de la Convention, prie instamment les administrations de poursuivre leur examen du projet de Convention pour déterminer si elles envisagent d'appuyer pleinement l'adoption de ladite Convention, encourage les administrations à participer à la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98) qui se tiendra à Tampere, à l'invitation du Gouvernement de la Finlande, du 16 au 18 juin 1998. Rapport sur la Question 16/2 37 ANNEXE 4 RÉSOLUTION 644 (CMR-97) Moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours La Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997), considérant a) que l'UIT a reconnu expressément, dans l'esprit des articles 40 et 46 de sa Constitution ainsi que de la Résolution 209 (Mob-87), l'importance de l'utilisation internationale des radiocommunications en cas de catastrophe naturelle, d'épidémie, de famine et de situations d'urgence analogues; b) que la Conférence de plénipotentiaires (Kyoto, 1994), lorsqu'elle a fait sienne la Résolution 7 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (Buenos Aires, 1994), a adopté la Résolution 36 sur les télécommunications pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe; c) que les administrations ont été invitées instamment à prendre toutes les mesures pratiques pour faciliter la mise à disposition rapide et l'utilisation efficace de moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours en réduisant et, si possible, en supprimant les obstacles réglementaires et en renforçant la coopération transfrontière entre les Etats, reconnaissant a) le potentiel des techniques modernes de télécommunication comme outil essentiel pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours ainsi que le rôle vital des télécommunications pour la sécurité des secouristes sur le terrain; b) les besoins particuliers des pays en développement et notamment des populations des zones isolées; c) le progrès de la mise en œuvre de la Résolution 36 pour ce qui est de l'élaboration de la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, notant avec satisfaction la convocation, du 16 au 18 juin 1998 à Tampere (Finlande), de la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (ICET-98) qui doit adopter la Convention visée au reconnaissant c) ci-dessus, décide d'inviter l'UIT-R à continuer d'étudier d'urgence les aspects des radiocommunications liés à l'atténuation des effets des catastrophes et aux opérations de secours, tels que les moyens décentralisés de communication, qui sont appropriés et généralement disponibles, notamment les installations de radioamateurs et les terminaux mobiles et portables de télécommunication par satellite, demande au Directeur du Bureau des radiocommunications de soutenir les administrations dans leur travail en vue de la mise en œuvre de la Résolution 36, 38 Rapport sur la Question 16/2 charge le Secrétaire général de travailler en étroite collaboration avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe en vue d'accroître l'intervention de l'Union dans les communications en cas de catastrophe et son appui à ces communications, et de rendre compte des résultats de la Conférence de Tampere à la Conférence de plénipotentiaires de 1998 pour que celle-ci ou le Conseil de l'UIT puisse prendre les mesures qu'il ou elle jugera nécessaires, invite le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe et le Groupe de travail sur les télécommunications d'urgence à collaborer étroitement avec l'UIT pour la suite des travaux en vue de la mise en œuvre de la Résolution 36 et en particulier de l'adoption de la Convention sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, prie instamment les administrations d'appuyer sans réserve l'adoption de ladite Convention et son application sur le plan national. Rapport sur la Question 16/2 39 ANNEXE 5 RÉSOLUTION 36 (Rév. Minneapolis, 1998) Les télécommunications au service de l'aide humanitaire La Conférence de (Minneapolis, 1998), plénipotentiaires de l'Union internationale des télécommunications faisant siennes a) la Résolution 644 de la Conférence mondiale des radiocommunications (Genève, 1997) sur les moyens de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours; b) la Résolution 19 de la Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998) sur les ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et les opérations de secours; c) la Déclaration de La Valette, adoptée par la Conférence mondiale de développement des télécommunications (La Valette, 1998), dans laquelle l'attention des Etats Membres et des Membres des Secteurs de l'UIT est attirée sur l'importance des télécommunications d'urgence et sur la nécessité d'une convention internationale sur le sujet, considérant que la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (Tampere, 1998) a adopté la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes, notant a) l'Acte final de la Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence (Tampere, 1998), qui traduit l'intérêt accordé par la Conférence aux conséquences importantes qu'ont les catastrophes sur les sociétés et l'environnement et à la nécessité de fournir, dans les meilleurs délais et de manière efficace, aide et ressources en matière de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophes; b) le rapport du Secrétaire général sur la mise en œuvre, entre autres résolutions, de la Résolution 36 (Kyoto, 1994), notant avec satisfaction a) les efforts déployés par le Secrétaire général de l'UIT en vue de l'adoption de la Convention de Tampere; b) la coopération étroite entre le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et l'UIT au cours des quatre années écoulées, reconnaissant la gravité et l'ampleur des catastrophes qui peuvent se produire et risquent d'avoir des conséquences dramatiques sur le plan humain, 40 Rapport sur la Question 16/2 convaincue que l'absence d'obstacles à l'utilisation des équipements et services de télécommunication est indispensable à l'efficacité et à l'utilité de l'aide humanitaire, convaincue également que la Convention de Tampere offre le cadre nécessaire à une telle utilisation des moyens de télécommunication, décide de charger le Secrétaire général de travailler en collaboration étroite avec le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe à l'élaboration des modalités pratiques de mise en œuvre de la Convention de Tampere, exhorte les Etats Membres à œuvrer pour que les autorités nationales compétentes procèdent le plus rapidement possible à la ratification, l'acceptation, l'approbation ou la signature finale de la Convention de Tampere, exhorte en outre les Etats Membres parties à la Convention de Tampere à prendre toutes les mesures concrètes d'application de ladite Convention et à travailler en collaboration étroite avec le coordonnateur des opérations, comme le prévoit ladite Convention. Rapport sur la Question 16/2 41 ANNEXE 6 RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 54/233. Coopération internationale en matière d’aide humanitaire à la suite de catastrophes naturelles: de la phase des secours à celle de l’aide au développement L'Assemblée générale, réaffirmant sa résolution 46/182 du 19 décembre 1991, en annexe à laquelle sont énoncés les principes directeurs pour le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence du système des Nations Unies, et ses résolutions 52/12 B du 19 décembre 1997 et 54/219 du 22 décembre 1999, et rappelant les conclusions concertées 1999/11 du Conseil économique et social 1 se rapportant au thème «La coopération internationale et la coordination des mesures à prendre dans les situations d'urgence humanitaire, en particulier lors de la transition des activités de secours aux activités de relèvement, de reconstruction et de développement», ainsi que la résolution 1999/63 du Conseil, en date du 30 juillet 1999, prenant note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence fournie par l'Organisation des Nations Unies2, particulièrement en ce qui concerne la transition entre la phase des secours et celle du relèvement, de la reconstruction et du développement, constatant l'importance des principes de neutralité, d'humanité et d'impartialité dans l'apport d'une aide humanitaire, soulignant que c'est au premier chef à l'État touché qu'il incombe de lancer, d'organiser, de coordonner et de mettre en œuvre les activités d'aide humanitaire sur son territoire et de faciliter la tâche des organismes d'aide humanitaire qui s'efforcent d'atténuer les conséquences d'une catastrophe naturelle, 1. Se déclare vivement préoccupée par la multiplication et l'aggravation des catastrophes naturelles, qui causent d'immenses pertes humaines et matérielles dans le monde entier, en particulier dans les pays vulnérables qui n'ont pas les moyens de mener une action efficace en vue d'atténuer les répercussions à long terme de ces catastrophes sur les plans social, économique et écologique; 2. Souligne que l'aide humanitaire en cas de catastrophe naturelle devrait être fournie conformément aux principes directeurs énoncés dans la résolution 46/182 et dans le strict respect de ceux-ci, et que cette aide devrait être définie en fonction des problèmes et des besoins sur le plan humanitaire résultant d'une catastrophe donnée; 3. Engage les Etats à adopter, s'ils ne l'ont encore fait, et à continuer d'appliquer résolument des mesures appropriées, notamment sur le plan législatif, visant à atténuer les conséquences des catastrophes naturelles, parmi lesquelles des mesures préventives, y compris en ce qui concerne les règlements de construction, ainsi que la planification préalable et la création de capacités dans le domaine des interventions en cas de catastrophe, et prie la communauté internationale, à cet égard, de continuer d'aider les pays en développement lorsque ceux-ci en ont besoin; _______________ 1 A/54/3, chap. VI, par. 5. Pour le texte définitif, voir Documents officiels de l'Assemblée générale, cinquante-quatrième session, Supplément N° 3 (A/54/3/Rév.1). 2 A/54/154–E/1999/94 et Add.1. 42 Rapport sur la Question 16/2 4. Souligne la nécessité de renforcer l'action menée à tous les niveaux, y compris à l'échelon national, pour sensibiliser les populations au problème des catastrophes naturelles et améliorer les systèmes de prévention, de planification préalable et d'alerte rapide, ainsi que la coopération internationale face aux situations d'urgence, depuis les activités de secours jusqu'aux activités de relèvement, de reconstruction et de développement, compte tenu de l'ensemble des répercussions des catastrophes naturelles, des besoins humanitaires qu'elles créent et des demandes formulées par les pays touchés, selon le cas; 5. Engage le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, les membres du Comité permanent interorganisations et les autres membres du système des Nations Unies à s'attacher davantage à promouvoir la planification préalable des interventions aux niveaux international, régional et national et à donner plus d'efficacité à la mobilisation et à la coordination de l'aide humanitaire du système des Nations Unies face aux catastrophes naturelles, notamment en implantant dans toutes les régions des équipes de réserve des Nations Unies pour l'évaluation et la coordination en cas de catastrophe et en développant ces équipes afin qu'elles comprennent, comme il convient, un plus grand nombre de représentants des pays d'Afrique, de l'Asie et du Pacifique et de l'Amérique latine et des Caraïbes, compte tenu du fait que ces représentants sont financés par les pays participants; 6. Engage le Programme des Nations Unies pour le développement à s'attacher davantage encore à renforcer les activités opérationnelles et la création de capacités en vue de l'atténuation des conséquences des catastrophes naturelles, de la prévention et de la planification préalable, compte dûment tenu de la stratégie de coopération internationale maximale dans le domaine de la lutte contre les catastrophes naturelles actuellement mise en place; 7. Invite le Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat et les organismes concernés, tenant dûment compte de la stratégie de coopération internationale maximale dans le domaine de la lutte contre les catastrophes naturelles actuellement mise en place, à renforcer le soutien qu'ils offrent aux équipes des Nations Unies pour la gestion des opérations en cas de catastrophe, qui sont envoyées dans les pays à la demande des gouvernements intéressés et dirigées par le coordonnateur résident des Nations Unies; 8. Rappelle l'analyse de la question des catastrophes naturelles qui figure dans le rapport de la troisième Conférence des Nations Unies sur l'exploration et les utilisations pacifiques de l'espace extraatmosphérique, tenue à Vienne du 19 au 30 juillet 19993, et souligne qu'il convient de continuer à utiliser les techniques spatiales pour prévenir les catastrophes naturelles, en atténuer les conséquences et gérer les interventions, prenant note à cet égard de la création du Réseau mondial d'information en matière de catastrophes; 9. Prend note de la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, adoptée à Tampere (Finlande) le 18 juin 1998, et invite les Etats qui ne l'ont pas encore fait à envisager de la signer; 10. Prend note avec satisfaction des initiatives novatrices prises pour lier les différentes phases de l'aide internationale, depuis les activités de secours jusqu'aux activités de relèvement, telles que la mission conjointe du Bureau de la coordination des affaires humanitaires, du Programme des Nations Unies pour le développement, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation panaméricaine de la santé en matière d'intervention en cas de catastrophe et de relèvement, entreprise dans tous les pays touchés par l'ouragan Mitch, et souligne qu'il importe d'assurer une évaluation et un suivi adéquats de ces initiatives en vue de les perfectionner et de les appliquer dans d'autres cas; _______________ 3 A/CONF.184/6. Rapport sur la Question 16/2 43 11. Engage les gouvernements, agissant en particulier par l'intermédiaire de leurs organismes d'intervention en cas de catastrophe, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales compétentes de continuer de coopérer comme il convient avec le Secrétaire général et le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence pour maximiser l'efficacité des mesures prises au niveau international pour faire face aux catastrophes naturelles, fondées entre autres sur les besoins humanitaires, depuis la phase des secours jusqu'à celle du développement; 12. Prie à nouveau le Secrétaire général, à cet égard, de solliciter les apports nécessaires àl'optimisation et à la diffusion de listes des organisations chargées de la protection civile et des interventions d'urgence à tous les niveaux, accompagnées d'inventaires actualisés des ressources disponibles, dont on puisse se servir en cas de catastrophe naturelle, ainsi que l'information, notamment sous forme de manuels, sur laquelle puisse se fonder la coopération internationale destinée à faire face aux catastrophes naturelles; 13. Souligne qu'il faudrait s'attacher particulièrement, dans le cadre de la coopération internationale, à renforcer et élargir encore l'utilisation des capacités nationales et locales et, le cas échéant, des capacités régionales et sous-régionales de pays en développement en matière de préparation et d'intervention en cas de catastrophe, ces capacités pouvant être disponibles plus près du lieu d'une catastrophe et pouvant être utilisées de façon plus rationnelle et à un moindre coût; 14. Note qu'après des catastrophes naturelles la phase de transition est souvent excessivement longue et caractérisée par un certain nombre de lacunes et que les gouvernements, agissant le cas échéant en coopération avec les organismes de secours, devraient, lorsqu'ils déterminent ce qui est nécessaire pour faire face aux besoins immédiats, envisager ces besoins dans l'optique du développement durable chaque fois u'une telle approche est possible; 15. Souligne qu'il convient de continuer de fournir des fonds suffisants et de les verser rapidement en cas de catastrophe naturelle, afin de contribuer à un relèvement complet dans des délais aussi courts que possible; 16. Souligne également, à cet égard, que les contributions faites au titre de l'aide humanitaire destinée à faire face aux catastrophes naturelles ne devraient pas l'être au détriment des ressources affectées à la coopération internationale pour le développement ou aux situations humanitaires complexes; 17. Réitère la demande qu'elle a adressée au Secrétaire général dans la résolution 54/95 du 8 décembre 1999 tendant à ce qu'il lui soumette, au début de 2000, des propositions concrètes visant à renforcer le fonctionnement et l'utilisation du Fonds central autorenouvelable d'urgence et, à cet égard, l'invite à envisager d'utiliser plus activement le Fonds de façon à permettre une intervention rapide et efficace en cas de catastrophe naturelle; 18. Invite le Secrétaire général à envisager de nouveaux moyens novateurs permettant d'intervenir rapidement et efficacement en cas de catastrophe naturelle, notamment en mobilisant de nouvelles ressources auprès du secteur privé; 19. Invite le Conseil économique et social à étudier, à sa session de fond de 2000, dans le cadre du suivi de ses conclusions concertées 1999/1, les moyens de renforcer encore l'efficacité de la coopération et de la coordination internationales de façon qu'une aide humanitaire adéquate soit fournie rapidement en cas de catastrophe naturelle; 20. Invite le Secrétaire général à continuer d'étudier des mécanismes novateurs permettant d'améliorer les mesures prises au niveau international pour faire face aux catastrophes naturelles et à d'autres situations d'urgence, notamment en remédiant à tous déséquilibres géographiques et sectoriels éventuellement constatés dans le cadre de ces interventions, ainsi que des moyens d'utiliser plus efficacement les organismes nationaux d'intervention d'urgence, compte tenu de leurs avantages comparatifs et de leurs domaines de spécialisation, ainsi que des arrangements existants, et à lui en rendre compte à sa cinquante-cinquième session, au titre de la question intitulée «Renforcement de la 44 Rapport sur la Question 16/2 coordination de l'aide humanitaire d'urgence et des secours en cas de catastrophe fournis par l'Organisation des Nations Unies, y compris l'assistance économique spéciale», en vue, notamment, d'apporter une contribution au rapport d'ensemble sur la mise en œuvre de la stratégie internationale de prévention des catastrophes naturelles qui lui sera présenté à sa cinquante-sixième session au titre de la question intitulée «Environnement et développement durable». 87e séance plénière 22 décembre 1999 _______________ Rapport sur la Question 16/2 45 Manuel sur les télécommunications en cas de catastrophe PARTIE 2 Table des matières Page CHAPITRE 1 – Les aspects opérationnels des communications en cas de catastrophe 1.1 Introduction ......................................................................................................................... 49 1.2 Communications tactiques et stratégiques........................................................................... 49 1.3 Normalisation et passerelles ................................................................................................ 49 CHAPITRE 2 – Modes de communication 2.1 Communications vocales..................................................................................................... 50 2.2 Communications de données............................................................................................... 50 CHAPITRE 3 – Réseaux de communication publics 3.1 Le Réseau téléphonique public commuté (RTPC) .............................................................. 3.1.1 Distribution locale................................................................................................... 3.1.2 Boucle locale sans fil (WLL) .................................................................................. 3.1.3 Commutateurs ......................................................................................................... 3.1.4 Système de jonctions et de signalisation................................................................. 3.1.5 Réseau numérique à intégration de services (RNIS)............................................... 3.1.6 Télex ....................................................................................................................... 3.1.7 Télécopie (Fax) ....................................................................................................... 3.1.8 Réseau mobile terrestre public (RMTP) ................................................................. 3.1.9 Cellules sur roues (COW) ....................................................................................... 52 52 53 53 53 54 54 55 55 56 3.2 Systèmes mobiles par satellite............................................................................................. 3.2.1 Norme M et mini-M................................................................................................ 3.2.2 Norme C.................................................................................................................. 3.2.3 Norme B.................................................................................................................. 3.2.4 Norme A.................................................................................................................. 57 57 57 57 58 3.3 Systèmes mobiles de communications personnelles par satellite (GMPCS)....................... 58 3.4 Systèmes mobiles par satellite à couverture régionale ........................................................ 58 3.5 L'Internet ............................................................................................................................. 3.5.1 Structure de l'Internet .............................................................................................. 3.5.2 Forces et faiblesses de l'Internet.............................................................................. 3.5.2.1 Confidentialité .......................................................................................... 3.5.2.2 Disponibilité ............................................................................................. 3.5.2.3 Précision ................................................................................................... 3.5.2.4 Maintenabilité........................................................................................... 58 59 59 60 61 61 61 46 Rapport sur la Question 16/2 Page CHAPITRE 4 – Réseaux privés 4.1 Service radiomaritime.......................................................................................................... 4.1.1 Réseaux maritimes .................................................................................................. 4.1.2 Stations maritimes de correspondance publique ..................................................... 62 62 63 4.2 Service radioaéronautique ................................................................................................... 4.2.1 Réseaux aéronautiques ............................................................................................ 4.2.2 Stations aéronautiques de correspondance publique ............................................... 4.2.3 NOTAM .................................................................................................................. 4.2.4 Radio privée à bord d'un aéronef............................................................................. 4.2.5 Considérations spéciales impliquant des communications avec des aéronefs ........ 63 63 64 64 64 65 4.3 Services de radionavigation................................................................................................. 4.3.1 Applications liées à la sûreté et à la sécurité ........................................................... 4.3.2 Rapports .................................................................................................................. 4.3.3 Applications logistiques .......................................................................................... 4.3.4 Points de cheminement............................................................................................ 4.3.5 Radiobalises individuelles de repérage (PLB) ........................................................ 65 65 65 66 66 66 4.4 Systèmes d'entreprise (Systèmes privés) ............................................................................. 4.4.1 Réseaux de données, réseaux RLE et RE, intranets ................................................ 4.4.2 Acheminement en diversité..................................................................................... 4.4.3 Radios virtuelles (SDR) .......................................................................................... 66 67 68 68 4.5 Réseaux VSAT (Station terminale à antenne à petite ouverture) ........................................ 69 4.6 Exercices de formation afin d'assurer une réaction rapide .................................................. 69 CHAPITRE 5 – Le service de radioamateurs 5.1 Distance de communication................................................................................................. 5.1.1 Sur le site de la catastrophe ..................................................................................... 5.1.2 Depuis et vers le site de la catastrophe.................................................................... 71 71 72 5.2 Considérations de distance .................................................................................................. 5.2.1 Courte distance (0-100 km)..................................................................................... 5.2.2 Moyenne distance (100 à 500 km): onde ionosphérique HF à incidence presque verticale ................................................................................................................... 5.2.3 Longue distance (au-delà de 500 km) onde ionosphérique HF à incidence oblique 5.2.4 Moyennes et longues distances par satellites de radioamateurs.............................. 72 72 73 73 74 5.3 Sélection des fréquences de travail...................................................................................... 5.3.1 Plans des bandes...................................................................................................... 5.3.2 Fréquences d'urgence .............................................................................................. 74 74 74 5.4 Modes de communications .................................................................................................. 5.4.1 Radiotélégraphie...................................................................................................... 5.4.2 Communication de données par radioamateurs....................................................... 5.4.2.1 Données HF .............................................................................................. 5.4.2.2 Radio par mode paquets............................................................................ 5.4.2.3 Données d'ondes métriques/décimétriques VHF/UHF ............................. 5.4.3 Radiotéléphonie à bande latérale unique................................................................. 74 74 75 75 75 75 75 5.5 Communication par image................................................................................................... 75 Rapport sur la Question 16/2 47 Page 5.6 Satellites de radioamateurs .................................................................................................. 5.6.1 Transpondeurs analogiques..................................................................................... 5.6.2 Transpondeurs numériques ..................................................................................... 76 76 77 5.7 Service d'urgence radioamateur (ARES)............................................................................. 5.7.1 Fonctions avant le départ ........................................................................................ 5.7.2 Fonctions pendant le trajet ...................................................................................... 5.7.3 Fonctions à l'arrivée ................................................................................................ 5.7.4 Fonctions sur le site................................................................................................. 5.7.5 Fonction de démobilisation..................................................................................... 5.7.6 Procédures standard ................................................................................................ 77 77 77 77 78 78 78 5.8 Activités de formation ......................................................................................................... 5.8.1 Exercice pratique, manœuvres et essais .................................................................. 5.8.2 Exercices quotidiens sur le terrain .......................................................................... 5.8.3 Tests de simulation de situations d'urgence ............................................................ 78 79 79 79 5.9 Réseaux pour le trafic sur le service de radioamateurs ....................................................... 5.9.1 Réseaux tactiques.................................................................................................... 5.9.2 Réseaux de ressources............................................................................................. 5.9.3 Réseaux de commandement.................................................................................... 5.9.4 Réseaux ouverts et réseaux fermés ......................................................................... 5.9.5 Formation des opérateurs de réseaux ...................................................................... 79 80 80 80 80 80 5.10 Traitement de l'information ................................................................................................. 5.10.1 Centre des opérations d'urgence.............................................................................. 5.10.2 Centre d'information ............................................................................................... 5.10.3 Trafic de messages réglementaires.......................................................................... 5.10.4 Fonctionnement pendant les catastrophes............................................................... 5.10.5 Traitement des messages par la radio par mode paquets ........................................ 81 81 81 82 82 82 5.11 Groupes d'urgence radioamateurs........................................................................................ 5.11.1 Catastrophes et calamités naturelles........................................................................ 5.11.2 Trafic santé et bien-être........................................................................................... 5.11.3 Enquête sur les dommages matériels ...................................................................... 5.11.4 Accidents et dangers locaux.................................................................................... 5.11.5 Coopération avec les organismes de sécurité publique........................................... 5.11.6 Recherches et sauvetage.......................................................................................... 5.11.7 Communications des hôpitaux ................................................................................ 5.11.8 Déversement/fuites de produits chimiques toxiques............................................... 5.11.9 Incidents dus aux matières dangereuses.................................................................. 82 82 82 83 83 83 83 83 83 84 5.12 Communications de tiers dans le service radioamateur....................................................... 84 CHAPITRE 6 – Diffusion 6.1 Diffusions d'urgence sur les réseaux radiophoniques, télévisuels et câblés ........................ 85 6.2 Diffusion mobile d'urgence ................................................................................................. 85 CHAPITRE 7 – Coordination des télécommunications 7.1 Rôle du fonctionnaire chargé de la coordination des télécommunications ......................... 86 7.2 Idée d'entité de direction...................................................................................................... 86 Rapport sur la Question 16/2 49 PARTIE 2 CHAPITRE 1 Les aspects opérationnels des communications en cas de catastrophe Rapport sur la Question 16/2 1.1 Introduction Il convient que les aspects opérationnels des communications en cas de catastrophe soient compris par les usagers et les fournisseurs de communication. Les gestionnaires des opérations en cas de catastrophe sont souvent confrontés à la tâche consistant à définir les exigences et ils peuvent le faire le mieux lorsqu'ils savent ce qui est disponible et faisable dans les circonstances spécifiques d'une situation d'urgence. Les fournisseurs de services de télécommunication englobent les prestataires de services au public sur une base commerciale, les prestataires de services à des usagers spécifiques et, aussi, les opérateurs de réseaux spécialisés, le service radio amateur en particulier. Le présent Manuel répartit les questions liées aux opérations en deux groupes, en décrivant en premier lieu les modes de communication et les réseaux qui les utilisent. L'exposé de chaque mode commence par une description, spécialement conçue pour l'utilisateur, de son application aux communications en cas de catastrophe. Cette description est suivie d'informations, adressées au fournisseur du service respectif, sur le moment où le mode ou le réseau doit être appliqué aux communications en cas de catastrophe. Dans une annexe technique au présent manuel, des informations techniques pratiques sont fournies aux fonctionnaires des télécommunications, aux techniciens et opérateurs des organisations et institutions humanitaires ainsi qu'au personnel technique des prestataires de services. 1.2 Communications tactiques et stratégiques Les opérations d'urgence et les opérations militaires partagent un certain nombre de caractéristiques (par exemple: l'environnement physique et social, changeant rapidement et souvent de manière imprévisible, dans lequel elles ont lieu et la nécessité d'une prise de décision rapide à tous les niveaux). Leurs exigences en matière de communications sont donc comparables. Les termes militaires de communications tactiques et stratégiques décrivent le mieux ce qu'il faut prévoir en vue d'une réaction coordonnée par rapport à n'importe quelle urgence dont les implications ne sont pas strictement locales. 1.3 Normalisation et passerelles La normalisation est la solution idéale pour assurer la compatibilité et l'interaction parmi tous les réseaux de communication, au moins dans chacun des deux groupes, à savoir les communications tactiques et stratégiques. Cependant, la réaction à l'urgence est une activité temporaire et ceux qui y sont impliqués ne sont pas nécessairement des participants à une fonction de routine continue. Les passerelles ne sont pas l'idéal mais elles constituent jusqu'ici la seule solution réaliste. Dans les communications tactiques, cette fonction est en majeure partie assurée par une interface humaine – l'opérateur ou le gestionnaire des opérations en cas de catastrophe qui utilise plus d'un réseau en même temps. A cet effet, ils ont besoin d'une parfaite connaissance des structures et des procédures des réseaux concernés. Dans les communications stratégiques, des passerelles automatiques entre les différents systèmes ont été développées. Pour leur application, il est nécessaire que le personnel technique soit familiarisé avec la technologie et la manière dont elle peut être utilisée. 50 Rapport sur la Question 16/2 CHAPITRE 2 Modes de communication Pratiquement tous les modes de communication sur les réseaux publics et privés jouent un rôle dans les communications en cas de catastrophe. Les sections ci-après présentent un aperçu général des modes et des réseaux disponibles, qui sera exposé avec plus de détails dans l'annexe technique au présent Manuel. 2.1 Communications vocales La voix est le mode le plus commun qui convient le mieux à la transmission en temps réel de messages courts, avec les exigences minimales en matière d'équipement. Ses applications dans les communications en cas de catastrophe vont des liaisons par téléphone de campagne câblé point à point et des émetteursrécepteurs VHF et UHF mobiles ou portatifs aux téléphones par satellite, et comprennent également des systèmes d'interphonie ainsi que des diffusions par radio. Par contre, pour la transmission d'informations plus complexes, le manque de documentation permanente est une lacune importante de la voix. 2.2 Communications de données Les formes les plus anciennes de communication électronique ont en fait été les liaisons de données: le télégraphe a été utilisé bien avant le téléphone et la télégraphie sans fil a précédé la radiotéléphonie. Cependant, c'est seulement le développement des équipements électroniques interfaciaux et périphériques – en remplacement de l'opérateur traduisant entre le code Morse et le texte écrit – qui a rendu les communications de données pour de nombreuses applications supérieures à la voix. La première interface ayant des applications pratiques dans les communications en cas de catastrophe a été le téléscripteur ou machine télétype, communément appelée «Télex» dans l'usage commercial. Utilisé à l'origine dans les réseaux par câble, il l'a rapidement été dans les liaisons par radio. Alors que son utilisation est très fiable et présente un faible taux d'erreur sur les circuits par câble, son utilisation efficace par radio exige des signaux forts et des voies sans interférence. La nécessité de ressources techniques considérables pour assurer une liaison radiotélétype (RTTY) fiable a limité leur utilité dans les situations d'urgence. L'arrivée de la technologie numérique avancée a permis le développement de nouveaux modes de communication de données, ce qui élimine les carences du radiotélétype. La clé pour obtenir des liaisons exemptes d'erreur est la division des messages en «paquets» et la transmission automatique d'un accusé de réception correcte ou d'une demande de réémission. L'application générale la plus ancienne de la correction automatique d'erreur est le concept ARQ, abréviation de «automatic repeat request» (demande de répétition automatique), avec des protocoles de communication connus sous les appellations de TOR, SITOR et AMTOR. Dans le mode ARQ, un accusé de réception automatique ou une demande automatique de retransmission a lieu après toutes les trois lettres du message. Contrairement au radiotélétype (RTTY), où le nombre de stations recevant une transmission n'est pas limité, les signaux ARQ peuvent être échangés seulement entre deux partenaires à un instant donné quelconque. Afin de permettre la diffusion, une version quelque peu moins fiable, à savoir le mode de «correction d'erreur directe» (FEC) a été mise en place. Dans le mode FEC, chaque «paquet» de trois lettres est transmis deux fois; la station réceptrice compare automatiquement les deux transmissions et, si elles diffèrent, identifie le contenu correct le plus probable du «paquet». Rapport sur la Question 16/2 51 Des développements complémentaires ont abouti à des méthodes plus efficaces pour les communications de données sur des liaisons tant par câble que par radio. L'exemple le plus important en est le Protocole Internet (IP), qui a également été adopté comme la norme de communication commune à tous les partenaires majeurs de l'assistance humanitaire internationale. La «radio par mode paquets» est communément utilisée dans les ondes VHF et UHF. Son mode dérivé «Pactor» et divers autres modes propriétaires permettent, à travers des passerelles convenables, l'utilisation des liaisons radiodécamétriques pour pratiquement toutes les fonctions de l'Internet. Le fax a été le premier mode permettant la transmission d'images dans le format graphique papier, sur les réseaux par câble et, dans une mesure limitée, sur les réseaux sans fil. Dans sa forme initiale, l'image par fax est transportée sous forme de signaux analogiques sur des circuits vocaux tels que le réseau téléphonique. Comme pour les modes de données, le développement de la technologie numérique a abouti à de nouvelles formes de transfert d'images, y compris les applications sur la toile mondiale (World Wide Web). 52 Rapport sur la Question 16/2 CHAPITRE 3 Réseaux de communication publics Les réseaux sont structurés en fonction des besoins des usagers et en fonction de la technologie, par exemple le mode utilisé. Ils vont de la liaison la plus élémentaire entre deux points jusqu'à des structures s'étendant sur tout le globe, et ils peuvent être centralisés, chaque usager étant connecté à une forme de central, ou ils peuvent utiliser un nombre pratiquement infini d'options pour connecter un terminal à un autre. Le système de téléphone public est un exemple de la première option et l'Internet un exemple de la seconde. 3.1 Le Réseau téléphonique public commuté (RTPC) Le Réseau téléphonique public commuté (RTPC) a subi des modifications sur le plan politique et technique, ces dernières années. Jusqu'à une période récente, les réseaux publics dans de nombreux pays appartenaient à de grands monopoles gouvernementaux, tels que les postes, qui en étaient les opérateurs. De nos jours, des membres individuels du public et du monde des affaires sont souvent libres de choisir entre les services téléphoniques proposés par plusieurs prestataires de services locaux. Toutefois, si le service offert est complètement interconnecté à tous les autres téléphones, le système fait partie du réseau RTPC, que l'on appelle parfois le «Service téléphonique traditionnel» (POTS). Dans bien des cas, la centralisation des fonctions critiques a abouti à des vulnérabilités considérablement élevées. Les principales parties d'un réseau RTPC sont comme suit: 3.1.1 Distribution locale Les systèmes de distribution locale relient les utilisateurs finals aux commutateurs qui se trouvent, en général, à une distance de l'ordre de 10 à 20 km. Le système de câble local est un réseau comportant un câble à paires torsadées non blindé par ligne téléphonique. Une paire distincte est prévue en permanence pour chaque ligne, tout le long du trajet allant du client au commutateur le plus proche. Dans bien d'endroits, les lignes téléphoniques sont des fils ou câbles aériens comportant plusieurs paires de fils, suspendus à des poteaux. Ces voies d'acheminement à poteaux sont vulnérables à des catastrophes impliquant des vents violents ou des séismes. Dans bien des cas, toutefois, les câbles sont enterrés sur tout ou partie du chemin, soit directement dans le sol soit dans des systèmes de gaines, ce qui réduit leur vulnérabilité. Un facteur est que le système de câble local représente un investissement si énorme que les opérateurs de systèmes concurrents peuvent bien utiliser le même système de câble local pour leur accès. Par conséquent, un dommage causé au système de câble local peut affecter au même degré tous les opérateurs. La boucle locale utilisée dans le réseau RTPC présente l'avantage que le téléphone dans les locaux de l'abonné est alimenté électriquement par une batterie située au central téléphonique. Si l'alimentation dans les locaux de l'abonné est coupée, le téléphone fonctionnera encore tant que les lignes ne sont pas endommagées. Toutefois, cela ne s'applique pas aux téléphones sans fil, qui ont une base d'attache domestique alimentée par la puissance domestique. Il convient d'encourager vivement chaque domicile et chaque entreprise à posséder au moins un téléphone alimenté par batterie centrale de type normal. Rapport sur la Question 16/2 3.1.2 53 Boucle locale sans fil (WLL) Un certain nombre d'opérateurs offrent l'accès à leurs commutateurs par l'intermédiaire de solutions de «boucles locales sans fil (WLL)». Ces boucles s'appuient sur les stations radio fixes (RBS) locales. Celles-ci assurent une liaison radio vers des unités radio fixes dans le domicile, qui à leur tour assurent la connexion vers des téléphones situés dans le domicile ou dans les entreprises. L'usager peut ne pas connaître les détails d'un tel dispositif. Un autre problème avec les boucles WLL est que, si l'alimentation électrique du bâtiment est coupée, l'unité de radio ne peut pas fonctionner sauf si une autre alimentation électrique fiable est délivrée. Les stations RBS ont certes des alimentations de secours mais sont connectées au commutateur par un système de câble local ou par des lignes privées transportant également d'autres services, mais sur la même voie d'acheminement que les câbles locaux. Dans d'autres cas, la station fixe est connectée par une liaison hertzienne spécialisée. Néanmoins, l'accès sans fil peut dans certains cas être moins vulnérable à des dégâts matériels que les voies d'acheminement à poteaux, à la condition que l'alimentation électrique de secours fasse partie de la configuration. Les «lignes privées» utilisées par les systèmes d'entreprise sont souvent acheminées par un système de câble local des réseaux publics. Dans ces cas, des dégâts causés à ce dernier vont probablement affecter tout système de communication par câble situé dans la zone, qu'il soit public ou privé. 3.1.3 Commutateurs Les commutateurs sont le centre d'un système téléphonique et, aussi, ils présentent le risque le plus grave à cause de leur tendance à la surcharge. Dans une zone résidentielle, un commutateur est calculé pour prendre en charge des appels simultanés émanant de 5% environ des abonnés. Dans une zone d'affaires, ce chiffre peut atteindre 10%. Lorsque la charge est supérieure à celle qu'il peut traiter par conception, le commutateur se «bloque». Des catastrophes, et même des événements locaux tout à fait sans gravité, peuvent générer un très gros volume de trafic à l'intérieur, en provenance et en direction de la zone affectée, principalement au fur et à mesure que les abonnés recherchent des informations sur leurs amis et sur leurs parents. Ce seul trafic est susceptible de bloquer un commutateur à la suite d'une catastrophe. Les commutateurs modernes sont souvent du type numérique informatisé. Toutefois, quelle que soit la construction du commutateur, il a besoin d'énergie, d'un abri tel qu'un bâtiment et souvent de climatisation également. Toute perturbation ou dégât affectant des éléments supports provoquera la défaillance du commutateur. 3.1.4 Système de jonctions et de signalisation Les lignes de jonction sont des liaisons entre des commutateurs. Les jonctions sont souvent multiplexées et peuvent donc transporter des centaines ou des milliers d'appels. Elles peuvent être réalisées par des liaisons radio hertziennes, par câbles de cuivre ou par fibres optiques, selon la capacité prévue de la liaison. La tendance est à l'utilisation de systèmes à fibres optiques par des opérateurs de grande échelle. Si les câbles sont enterrés, comme ils le sont souvent, ils sont moins vulnérables. Les opérateurs relient normalement les commutateurs par le biais de leur propre système de jonctions. Le fait de disposer de plusieurs comptes auprès de plusieurs opérateurs différents peut augmenter la capacité de survie d'un système en cas d'urgence. Parfois, les opérateurs concurrents ont construit leur propre système de jonctions mais ils ont parfois tout simplement acheté leur capacité sur d'autres systèmes. Même des systèmes en concurrence commerciale peuvent donc partager leurs infrastructures physiques. Une façon de transporter des jonctions est d'utiliser les ondes hertziennes. Il s'agit de liaisons radio entre des stations de relais, installées généralement sur des collines ou des bâtiments élevés. Les stations de relais hertziennes se trouvent donc souvent dans des endroits exposés et peuvent parfois être difficiles à atteindre. Après une catastrophe, un certain nombre de sites peuvent être en fait accessibles seulement par hélicoptère et, étant donné l'importance des communications, l'argent dépensé à vérifier régulièrement les installations distantes est un bon investissement de l'opérateur du système. 54 Rapport sur la Question 16/2 Le «Système de signalisation No 7» constitue un cas spécial. Selon sa structure, il est nécessaire que les commutateurs se «parlent» les uns aux autres afin d'établir des appels. A cet effet, il existe un service spécialisé appelé Système SS 7 ou CCITT 7, similaire à un système Internet privé à utiliser exclusivement par des commutateurs. Bien que distinctes du point de vue logique, les voies du système SS 7 sont souvent multiplexées en circuits de jonctions et sont transportées par la même transmission que les circuits de jonctions. En cas de défaillance du système SS 7, il n'est plus possible d'effectuer des appels entre les commutateurs. En général, les appels locaux sur le même commutateur ne sont pas touchés. 3.1.5 Réseau numérique à intégration de services (RNIS) Le Réseau numérique à intégration de services (RNIS) est un service de données transparent à commutation de circuit à grande vitesse, qui peuvent être augmentées par pas de 64 kbit/s. Une utilisation typique en est la vidéoconférence pour des applications techniques et scientifiques. Généralement, le même commutateur transportant la téléphonie commute également le réseau RNIS, et le réseau de jonctions est le même. Le RNIS n'est ni plus ni moins fiable que la téléphonie car il partage la même infrastructure. 3.1.6 Télex L'importance du télex baisse au fur et à mesure que les messages textuels sont de plus en plus traités par mél. Néanmoins, le télex demeure un outil important. Le système de télex est constitué de téléscripteurs ou de terminaux d'ordinateur spécialement programmés, reliés les uns aux autres par le réseau de télex international. Les messages par télex sont constitués uniquement de lettres majuscules de l'alphabet latin et d'un certain nombre de symboles de ponctuations, utilisant le code Baudot UIT-ITA2. Le télex a deux avantages distincts sur les autres systèmes. Le plus important est que le télex est commuté par le biais d'un commutateur différent de celui utilisé dans les appels téléphoniques, ce qui est pertinent en cas de catastrophe lorsqu'il est possible que le commutateur téléphonique soit surchargé. L'accès à l'Internet est réalisé le biais de modems, qui appellent le point local du prestataire de services sur le système téléphonique et, ici aussi, le télex peut servir d'alternative. Naturellement, toute téléimprimante nécessite une alimentation électrique locale. Les centraux de télex sont conçus pour traiter des hauts niveaux de trafic et ne sont pas généralement surchargés par des appels privés. Le télex présente également une caractéristique de mode différé optionnel qui transmet les messages dès que possible, s'il n'est pas possible de le faire en temps réel. Ainsi, il y a de bonne de chance de percer avec le télex. Le mode différé est également appliqué aux connexions par télex avec les terminaux de la Norme C du système Inmarsat, qui ont un rôle important dans les communications en cas de catastrophe. Une faiblesse du télex est que de nos jours les signaux sont souvent envoyés sur les mêmes systèmes de transmissions que la plupart des autres services. Par conséquent, une perte de transmission peut provoquer une perte de télex. D'autre part, les circuits de télex sont définis sur des jonctions de manière permanente, de sorte qu'ils ont une capacité réservée en permanence et sont moins susceptibles d'être affectés par un encombrement du système de jonctions. Le télex est un système de «bande étroite», ce qui signifie qu'il demande très peu de ressources du système pour fonctionner. Il est facile et bon marché de fournir, en variante, une connectivité sans fil aux terminaux de télex. En théorie, le service télex insensible aux catastrophes est possible mais, dans la pratique, cela dépend des instructions fournies au planificateur de réseau, quant à la question de savoir si la fiabilité est le facteur majeur ou si c'est l'économie. Il convient de relier directement les terminaux de télex au réseau de télex et non par le biais d'un prestataire de services intermédiaire, sinon ils peuvent utiliser le service de modem commuté par l'intermédiaire du réseau RTPC, perdant ainsi leur avantage majeur. Les machines de télex permettent un dialogue en temps réel entre deux usagers, ce qui ne s'applique pas à l'émission et à la réception de messages de télex par le biais d'un terminal d'ordinateur qui est possible auprès d'un certain nombre de prestataires de services; une telle connexion se présente toujours sous la forme d'un système de mise en Rapport sur la Question 16/2 55 mémoire et d'acheminement ultérieur. Elle ne permet donc pas un tel dialogue et les téléscripteurs réels peuvent être préférables en cas d'urgence. Dans plusieurs parties du monde, le télex se voit retirer du service en faveur de systèmes plus «modernes» qui sont certes plus rapides mais de loin moins robustes pour servir des besoins de communications en cas de catastrophe. 3.1.7 Télécopie (Fax) Une machine de télécopie est constituée d'un scanner, d'un calculateur, d'un modem et d'une imprimante dans un seul ensemble. Cette combinaison permet l'émission et la réception d'images graphiques, indépendamment de leur contenu. Un document entre les mains d'un usager peut donc être mis à la disposition d'un autre usager en temps réel. Dans le domaine des communications en cas de catastrophe, on en trouve des applications aux dessins et cartes ainsi qu'aux listes, tableaux ou documents compilés manuellement par un tiers, dans un langage qui n'est pas nécessairement compréhensible à l'envoyeur et/ou en utilisant un alphabet non disponible dans les liaisons existantes pour les communications de textes. Pour les communications en cas de catastrophe, il pourrait s'agir toutefois d'un avantage comme d'un inconvénient – une connexion par fax peut tenter les responsables des opérations d'urgence à faire suivre l'information «telle quelle» plutôt que de communiquer les résultats concis de leur évaluation de la situation. Une faiblesse générale du fax est qu'il est habituellement transporté sur les circuits téléphoniques normaux. Il en subit donc toutes les lacunes. En outre, toutes les machines de fax dépendent d'une alimentation électrique externe et, à moins de les connecter directement au réseau public, du fonctionnement des équipements connexes dans les locaux de l'usager. 3.1.8 Le réseau mobile terrestre public (RMTP) Le Réseau mobile terrestre public (RMTP) comprend les réseaux de téléphone cellulaire, les systèmes de communications personnelles (PCS) et ce qu'on appelle les systèmes de données sans fil de troisième génération. Les réseaux RMTP sont constitués de stations radio fixes, qui fournissent un réseau de ce qu'on appelle cellules, et les terminaux mobiles, qui sont de plus en plus du type portatif. Les usagers peuvent se déplacer à l'intérieur d'une zone couverte par les cellules d'un prestataire de services, et les liaisons sont transmises automatiquement d'une cellule à l'autre. En fonction des caractéristiques communes aux divers systèmes utilisés et en fonction des accords commerciaux entre prestataires de services, les abonnés peuvent «errer» à l'intérieur des zones couvertes par d'autres fournisseurs que celui auprès duquel le terminal est enregistré. Les réseaux RMTP offrent la connectivité à n'importe quel réseau de téléphone ou de données, n'importe où dans le monde. La couverture des réseaux RMTP est limitée aux zones à population dense, principalement dans les pays en développement; une couverture globale ne serait pas faisable économiquement, pour l'instant. Beaucoup de types de terminaux offrent également des vitesses de données lentes, généralement à la vitesse de 9,6 kbit/s. Les services de données par paquets à grande vitesse de «troisième génération» deviennent disponibles, permettant des débits comparables à ceux sur les réseaux par câbles. Les systèmes 3G sont conçus pour fournir la connexion à des services de l'Internet tels que le mél et la toile mondiale (WWW). Avec ces services, les terminaux restent connectés à l'Internet en permanence, ce qui leur procure un accès très rapide aux données. En fonction de l'accord avec le prestataire de services, l'usager pourrait payer pour les données réellement envoyées ou reçues de l'Internet, contrairement aux taxations au temps dans les connexions téléphoniques normales. Des services comme le Protocole d'accès sans fil (WAP) sont transportés sur des réseaux RMTP. Le protocole WAP est un protocole pour la transmission de formes spéciales de pages web, sur des liaisons sans fil de faible capacité, et pour l'affichage sur de petits écrans de téléphone. Un bonus de ces systèmes est que l'abonné n'a pas besoin d'installer une infrastructure supplémentaire. 56 Rapport sur la Question 16/2 Les cellules dans les zones urbaines sont conçues chacune pour une capacité d'environ 30 appels téléphoniques simultanés alors que les cellules dans les zones rurales ayant une densité de population inférieure ont une capacité de seulement 6 ou 7 voies de trafic. Les planificateurs de réseaux cellulaires mesurent le trafic généré par chaque type de zone, rurale ou urbaine, et font correspondre la capacité en conséquence. La taille des cellules peut varier de 35 km en zone rurale à très faible densité de trafic jusqu'à 100 mètres ou moins dans une zone urbaine à capacité élevée. Le chiffre type est qu'une station de services doit se trouver dans un rayon de 5 km de l'abonné. Les stations radio fixes (RBS) sont coûteuses et les opérateurs commerciaux fournissent une capacité suffisante pour leur besoin actuel mais non pour le type de trafic de pointe nécessaire à l'utilisation de communications en cas de catastrophe. Malgré sa commodité, le réseau RMTP ne convient donc pas en cas de catastrophe. C'est la raison pour laquelle des services comme les pompiers et la police ont des systèmes de radio privée et ne comptent pas seulement sur les services cellulaires. Les stations radio fixes à proximité ou dans le site de la catastrophe sont vulnérables aux dégâts tout comme les autres structures. Les inondations peuvent endommager les équipements dans les armoires situées au sol, les séismes et les orages peuvent endommager les antennes sur les tours et d'autres structures. Un problème grave est que chaque station est connectée à des systèmes locaux d'alimentation électrique, qui peuvent être endommagés dans la catastrophe. Une station RBS type a la capacité de continuer sur une batterie de secours pendant environ 8 heures. De nombreuses stations ont la capacité à être connectées à un générateur mobile mais ce dernier doit être apporté sur le site. Très peu de stations RBS ont des générateurs montés de façon permanente. Un problème supplémentaire est que les stations fixes peuvent ne pas fonctionner de façon autonome et qu'il faut donc les connecter à un Contrôle des stations de base (BSC), ou à un Centre de communication mobile (CCM). Cette liaison est assurée par une ligne souterraine ou par une liaison hertzienne. Comme toute cellule ou station RBS, les Centres de communication mobile (CCM) ont une capacité limitée. Ils sont également conçus pour la charge de trafic moyenne attendue dans la zone mais non pour des besoins supplémentaires tels que ceux qui sont généralement rencontrés après une catastrophe. Afin de régler ce problème, un programme logiciel avancé, dans un certain nombre de commutateurs, peut en option identifier certains usagers hautement prioritaires et leur attribuer un canal aux dépens de ceux qui ont des priorités moins élevées. Dans le système GSM par exemple, des abonnés peuvent être désignés comme ayant une «capacité prioritaire». Les appels provenant d'usagers à priorité plus faible seront abandonnés au profit d'appels provenant d'un usager ayant un statut de vulnérabilité prépondérante. L'application effective de ces schémas de priorité dépend moins des possibilités techniques que du contexte de la réglementation. Dans un marché fortement concurrentiel, un abonné à qui l'on dit qu'il pourrait avoir moins de chances de passer des appels en cas d'urgence va vraisemblablement préférer un prestataire de services qui n'a pas mis en place un mécanisme de priorité. Seule une application obligatoire, sur la base de critères identiques pour les abonnés prioritaires de tous les réseaux fonctionnant dans une zone donnée, peut garantir l'application de cette caractéristique de réseau fortement souhaitable. 3.1.9 Cellules sur roues (COW) La capacité d'un réseau RMTP peut être dopée d'une manière spécifique en ajoutant des stations de cellules temporaires, appelées «cellules sur roues» (COW). Ces dernières peuvent remplacer une station RBS défaillante, doper le système ou fournir le service dans une zone qui n'est pas couverte normalement. Le problème principal avec leur déploiement est la nécessité de lier les appels à un commutateur approprié. Il va sans dire que la COW doit nécessairement être du même système que celui utilisé par les stations mobiles de la zone et fonctionner dans la même bande de fréquences. La COW également doit nécessairement être connectée à un commutateur qui lui est compatible, donc en général fabriqué par le même constructeur. Dans des conditions extrêmes, la COW peut être connectée à des commutateurs distants situés dans un autre pays par le biais de liaisons VSAT. Rapport sur la Question 16/2 3.2 57 Systèmes mobiles par satellite Au moment de la rédaction du présent document, le système mobile par satellite le plus largement utilisé est le système Inmarsat. Créé à l'origine sous les auspices de l'Organisation maritime internationale (OMI) à la fin des années 1970, au service de la communauté de navigation internationale, l'Inmarsat est désormais une entreprise privatisée offrant ses services à des clients mobiles maritimes, aéronautiques et terrestres. Le système Inmarsat est constitué de satellites géostationnaires, qui relient des terminaux mobiles par le biais de Stations terre-terre (LES) au réseau RTPC et à d'autres réseaux. Quatre satellites couvrent la surface de la terre, à l'exception des régions polaires. Les stations LES sont situées dans plusieurs pays et à l'intérieur de la portée d'un ou plusieurs satellites. Une liaison de communication engage dans tous les cas au moins une station LES, qui est le prestataire de services effectif. On trouvera ci-après une liste de types ou de «Normes» applicables aux communications terrestres en cas de catastrophe. 3.2.1 Norme M et mini-M Les normes M et mini-M sont les plus populaires en matière d'applications à grande mobilité. Les terminaux mini-M ont approximativement la taille et le poids d'un ordinateur portable tandis que les terminaux de norme M ont la taille d'un porte-documents. Ils permettent des connexions avec n'importe abonné du réseau RTPC à travers le monde, y compris d'autres terminaux mobiles par satellite. La plupart des terminaux M et mini-M ont un port de connexion à une machine de fax ainsi qu'un port de données RS-232 pour une vitesse relativement faible de 2,4 kbit/s. De nombreux abonnés utilisent ce type de terminal pour leur courrier électronique au moyen d'une connexion du protocole POP. Comme d'autres terminaux Inmarsat, les versions portatives doivent être déballées et montées d'une manière qui permette à l'antenne de «voir» le satellite. La plupart des terminaux comportent des dispositions permettant de localiser à distance l'antenne à l'extérieur. Ils ne peuvent pas être utilisés sur un véhicule en mouvement sauf s'ils sont équipés d'antennes spéciales qui compensent le mouvement du véhicule. Tandis que les terminaux de norme M peuvent fonctionner partout à l'intérieur des zones couvertes par les satellites Inmarsat, l'utilisation des terminaux mini-M est limitée à la couverture assurée par les faisceaux ponctuels de ces satellites. Ces faisceaux ponctuels, qui permettent l'utilisation de terminaux de plus faible puissance et de plus petites antennes, couvrent la majeure partie des masses continentales mais pas les océans et plusieurs des îles plus petites ou plus isolées. Des développements complémentaires, y compris le service RNIS mobile, peuvent servir d'extensions de la norme M. 3.2.2 Norme C La norme C est un système de mise en mémoire et d'acheminement ultérieur de texte, beaucoup utilisé en mer pour les messages de détresse. Elle transmet le courrier électronique ainsi que le télex. Elle peut être utilisée pour des courriers électroniques courts mais ne convient pas au transport de gros fichiers de données tels que des documents joints. Les terminaux ont généralement la taille d'un porte-documents mais nécessitent des équipements terminaux (comme un ordinateur portable par exemple) pour traiter le texte. Un certain nombre de prestataires de services transmettent les messages, des terminaux de la norme C à des machines de télécopie (mais pas dans l'autre sens). Il n'y a pas de capacité vocale dans ce système. 3.2.3 Norme B Le service selon la norme B offre des données RNIS à 64 kbit/s. Les équipements selon la norme B sont beaucoup plus gros et plus lourds que les terminaux de la norme M et ont été prévus principalement pour une utilisation fixe, dans laquelle ils peuvent procurer la connectivité pour plusieurs usagers simultanés ou pour des applications de données à débit élevé. 58 3.2.4 Rapport sur la Question 16/2 Norme A La norme A est la première génération des terminaux mobiles par satellite de l'Inmarsat et offre des connexions vocales, de données et par télex, en mode analogique. Les unités de la norme A sont généralement beaucoup plus grosses et beaucoup plus lourdes que les terminaux récents. 3.3 Systèmes mobiles de communications personnelles par satellite (GMPCS) La caractéristique distinctive des Systèmes mobiles de communications personnelles par satellite (GMPCS) par rapport à d'autres systèmes mobiles par satellite est que les terminaux sont très petits et très légers, de la taille et du poids d'un téléphone cellulaire normal. Les systèmes GMPCS comprennent Globalstar et ICO. A cause de l'utilisation d'antenne à faible rendement sur les terminaux, des signaux forts provenant des satellites sont nécessaires. On les obtient en utilisant de grandes antennes à gain élevé sur des satellites en orbite géostationnaire ou en utilisant des satellites à orbite basse terrestre (LEO). Les terminaux qui sont du type bimode sont à même d'assurer une connexion à un satellite ou à un service terrestre. Normalement, les utilisateurs programment le terminal afin de se connecter à un système cellulaire lorsqu'il est disponible mais se connectent automatiquement au système par satellite lorsque la couverture cellulaire n'existe pas. En général, cela peut se produire lorsqu'on opère à l'extérieur de la zone de couverture d'un service terrestre ou si le système terrestre est interrompu ou surchargé comme après une catastrophe. Un important segment de marché pour les systèmes GMPCS est représenté par les opérations liées aux terminaux, par exemple les cabines téléphoniques publiques situées en des endroits sans infrastructure de lignes. Une autre application est le «renversement de direction» de circuits vocaux, pour lequel il est nécessaire que l'abonné ait un compte auprès d'un prestataire de services terrestre ou auprès d'un prestataire de services qui a, à son tour, des accords avec à la fois un prestataire de segment dans l'espace et des fournisseurs terrestres. Pour que cela fonctionne, des dispositifs itinérants tels que décrits pour les réseaux RMTP sont nécessaires. Toutes ces opérations sont automatiques et les usagers n'ont donc pas de mesure à prendre pour passer de l'espace au cellulaire et inversement. Les téléphones spatiaux/cellulaires bimodes, qui utilisent automatiquement les liaisons par satellite à chaque fois que la couverture cellulaire n'est pas disponible, éliminent la nécessité de placer le terminal ou téléphone à l'extérieur ou d'utiliser une antenne distante. Ils permettent également des économies en communiquant, lorsque c'est possible, par le biais de services terrestres au lieu des systèmes par satellite qui sont généralement plus coûteux. 3.4 Systèmes mobiles par satellite à couverture régionale Alors que les systèmes décrits précédemment offrent une couverture globale, les systèmes régionaux couvrent généralement une région telle que les Etats-Unis d'Amérique ou le sous-continent asiatique. Aucun service n'est possible à l'extérieur de la couverture ou de «l'empreinte de pas» du satellite. Les systèmes actuels sont Motient (anciennement American Mobile Satellite Corporation AMSC) pour les Etats-Unis d'Amérique, Thuraya pour le Moyen-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie du Sud-Ouest, et ACeS pour l'Asie. Les types des terminaux varient, des terminaux de la taille d'ordinateur portable étant utilisés pour AMSC et des types personnels portatifs l'étant pour Thuraya et pour ACeS. D'autres caractéristiques, telles que la possibilité d'utiliser des systèmes cellulaires terrestres, quand et où ils sont disponibles, sont similaires à celles des systèmes GMPCS. 3.5 L'Internet L'Internet fournit de plus en plus d'appui aux fonctions et opérations majeures des organisations, y compris celles qui présentent des distances significatives entre les sièges et les bureaux de terrain. Pour les travailleurs gouvernementaux dans les opérations de secours, l'accès à l'Internet permet des mises à jour permanentes des informations sur les catastrophes, l'inventaire des ressources humaines et matérielles disponibles en vue de la réaction à ces catastrophes ainsi que les conseils techniques les plus récents. En tant que caractéristique importante, les messages peuvent également être distribués à des groupes de destinataires présélectionnés, permettant ainsi une forme de diffusions ciblées. Rapport sur la Question 16/2 3.5.1 59 Structure de l'Internet L'Internet est un réseau mondial de réseaux. La communication parmi ces réseaux est facilitée par des normes ouvertes communes, ce qu'on appelle les protocoles «TCP/IP». La première application encore indispensable de l'Internet est le courrier électronique, la possibilité de tout usager connecté d'échanger des messages avec n'importe quel autre utilisateur connecté. Au début des années 1990, un virage majeur dans la nature et l'utilisation de l'Internet s'est produit avec l'émergence de la toile mondiale (www) ou «web», développée initialement à Genève au Centre européen pour la recherche nucléaire (CERN). Le web est un réseau de serveurs fournissant des informations hypermédias – non seulement des textes mais aussi des graphiques, du son, de la vidéo et de l'animation – avec des liaisons entre différents domaines de contenu. Un système d'instructions intégrées appelé Langage de marquage pour hypertexte (HTML) est utilisé pour afficher localement les documents. La façon prédominante de structurer les informations du web est la «page». En cliquant sur des hyperliens préprogrammés, l'utilisateur peut naviguer parmi des pages qui constituent un site web unique et commuter sur d'autres sites. Les procédures d'affichage et de navigation sont compatibles entre les sites, si bien que l'emplacement géographique réel de l'ordinateur sur lequel les informations sont mémorisées est transparent à l'utilisateur. Une conséquence de l'émergence du web comme principale application de l'Internet est qu'il nécessite des vitesses plus élevées (au moins 28,8 kbit/s en général) pour un accès en ligne. Une fonctionnalité utile de l'Internet est toutefois encore disponible à des vitesses de connexion inférieures, sans l'utilisation d'un logiciel de navigation du web. On a l'impression que le web a submergé et incorporé toutes les autres capacités et fonctionnalités de l'Internet. Bien que cela soit vrai du point de vue de la pratique, d'autres fonctionnalités telles que le protocole de transfert de fichiers (ftp), la connexion distante (telnet) et le courrier électronique sont indépendantes du web et peuvent parfaitement convenir à de nombreux besoins. En fait, toutes ces trois importantes applications de l'information sur l'Internet peuvent fonctionner de façon satisfaisante sur des ordinateurs faisant tourner des systèmes d'exploitation plus anciens. Il convient que les utilisateurs soient conscients de l'utilité potentielle d'ordinateurs tels que ceux ayant un processeur central du type «386». Après une catastrophe, il peut ne pas être possible d'accéder à une connectivité directe à grande largeur de bande. Même lorsqu'aucune catastrophe ne s'est produite, il existe de nombreux endroits où la connectivité directe à l'Internet, moderne et à grande vitesse (système DSL ou RNIS par exemple) n'est pas disponible ou est trop coûteuse. Il est toujours possible de réaliser un échange d'informations Internet utiles à l'aide de ftp, de telnet et du courrier électronique, en utilisant des connexions via modem à faible débit (9,6 kbit/s ou moins par exemple) à des comptes auprès d'ordinateurs hôtes. De tels services existent encore et hébergent généralement une connexion à l'Internet à des instants spécifiques seulement, c'est-à-dire que les connexions ne sont pas permanentes. Il existe même des serveurs «courrier web» disponibles, permettant la récupération du contenu textuel de sites web par l'intermédiaire du courrier électronique. Les systèmes de satellites LEO de messagerie différée peuvent rendre accessibles les informations de courrier électronique à des zones isolées. Une future possibilité est d'incorporer le protocole d'accès sans fil (WAP), conçu pour les systèmes cellulaires des réseaux RMTP, dans des systèmes de courrier électronique à faible largeur de bande pour la transmission du contenu graphique et hypermédia de sites web. On prévoit que ces systèmes seront opérationnels dans un petit nombre de zones dans un futur proche, au moins en Europe et en Amérique du Nord, en 2002 au plus tard. 3.5.2 Forces et faiblesses de l'Internet La puissance de l'Internet, en particulier celle des services d'informations du web, continue à croître et à évoluer. L'intégration des technologies sans fil (y compris celles qui s'appuient sur les satellites) et celle de la capacité à haut débit sur les connexions par câble vont fournir aux gestionnaires des opérations en cas de catastrophe un accès à beaucoup plus de ressources d'informations qu'ils ne vont vraisemblablement utiliser. Dans le contexte des communications en cas de catastrophe, il est essentiel de toujours garder à l'esprit que le personnel sur le site d'une catastrophe a, d'abord et avant tout, la tâche de sauver des vies. Une information spécifique pourrait énormément améliorer l'utilisation efficace et 60 Rapport sur la Question 16/2 rentable des ressources disponibles et les gestionnaires des opérations en cas de catastrophe sont des gestionnaires et non des journalistes reporters. On ne peut pas attendre du personnel des secours sur site qu'il conduise des recherches d'information. Il ne dispose ni du temps ni, dans la plupart des cas, des équipements périphériques nécessaires au traitement d'une telle information dans un format applicable directement aux opérations sur le terrain. Il en va de même pour la mise à disposition de l'information provenant d'un lieu sinistré et les observations relatives à l'utilisation de la télécopie s'appliquent également à d'autres modes de communication graphiques. Une sélection soigneuse des options potentiellement disponibles demeure toujours nécessaire mais les éléments suivants pourraient être incorporés: − l'envoi et la réception de courrier électronique et l'utilisation de répertoires sur le web afin de localiser des collègues, des fournisseurs, des organisations gouvernementales et non gouvernementales qui peuvent fournir de l'assistance; − le suivi de nouvelles et d'informations météorologiques provenant d'un grand nombre de prestataires gouvernementaux, universitaires et commerciaux; − la recherche d'informations géopolitiques à jour, de cartes géographiques, d'avertissements relatifs aux voyages, de bulletins et de rapports d'état pour les zones concernées; − l'accès à des bases de données médicales afin de recueillir des informations sur tous les sujets allant des invasions de parasites aux blessures graves; − la participation à des listes de discussion mondiales afin d'échanger les leçons apprises et de coordonner les activités; − la lecture et le commentaire du contenu de divers sites web gouvernementaux et non gouvernementaux afin d'entretenir la sensibilisation au large tableau de la situation et à la manière dont les autres décrivent la catastrophe; − l'enregistrement des réfugiés et des personnes déplacées afin de faciliter la réunification avec leurs parents et amis; − la communication de nouvelles autres que celles liées aux catastrophes, des résultats sportifs par exemple, comme moyen de renforcer le moral. Une stratégie de ressources d'informations basée sur l'Internet présente également un certain nombre d'inconvénients. Dans la section précédente, il a été mentionné l'identification du web, avec sa grande largeur de bande et sa connectivité coûteuse, comme la seule source de création et de récupération d'informations utiles basées sur l'Internet. Il convient de toujours étudier la possibilité de maintenir des systèmes plus anciens (connectivité non Windows, à largeur de bande non étendue) comme option de redondance en cas de défaillance des systèmes. Le fait qu'un équipement ne soit pas de la technologie la plus récente ne veut pas dire qu'il n'a aucune utilité car, dans des situations critiques, le contraire peut être vrai. La vulnérabilité des circuits transistorisés à l'électricité statique et aux impulsions électromagnétiques a été surmontée dans un certain nombre de cas par la réintroduction de la technologie des tubes à vide, dans des applications critiques. D'autres inconvénients éventuels de l'échange d'information basé sur l'Internet sont énumérés dans la section ci-après. 3.5.2.1 Confidentialité Le caractère ouvert et la portée mondiale de l'Internet – ces mêmes caractéristiques qui le rendent attractif pour les utilisateurs dans une situation de catastrophe – menacent la sécurité des données transférées par l'Internet. Un certain nombre d'institutions utilisent des réseaux de données sécurisés qui contournent entièrement l'Internet sauf en dernier ressort. Etant donné la sensibilité des informations, spécialement en cas d'urgence complexe, le tripotage des données peut constituer un problème. La large propagation sans méfiance et parfois accidentelle de virus informatiques dévastateurs est susceptible d'affecter gravement les systèmes informatiques en des points cruciaux juste au moment où on en a le plus besoin. Rapport sur la Question 16/2 61 3.5.2.2 Disponibilité Il y a des limites à la robustesse et à la flexibilité du réseau. Etant donné qu'un trafic de plus en plus important passe dans l'Internet, il devient une cible attrayante à interrompre pour des groupes extrémistes. Outre les actions délibérées et malveillantes, un refus de services peut résulter d'une demande excessive. Des exemples se sont déjà produits aux Etats-Unis d'Amérique où des serveurs fournissant des informations sur les orages provenant du Centre «National Hurricane Center» et de l'administration «National Oceanographic and Atmospheric Administration» ont été submergés par la demande pendant l'approche d'un orage. Pendant une crise, c'est souvent la source d'information la plus valable qui se trouve être la plus difficile à atteindre. 3.5.2.3 Précision La qualité des informations récupérées sur l'Internet n'est probablement ni meilleure ni pire que celle des informations disponibles par le biais de voies plus traditionnelles. L'Internet diminue le délai entre les événements et l'expédition d'informations les concernant, et il permet à ses utilisateurs de mettre à disposition leurs compétences et observations pratiquement sans le moindre délai. Toutefois, ce marché libre des informations accorde un rôle égal à une information de valeur et à un matériau dépassé, biaisé, trompeur ou tout simplement erroné. Il faut donc que l'utilisateur d'informations fournies par des ressources de l'Internet vérifie dans chaque cas la source d'une information avant de la transmettre ou de l'appliquer. 3.5.2.4 Maintenabilité Un des virages de paradigmes clés réalisé par l'Internet est un accès à l'information déclenché par l'usager et régi par la demande. Tandis que ce changement peut accroître l'efficacité d'une organisation et abaisser les coûts de distribution de l'information, les informations doivent être traitées. Il est nécessaire que les planificateurs du web définissent soigneusement la portée des informations à héberger, vérifient leur fiabilité, les structurent d'une façon logique qui en facilite l'accès et assurent leur mise à jour rapide et permanente. La disponibilité des ressources humaines pour ces tâches est aussi importante que l'acquisition de l'information elle-même. 62 Rapport sur la Question 16/2 CHAPITRE 4 Réseaux privés Le terme «réseau privé» est utilisé pour décrire des installations de communication disponibles à des utilisateurs spécialisés. Elles servent les communications en cas de catastrophe de deux façons: 1) les utilisateurs ordinaires du réseau peuvent être engagés dans des activités liées à la réaction aux catastrophes; et 2) le réseau peut transporter temporairement des informations en provenance et en direction d'utilisateurs, qui ne font pas partie du groupe d'utilisateurs spécialisés pour lequel le réseau spécifique a été conçu. Dans la section suivante, les deux options sont examinées pour des services qui sont probablement plus susceptibles d'être impliqués dans les communications en cas de catastrophe. Des réseaux privés autres que ceux mentionnés ci-après peuvent offrir des possibilités similaires. 4.1 Service radiomaritime Le service radiomaritime utilise des fréquences sur des canaux définis à l'intérieur des bandes de fréquences qui lui sont attribuées. Il est peu probable qu'une station d'un autre service ait besoin de communiquer directement avec un navire en mer mais, néanmoins, le service radiomaritime a des applications dans les communications en cas de catastrophe. Le service maritime utilise le Système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) comme son propre système de communication en cas d'urgence. Toutefois, ce service est utilisé seulement pour les navires et les centres de secours en mer en vue de la sauvegarde de la vie en mer (SOLAS). 4.1.1 Réseaux maritimes Pour les communications à courte distance, généralement dans un rayon de 20 km, on utilise la bande des ondes métriques (VHF). La fréquence standard de sécurité et d'urgence en cas de détresse, dans la bande maritime des ondes métriques, est de 156,8 MHz. Aux termes de la loi, chaque navire doit surveiller cette fréquence 24 heures sur 24. En cas d'urgence, il est recommandé tout d'abord d'appeler le vaisseau sur cette fréquence avant de passer à un autre canal de communication. Les navires peuvent avoir un système d'appel sélectif automatique appelé DSC (système d'alerte par appel sélectif numérique), sur le canal VHF 70. Pour utiliser cette fonctionnalité, le code MMSI (Indicateur de service mobile maritime) du bateau est requis. Si on ne connaît pas ce code, on peut utiliser oralement le nom du navire sur le canal VHF 16. De plus, les stations côtières doivent également avoir un indicateur MMSI. Ce code est attribué en même temps que l'indicatif d'appel de la station. Une autre façon de contacter un navire lorsqu'on ne connaît pas son code MMSI est d'utiliser un code «tous navires». Un message textuel apparaît alors sur les écrans des terminaux de communication, sur les navires situés à la portée de la station appelante. L'appelant indique alors le bateau auquel l'appel est destiné et les deux stations commutent sur le canal vocal. Lorsqu'il est au port, un navire ou un bateau peut surveiller le canal des opérations du port. Une fois le contact établi avec la fréquence du port, la station radio du port peut attribuer un canal de travail. Un navire en mer peut également être contacté par l'intermédiaire de l'agent maritime responsable de sa cargaison. Cette entreprise peut contacter la compagnie de navigation gérant le voyage, qui à son tour aura un moyen de communication fiable avec le navire. La ligne de navigation connaît vraisemblablement Rapport sur la Question 16/2 63 les moyens de communications disponibles à bord du vaisseau spécifique et peut apporter son aide avec des dispositifs permettant un contact direct. 4.1.2 Stations maritimes de correspondance publique Les navires en mer maintiennent le contact avec la ligne de navigation au moyen de services téléphoniques par satellite tels que Inmarsat ou par l'intermédiaire de stations radio côtières. Si le vaisseau est équipé d'un terminal télex par satellite, il peut être possible de communiquer directement avec le navire par télex. Les navires ont souvent une adresse de courrier électronique, généralement par l'intermédiaire d'un système de mise en mémoire et d'acheminement ultérieur comprenant une boîte à lettres à terre. Sur la radio HF, de nombreuses stations côtières sont installées pour les besoins de correspondance publique, offrant un service de liaison téléphonique à des postes RTPC. Pour les communications à longue distance, on utilise les fréquences radioélectriques HF. Les stations maritimes côtières acceptent traditionnellement le trafic lié aux catastrophes et aux urgences, même si la station de secours aux sinistrés peut être basée à terre plutôt qu'en mer. Comme avec tous les systèmes radio, une licence est requise du pays où la station terrestre opère. En cas d'urgence, on a fait preuve de flexibilité sur ces questions et une station côtière pourrait bien accepter de traiter le trafic provenant d'une station qui n'a pas de compte auprès du service concerné. 4.2 Service radioaéronautique Le service radioaéronautique a des bandes de fréquences attribuées pour la communication avec et parmi des aéronefs, et des bandes supplémentaires sont attribuées aux équipements de radionavigation tels que ceux utilisés pendant un vol aux instruments. Une station souhaitant communiquer avec un aéronef en vol a besoin d'un équipement radio «bande avion». Les équipements du service mobile terrestre sont techniquement incompatibles avec ceux utilisés dans la bande aéronautique; cela est non seulement dû aux attributions de fréquences différentes mais aussi au fait que le service aéronautique sur les ondes métriques (VHF) utilise la modulation d'amplitude (AM), alors que la FM est la norme sur les ondes métriques dans le service mobile terrestre. 4.2.1 Réseaux aéronautiques Les aéronefs civils sont généralement équipés de radios VHF fonctionnant entre 118 MHz et 136 MHz, en utilisant le système de modulation AM. Il s'agit de la norme pour les communications air-terre et airair. De plus, un certain nombre d'aéronefs à longue distance (mais pas tous) peuvent être équipés d'équipements radio utilisant le système de modulation de la bande latérale supérieure (USB). La plupart des communications sont de loin réalisées en utilisant une seule fréquence en mode simplex, sans répétiteurs. L'altitude des aéronefs implique qu'il est facile de communiquer avec eux, même à des distances très grandes. La norme internationale de fréquence d'urgence est de 121,5 MHz AM. Beaucoup d'aéronefs à haute altitude surveillent cette fréquence pendant leur parcours. Cette fréquence est également surveillée par des satellites, qui peuvent déterminer la position d'une radio émettant sur cette fréquence. Pour cette raison, il convient d'utiliser les 121,5 MHz seulement en cas d'une véritable urgence menaçant la vie. Pour entrer en contact avec un aéronef en vol sans accord préalable avec lui, l'appel sur 121,5 MHz peut recevoir une réponse mais il convient de ne l'envisager qu'en dernier ressort. Une fois le contact établi, il faut que les deux stations passent immédiatement à une autre fréquence de travail. 64 Rapport sur la Question 16/2 Toutes les fois que c'est possible, il convient d'établir des accords préalables lorsqu'on s'attend à un besoin de communiquer avec un aéronef. Il convient de demander aux autorités locales de l'aviation civile une attribution de canal pour un tel trafic et d'inclure les informations pertinentes dans l'accord avec le transporteur aérien et dans les briefings de l'équipage. Dans les opérations de réaction aux catastrophes, la radio HF peut jouer un rôle clé dans la gestion du transport aérien. Dans ces cas, il convient que le contrat avec le transporteur aérien spécifie que l'aéronef doit être équipé pour ce type de communication. Les radios HF dans le service aéronautique présentent souvent la caractéristique de système d'appel sélectif (SELCAL), qui fonctionne un peu comme un système de radiomessagerie et qui permet à l'équipage d'ignorer les appels qui ne lui sont pas spécifiquement destinés. Si une station au sol n'a pas cette fonctionnalité, il est nécessaire de donner l'instruction à l'équipage du vol de ne pas engager son système SELCAL. Si aucune fréquence spécifique pour contacter les opérations en cas de catastrophe n'est définie, la fréquence de 123,45 MHz constitue une option. Bien que n'étant pas officiellement attribuée à un besoin quelconque, elle est devenue officieusement la «fréquence de conversion des pilotes». Toutefois, un pilote peut ne pas surveiller les fréquences de 121,5, MHz ou de 123,45 MHz et surveiller plutôt une fréquence d'information de vol locale ou régionale. Les informations concernant de tels canaux peuvent être obtenues plus facilement auprès des centres de contrôle du trafic aérien de la région. 4.2.2 Stations aéronautiques de correspondance publique Le service aéronautique comprend des stations de correspondance publique, similaires à celles de la station radiomaritime décrite précédemment. Des stations radio HF sont mises en place de par le monde pour relayer des informations opérationnelles concernant le vol entre les pilotes et leurs bases ainsi que de rapporter les positions à leurs autorités de contrôle respectives. En plus, toutefois, elles constituent des liaisons téléphoniques avec les téléphones des lignes terrestres pour des appels personnels, par exemple aux membres de la famille à la maison. Ce service est payé par une carte de crédit ou un compte. Pour les communications en cas de catastrophe, les stations aéronautiques de correspondance publique peuvent être approchées pour un trafic par liaisons téléphoniques de la même façon que les stations de correspondance maritime. Pour favoriser ce contact, les organisations de secours peuvent souhaiter ouvrir à l'avance un compte auprès de telles stations et elles recevront alors également des informations telles qu'un guide de fréquences. Dans tous les cas, il faut que les fréquences utilisées dans les opérations de vol ne soient pas utilisées par d'autres que les usagers aéronautiques. 4.2.3 NOTAM Lorsqu'ils déposent un plan de vol, les pilotes reçoivent des avis aux navigateurs aériens (NOTAM), des messages liés à la sécurité, se rapportant à leur vol prévu. Ces avis comprennent la mise à jour des informations de navigation et autres informations pertinentes présentées dans des graphiques et des manuels. Dans le cas des activités de réaction à une catastrophe majeure impliquant des opérations aériennes, un avis NOTAM peut contenir des détails concernant les sites de parachutage et de largage, les aérosurfaces temporaires et les dispositifs de communications qui leur sont liés. 4.2.4 Radio privée à bord d'un aéronef L'expérience montre que ce n'est pas une bonne solution d'attendre des pilotes qu'ils utilisent une radio du service mobile terrestre. Les équipements radio FM mobiles terrestres fonctionnent sur d'autres bandes de fréquences que les équipements radio AM aéronautiques et il faudrait installer des équipements supplémentaires à bord. Cela serait fastidieux et aurait des implications par rapport aux réglementations de la sécurité aérienne. Rapport sur la Question 16/2 65 Un émetteur-récepteur portatif est difficile à utiliser dans un aéronef, étant donné les niveaux élevés de bruit dans la plupart des aéronefs légers et même dans un certain nombre d'avions plus gros communément utilisés dans les opérations de largage. Si une telle liaison avec les opérations au sol est inévitable, il convient qu'un membre de l'équipage surveille cette radio, indépendamment du trafic radio aéronautique, en utilisant des casques d'écoute. Un opérateur compétent peut même utiliser la distance allongée fournie à une station en haute altitude pour relayer le trafic d'urgence. 4.2.5 Considérations spéciales impliquant des communications avec des aéronefs Une station de service mobile terrestre ne doit jamais, même accidentellement, donner l'impression que l'opérateur est un contrôleur de trafic aérien qualifié, car cela pourrait induire en erreur. Une station au sol qui ne fournit pas de contrôle officiel du trafic aérien doit le faire savoir clairement, à tout moment. Il faut que les pilotes sachent quand ils sont dans un espace aérien non contrôlé et appliquent les règles correspondantes. Il convient que la communication avec l'aéronef soit de préférence réalisée avec le capitaine, que l'on peut également appeler le pilote commandant de bord. Seul le capitaine est autorisé à prendre des décisions telle que le décollage ou l'atterrissage d'un aéronef, et sa décision ne peut pas être infirmée. 4.3 Services de radionavigation Les systèmes de radionavigation ont un rôle complémentaire dans les communications en cas de catastrophe. Les équipements portatifs pour utilisation personnelle sont disponibles à faible coût et des abonnements ou des licences ne sont normalement pas nécessaires. Au moment de la rédaction du présent document, le système le plus couramment utilisé est le Système de positionnement global (GPS), mis en œuvre par le gouvernement américain. Il existe également le système GLONASS mis en œuvre par le gouvernement russe et un système supplémentaire, Gallileo, a été proposé par l'Union européenne. Les systèmes susmentionnés assurent une couverture mondiale et les récepteurs portatifs disponibles dans le commerce ont une précision sur la position d'environ 50 mètres. Leur indication d'altitude au-dessus du niveau moyen de la mer est quelque peu moins précise. Pour des applications spéciales, des équipements ayant une précision plus élevée sont disponibles à un coût plus élevé. Toutefois, dans plusieurs applications en cas d'urgence, l'abordabilité et l'utilisation simplifiée peuvent très bien être plus importantes que la précision la plus élevée. Dans les situations de catastrophe, le fait de trouver la position sert les trois objectifs principaux soulignés ci-dessous. 4.3.1 Applications liées à la sûreté et à la sécurité Le personnel humanitaire sur le terrain est exposé à des risques élevés liés à la sûreté et à la sécurité. La mise à disposition de liaisons de communication fiables, en association avec des informations de position, est donc vitale. L'assistance au personnel en danger comprend deux éléments distincts: la recherche et le sauvetage. La recherche est la partie la plus fastidieuse et souvent la plus coûteuse d'une telle réaction et, si la personne en détresse peut communiquer sa position, la réaction n'en sera que plus rapide et plus appropriée. 4.3.2 Rapports La communication périodique de la position facilite la mise à disposition de l'assistance et peut en même temps fournir des informations essentielles sur les dangers potentiels rencontrés par le personnel sur le site d'une catastrophe. Les positions peuvent être lues sur des unités portatives sous deux formes: les coordonnées absolues, à savoir la latitude et la longitude, ou la position relative. L'utilisation de coordonnées absolues exige que des cartes avec les grilles correspondantes soient disponibles et que les opérateurs soient familiarisés avec l'utilisation du système. 66 Rapport sur la Question 16/2 Les positions relatives, l'indication de direction et de distance depuis ou vers des points fixes prédéfinis, peuvent être obtenues de la plupart des récepteurs GPS portatifs. Si un repère terrestre facilement identifiable est choisi comme point de référence, cette information peut être plus utile que les coordonnées, car elle peut être plus facile à interpréter et elle permet même l'utilisation d'une carte touristique ou d'une autre carte moins précise, sans coordonnées. Des combinaisons d'équipements de communication et de systèmes de navigation permettent le suivi automatique des véhicules sur la carte affichée sur l'écran de surveillance situé dans un bureau de coordonnateur. D'autres équipements portatifs seront disponibles pour le suivi des utilisateurs personnes physiques. 4.3.3 Applications logistiques Déplacer des biens, des fournitures et des équipements destinés aux secours est particulièrement difficile si les conducteurs ne sont pas familiarisés à une zone où il est possible que des panneaux routiers n'existent pas et que les problèmes de langue entravent encore plus l'acquisition d'information. La connaissance des coordonnées de la destination ou de sa localisation par rapport à un point de référence ou repère terrestre fixe, plutôt que juste son nom, peut aider à surmonter ces problèmes. Les noms de lieux peuvent être difficiles à écrire ou à prononcer et existent souvent en double dans un voisinage rapproché. Dans la mesure du possible, il convient d'équiper les véhicules d'équipements de localisation de position et de dispenser aux conducteurs une formation sur l'utilisation de ces équipements. 4.3.4 Points de cheminement Les radiogonomètres ont une caractéristique permettant à l'utilisateur/utilisatrice d'enregistrer sa position. L'unité autorise alors l'utilisateur à définir sa position comme point de cheminement. L'enregistrement de cette information le long du trajet facilite le retour à n'importe quel point par lequel on est passé précédemment. D'autres personnes empruntant plus tard le même trajet peuvent copier les points de cheminement dans leurs équipements et suivre la route identifiée. Toutefois, cela requiert une attribution systématique de noms à ces points de cheminement. 4.3.5 Radiobalises individuelles de repérage (PLB) Une radiobalise individuelle de repérage (PLB) est un petit émetteur radio porté au corps conçu pour transmettre à un centre de secours la position et un certain nombre d'informations sur l'utilisateur. Les balises PLB sont principalement prévues pour l'utilisation personnelle des alpinistes et des plaisanciers. Les balises PLB sont plus coûteuses que les radiobalises de détresse (ELT) mais, les ELT étant associées à un aéronef et ayant une précision limitée, la radiobalise PLB est recommandée comme équipement individuel au personnel sur le terrain. Lorsqu'on appuie sur un bouton spécifique de la balise PLB, la position et l'identité de la balise PLB sont envoyées par satellite au centre de secours. Le fichier du plan de voyage est alors associé à l'identité de la PLB et les détails de contact du bureau de l'utilisateur peuvent être rappelés. Le centre alerte la base de l'utilisateur de la balise PBL ou une agence de sauvetage. Il appartient au propriétaire de la balise PLB de mettre régulièrement à jour le plan de voyage auprès du centre de sauvetage. Ces dispositifs sont valables en cas d'isolement extrême ou lors d'opérations dans des régions à hauts risques pour la sécurité. 4.4 Systèmes d'entreprise (Systèmes privés) Les systèmes d'entreprise sont des systèmes à petite échelle destinés à être utilisés par des organisations et des entreprises. Excepté pour la taille la plus petite, leurs structures sont similaires à celles des systèmes publics homologues. Les institutions plus grosses qui sont impliquées dans la gestion des opérations en cas de catastrophe possèdent souvent leurs propres systèmes d'entreprise. Ceux-ci constituent l'outil de commande et de contrôle le plus important pour la gestion et il est donc essentiel d'en appréhender les forces et les faiblesses. Rapport sur la Question 16/2 67 L'autocommutateur privé (PBX) est un exemple typique de système d'entreprise. Il consiste en un commutateur téléphonique situé dans les locaux du propriétaire, généralement connecté à des lignes du réseau RTPC. Un système de câbles interne relie le commutateur à des systèmes de lignes intérieures disséminées dans les locaux. Au début, les connexions étaient habituellement établies par un opérateur et, donc, les connexions entre les postes de l'autocommutateur privé (PBX) étaient indépendantes des infrastructures de réseau externes. Les systèmes d'accès direct par réseau commuté (DDI) couramment utilisés de nos jours réduisent la nécessité du recours à des standardistes en associant chaque poste à un numéro extérieur. Ainsi, un correspondant appelant de l'extérieur peut ne pas savoir que l'appelé est sur un poste intérieur. En même temps, toutefois, le fonctionnement du PBX, même pour des connexions internes, peut être affecté par une interruption du réseau public. Un avantage significatif des systèmes PBX est que les propriétaires peuvent garder le contrôle de la qualité de service. Comme ils payent pour la capacité du commutateur, ils peuvent décider d'autoriser le trafic beaucoup plus important qu'une catastrophe est susceptible de générer. Etant donné que leurs circuits ne sont pas attribués à une utilisation publique, ils ne seront pas en conflit pour la capacité. Un PBX fonctionne seulement s'il est alimenté électriquement. Les commutateurs ont généralement une puissance de secours par batterie pour quelques heures. Si l'alimentation électrique normale reste interrompue pendant une période plus longue, un secours de générateur sera nécessaire. Un PBX peut mettre un certain temps à se réenclencher après une interruption d'alimentation électrique. Si un PBX ne fonctionne plus à cause d'une coupure de courant, un «service dégradé» entre en jeu. Avec ce système, un certain nombre d'extensions prédéfinies sont reliées directement à des lignes entrantes. En mode dégradé, seuls ces téléphones de reprise sur incident fonctionnent, alors que tous les autres seront inexploitables. Les téléphones de reprise sur incident ont souvent des conceptions simples. En conséquence, ils sont souvent cachés ou déconnectés; dans une situation d'urgence, il est essentiel de connaître leur emplacement. Ils sont les seuls à sonner pour des appels entrants pendant les coupures de courant qui signifient également perte d'éclairage et de climatisation, ce dont il faut tenir compte lorsqu'on décide de l'emplacement des téléphones de reprise sur incident. Il convient également de noter que le service dégradé est possible seulement si la connexion est assurée par une liaison POTS à deux fils et non par une liaison numérique. Les liaisons privées permanentes à d'autres parties de l'organisation n'assurent pas nécessairement une immunité par rapport aux défaillances du système public. Très vraisemblablement, les câbles privés fournissant les circuits à d'autres locaux passent par le système de câbles local, par le biais de répétiteurs et sur le système de jonction public. Si une partie quelconque du système public est affectée par une panne de courant sur les commutateurs, les lignes privées peuvent être également interrompues. Une connexion par liaison directe par câble, sans passer par des éléments d'autres réseaux, peut surmonter ce problème. Une solution courante pour améliorer la résistance aux catastrophes est d'utiliser des liaisons hertziennes jusqu'à 20 km et des liaisons par satellite pour des distances plus élevées. Il convient d'envisager des systèmes de liaison hertzienne s'il y a une connexion en visibilité directe entre les locaux. 4.4.1 Réseaux de données, réseaux RLE et RE, intranets Plusieurs moyennes et grosses organisations font fonctionner leur propre service de courrier électronique, en utilisant des ordinateurs équipés d'un logiciel serveur de courrier électronique. Le serveur est connecté aux stations de travail à l'aide d'un réseau local d'entreprise (RLE) et peut dans certains cas couvrir plusieurs locaux d'une entreprise. Une telle disposition est connue sous le nom de réseau étendu (RE) 68 Rapport sur la Question 16/2 Les réseaux RLE et RE ont des commutateurs similaires à un PBX. On appelle ces derniers des «routeurs». Leur fonction est d'envoyer un trafic qui n'est pas destiné à un serveur local sur une liaison à longue distance jusqu'à un autre routeur situé dans les différents locaux. Un routeur peut avoir plusieurs liaisons à plusieurs routeurs hors site. On ajoute ainsi de la redondance car d'autres liaisons peuvent remplacer les connexions interrompues. 4.4.2 Acheminement en diversité Dans la mesure du possible, il convient de connecter le réseau RTPC et les lignes privées d'un routeur ou d'un PBX à différents centraux par des voies d'acheminement différentes. Cette disposition est appelée «acheminement en diversité». Les compagnies de téléphone locales peuvent généralement assurer ce service sur demande mais le coût pourrait en être considérable. 4.4.3 Radios virtuelles (SDR) Les radios virtuelles (SDR), également appelées «radios logicielles» ou «radios soft», sont des ordinateurs numériques connectés à une antenne et commandés par un programme logiciel. Il s'agit d'un développement relativement récent. La plupart des récepteurs virtuels utilisent un préamplificateur d'ondes analogique, composé d'un filtre passe-bande, d'un amplificateur RF à faible bruit pour établir un niveau de faible bruit du système ainsi que des étages d'oscillateur local et de mélangeur afin de produire un effet hétérodyne sur le signal et obtenir une fréquence intermédiaire (FI). A cette fréquence intermédiaire, une conversion analogique/numérique (A/N) ainsi qu'un filtrage et démodulation numérique ont lieu. Un certain nombre de récepteurs virtuels effectuent la conversion A/N immédiatement après l'antenne. Il est important de noter que les radios virtuelles sont distinctes des radios commandées par ordinateur. Ces dernières sont des conceptions analogiques classiques mais comportent des caractéristiques telles que le traitement de signaux numériques (DSP) et la commande gérée par un programme logiciel. Il convient que les futures SDR prennent en charge un protocole et/ou bande de fréquences et/ou ensemble de caractéristiques quelconques de l'unité de l'abonné, plus la capacité d'effectuer des modifications en dynamique. Un certain nombre des combinaisons multiprotocole/multifréquence les plus évidentes peuvent être prises en charge par des conceptions avancées mais leur portée est encore limitée et les unités ne sont pas nécessairement à l'abri du vieillissement. Les conceptions de SDR ont la capacité de mémoriser les protocoles requis et de permettre des modifications rapides apportées tant au matériel qu'au logiciel. Pour les opérateurs de système, cela élimine finalement les questions de protocole et de fréquence pour le service mondial et l'uniformité des systèmes pourrait ne plus être une exigence pour assurer la connectivité. Une autre caractéristique des SDR est la capacité à fournir aux usagers des évolutions de logiciel et de nouvelles caractéristiques. Les terminaux de SDR acceptent des données téléchargées afin de procéder à l'installation d'un nouveau programme logiciel, ce qui accélère l'application pratique de nouvelles caractéristiques. L'introduction de versions évoluées des logiciels de cette manière évite le retrait massif d'unités ou la nécessité pour les utilisateurs de remplacer leurs terminaux plus anciens. Les applications des SDR pour une utilisation civile ont lieu jusqu'ici dans la sécurité publique et servent aux communications des agences gouvernementales nationales et locales pendant les situations d'urgences civiles. Les applications civiles des SDR comportent une station de commande portative pour la gestion de crise, des communications interagence et l'acheminement instantané des informations d'urgence. Une application commerciale courante des SDR est la résolution de problèmes de logistique/de service dans les réseaux cellulaires, PCS et réseaux de répartition. La radio SDR offre à l'utilisateur sans fil la possibilité d'utiliser un terminal unique pour accéder à une large gamme de services et caractéristiques sans fil et la possibilité d'une reconfiguration en dynamique. Ces conceptions facilitent également la «pérennité» des terminaux d'abonné, un point important dans un système à haute capacité. A l'avenir, on s'attend à ce que la SDR procure une véritable itinérance internationale avec une seule unité, la liberté de choix (type de service, niveau de caractéristiques), l'interopérabilité avec l'Internet et la création de réseaux virtuels. Rapport sur la Question 16/2 4.5 69 Réseaux VSAT (Station terminale à antenne à petite ouverture) Une façon d'améliorer les chances d'un système d'entreprise de rester opérationnel pendant une catastrophe est de le relier par satellite, ce qui le rendra indépendant d'une défaillance de l'infrastructure terrestre et d'un encombrement du réseau RPTC. VSAT est l'acronyme de «very small aperture terminals» c'est-à-dire «Stations terminales à antenne à petite ouverture». Les antennes qui déterminent l'ouverture ont généralement une taille allant de moins d'un mètre à 5 mètres, en fonction de la bande de fréquences utilisée. Les terminaux VSAT coûtent entre 3 000 USD et 5 000 USD aux prix de l'an 2000. Ils sont en majeure partie conçus pour une installation fixe mais les systèmes dits «éjectables» sont disponibles aux fins de rétablissement en cas de catastrophe. Des développements complémentaires sont prévus pour augmenter leurs applications dans les communications en cas de catastrophe. En général, l'abonnement à un service VSAT signifie l'achat d'un groupe de canaux pour une période fixe. Aucun autre usager ne partagera ces canaux et l'abonné est assuré d'utiliser ces canaux même en cas d'encombrement de systèmes tels que le réseau RTPC et le système mobile par satellite. Il s'agit d'une variante préférentielle mais son coût est élevé et il ne peut être économique que dans le cadre d'un système d'entreprise plus large. Le service VSAT est disponible auprès de plusieurs opérateurs commerciaux qui offrent une couverture mondiale ou régionale. En variante, un système d'accès multiple avec affectation en fonction de la demande (AMAD) peut être utilisé dans le cas où il ne serait pas souhaitable d'utiliser un service VSAT normal dans le cadre d'un système d'entreprise. Le système AMAD permet un accès à la largeur de bande, sur demande. Le coût sera vraisemblablement inférieur mais le risque existe de ne pas obtenir le service lorsque la demande de capacité est élevée. Si l'on exige des communications à longue distance fiables, VSAT est un système supérieur. Il est bien sûr nécessaire de protéger les équipements terminaux des dommages matériels. Il convient en particulier de placer la parabole en un endroit non exposé à des débris volants pendant les orages, tout en la maintenant dirigée vers le satellite. Après un orage ou un séisme, un réglage de la position de l'antenne peut être nécessaire et, à cet effet, un équipement spécial s'ajoutant au terminal VSAT existant peut être requis. Les systèmes VSAT relient le PBX directement à un PBX placé en un autre endroit par une liaison par satellite. Cela confère une immunité par rapport à la défaillance des services au sol, tant que la station terrestre demeure opérationnelle et possède une alimentation électrique indépendante. Toutefois, l'investissement initial de l'équipement et les frais de durée d'appel sont élevés. Une autre stratégie consiste à utiliser les téléphones mobiles par satellite ou les terminaux cellulaires fixes comme une des lignes extérieures. Il faut que le terminal ait une interface POTS à 2 fils pour pouvoir le faire. En cas de défaillance des lignes terrestres, le téléphone par satellite peut être utilisé pour lancer des appels et en recevoir. Un certain nombre d'institutions utilisent des réseaux de données privées pour des stations de travail. Il en est ainsi pour que les utilisateurs puissent partager des serveurs de fichiers et des imprimantes. Le service le plus utile qui soit fourni est de loin le courrier électronique (mél). Un système à courte distance couvrant un bâtiment unitaire est appelé réseau local d'entreprise (RLE). Un réseau reliant divers locaux de la même institution est généralement appelé réseau étendu (RE). 4.6 Exercices de formation afin d'assurer une réaction rapide Le roulement élevé du personnel dans de nombreuses organisations appelle des activités permanentes de formation. Pour les opérations de routine, il est prévu que les nouveaux membres du personnel apprennent «sur le tas» auprès de leurs prédécesseurs ou pairs mais, pour les communications en cas de catastrophe, cette approche ne suffit pas. La formation périodique assure également une prise de conscience permanente des exigences supplémentaires que chaque individu est susceptible d'affronter en cas de catastrophe. 70 Rapport sur la Question 16/2 La réaction aux catastrophes dépend du travail en équipe. Par conséquent, les exercices de formation impliquant tous les partenaires sont importants. Outre la familiarisation aux rôles de tous les secteurs et de tous les individus dans sa propre organisation, il est indispensable pour chacun, en particulier pour ceux qui sont chargés des communications, de comprendre le mandat et les modalités de travail des autres personnes impliquées dans les opérations d'urgence. Les exercices de formation sont rarement parfaits mais il s'agit d'une bonne chose. Il est nécessaire que les formateurs rendent l'exercice suffisamment réaliste afin de révéler les points faibles des procédures ou des équipements, tout en le rendant suffisamment simple pour que les nouveaux venus apprennent comment les opérations sont supposées fonctionner. Après l'exercice, il convient de prendre le temps d'examiner les lacunes rencontrées et les erreurs commises, de manière à pouvoir en tirer des leçons dans le futur. Etant donné que l'environnement en cas de réaction aux catastrophes est fortement dynamique, les exercices de formation constituent l'un des outils les plus efficaces dans le développement de procédures opérationnelles et de planification d'urgence. L'équipement technique supporte rarement bien un stockage à long terme. Une raison en est la détérioration et l'autodécharge des batteries mais d'autres facteurs sont également courants, y compris la perte de notices d'emploi ou de pièces auxiliaires. Le fait de sortir les équipements de leur stockage et de les essayer pendant les exercices de formation est une contribution majeure au maintien d'un état de capacité opérationnelle. Rapport sur la Question 16/2 71 CHAPITRE 5 Le service de radioamateurs Une explication est nécessaire pour introduire ce sujet. Le service radioamateur est un service de radiocommunication défini dans le Règlement des radiocommunications (RR, S1.56, Genève, 1998) de l'UIT. Il ne s'agit pas d'un violon d'Ingres ou d'une radio bande publique. Il s'agit d'un service réglementé et autorisé composé d'opérateurs qui ont réussi à un examen technique organisé par l'administration préalablement à la délivrance d'une licence individuelle d'opérateur. Donc, le service radioamateur est un service spécialisé de communication par radio dans l'acception du présent document et son caractère est quelque peu différent de celui des autres services décrits. Les opérateurs radioamateurs peuvent jouer un rôle de service public lorsqu'on le leur demande et ils le font souvent pendant les catastrophes. Plusieurs caractéristiques du service des radioamateurs font qu'ils peuvent aider à répondre à des demandes de services de communication en cas de catastrophe. Ces caractéristiques comprennent le fonctionnement de réseaux fortement indépendants et souples, tout en utilisant souvent des ressources très limitées. Cela permet aux radioamateurs de servir dans les communications en cas de catastrophe, de plusieurs façons. Premièrement, le système fournit un corps d'opérateurs formés dont plusieurs ont des compétences opérationnelles et techniques supérieures. Ces opérateurs sont capables d'utiliser des radios dans les conditions du terrain et, c'est le plus important, de les faire marcher. Deuxièmement, les amateurs ont déjà sur place, dans de nombreux endroits du globe, un noyau de stations souplement configurées aux fins de radiocommunications locales, régionales et intercontinentales. Pour le service d'amateur, les administrations n'affectent pas les stations à des fréquences fixes; au contraire, elles attribuent des bandes de fréquences dans lesquelles les amateurs peuvent choisir en dynamique des canaux. Le résultat en est que les amateurs ont un niveau élevé de compétence et de connaissance sur les sujets tels que la propagation des ondes radio, la conception et l'installation d'antenne ainsi que les techniques de réduction des interférences. Comme la radio d'amateur est normalement mise en œuvre avec un équipement lui appartenant personnellement, l'opérateur est également familier avec les moyens rentables de prolonger la vie de l'équipement et de la batterie par des procédures de maintenance et d'entretien. Par conséquent, pour bénéficier totalement des contributions potentielles des opérateurs et des stations radioamateurs dans les communications en cas de catastrophe, il convient que les administrations encouragent l'activité d'amateur en établissant des règles, réglementations et structures organisationnelles favorisant et facilitant ce service. 5.1 Distance de communication Le service de radioamateurs met en œuvre des réseaux dans toutes les distances concernées dans le cadre des communications en cas de catastrophe, des réseaux VHF locaux jusqu'aux liaisons HF à longue distance et aux liaisons par satellite. La plupart des éléments pris en compte dans la section suivante s'appliquent en principe à tous les réseaux de radiocommunication en cas de catastrophe. 5.1.1 Sur le site de la catastrophe Les communications locales utilisant des radios portatives ou autoradios VHF et UHF permettent des communications immédiates, en temps réel, souples, extrêmement mobiles et fiables. Ces réseaux 72 Rapport sur la Question 16/2 peuvent être les plus utiles à la coordination entre des fournisseurs de réponse à l'urgence en cas de noninteropérabilité, de surcharge ou d'interruption de leurs propres communications. 5.1.2 Depuis et vers le site de la catastrophe La communication, de la zone sinistrée vers les stations extérieures à cette zone, peut être établie sur des distances plus courtes par VHF/UHF et sur des distances plus longues par des liaisons par satellite avec la radio HF ou la radio d'amateur. Sauf aménagements spéciaux, une station dans une zone de catastrophe lancera normalement un appel général (CQ) à d'autres stations de radioamateurs, en indiquant le type de communication demandé. Une fois le contact initial établi, la station qui se trouve à l'extérieur de la zone sinistrée peut alerter d'autres situations qui pourraient être dans une meilleure position et demander aux stations d'être en attente sur la fréquence d'urgence. Actuellement, il n'existe pas de réseau mondial établi et structuré pour les radioamateurs en cas de catastrophe. Toutefois, dans un certain nombre de zones, des réseaux sont programmés sur une base régulière, fournissant une opportunité de formation, et, le cas échéant, des communications immédiates en cas de catastrophe. 5.2 Considérations de distance La distance de communication est un facteur important du choix des fréquences, de l'équipement radio et des antennes. L'aperçu général ci-après se rapporte aux bandes de fréquences attribuées au service radioamateur mais les caractéristiques des différentes bandes peuvent aussi s'appliquer à des bandes d'autres services situées au-dessus et en dessous de chaque bande d'amateur. NOTE – Les attributions d'amateur peuvent différer selon la région UIT et l'administration. Dans certains endroits, une bande de fréquences attribuée régionalement peut être moins large que les gammes de fréquences indiquées cidessous. 5.2.1 Courte distance (0-100 km) Pour les communications à courte distance de 0 km à 100 km, les fréquences VHF et UHF constituent le premier choix. Les attributions pour les services radioamateurs correspondants sont les suivantes: • de 50 MHz à 54 MHz (bande de 6 mètres) Cette bande assure une bonne propagation au-delà de la visibilité directe jusqu'à 100 km mais elle est sujette à l'interférence à longue distance des signaux d'ondes ionosphériques à des distances pouvant atteindre 1 500 km environ. • de 144 MHz à 148 MHz (bande de 2 mètres, dans certaines régions seulement de 144 MHz à 146 MHz) Cette bande est le meilleur choix pour des communications locales entre des émetteurs-récepteurs portatifs jusqu'à environ 10 km ou, avec des antennes directionnelles, jusqu'à environ 30 km. Les radioamateurs sont plus susceptibles de posséder des émetteurs-récepteurs fixes, mobiles et portatifs pour cette bande. La communication sur une zone plus étendue est possible à l'aide d'un répéteur installé en un endroit favorable, dont l'altitude est suffisante au-dessus du terrain moyen. Les répéteurs peuvent, en outre, être équipés de dispositifs d'interconnexion téléphoniques (appelés «autopatch»). • de 420 MHz à 450 MHz (bande de 70 centimètres, dans certaines régions seulement de 430 MHz à 440 MHz) Cette bande couvre des distances plus courtes que celle de la bande de 2 mètres mais elle a sinon des caractéristiques similaires, y compris la possibilité d'utiliser des répéteurs. Rapport sur la Question 16/2 5.2.2 73 Moyenne distance (100 km à 500 km): onde ionosphérique HF à incidence presque verticale La communication à des distances moyennes de 100 km à 500 km peut être réalisée par la propagation d'une onde ionosphérique à incidence presque verticale (NVIS), aux fréquences HF inférieures pouvant atteindre 7 MHz environ. Les caractéristiques de la bande sont comme suit: • de 1 800 kHz à 2 000 kHz (bande de 160 mètres) Cette bande est plus utile la nuit et pendant une faible activité solaire. Dans les conditions du terrain, les dimensions des antennes peuvent restreindre l'utilisation de cette bande, qui est également fréquemment affectée par le bruit atmosphérique, dans la zone tropicale en particulier. • de 3 500 kHz à 4 000 kHz (bande de 80 mètres, dans certaines régions seulement de 3 500 kHz à 3 800 kHz) Il s'agit d'une excellente bande nocturne. Comme toutes les plages de fréquences inférieures à 5 MHz, elle peut être sujette à un bruit atmosphérique élevé. • de 7 000 kHz à 7 300 kHz (bande de 40 mètres, dans certaines régions seulement de 7 000 kHz à 7 100 kHz) Il s'agit d'une excellente bande diurne pour les trajectoires d'ondes ionosphériques à incidence presque verticale. Aux altitudes plus élevées, particulièrement pendant les périodes de faible activité des taches solaires, des fréquences plus basses peuvent être préférables. 5.2.3 Longue distance (au-delà de 500 km): onde ionosphérique HF à incidence oblique Les stations d'amateur peuvent communiquer sur de longues distances, généralement supérieures à 500 km, en utilisant la propagation d'onde ionosphérique à incidence oblique à la fréquence HF. Les caractéristiques des bandes respectives sont comme suit: • de 3 500 kHz à 4 000 kHz (bande de 80 mètres, dans certaines régions seulement de 3 500 kHz à 3 800 kHz) Il s'agit d'une excellente bande nocturne, particulièrement pendant une faible activité des taches solaires. Toutefois, les communications peuvent être affectées par un bruit atmosphérique élevé, en particulier aux basses altitudes. • de 7 000 kHz à 7 300 kHz (bande de 40 mètres, dans certaines régions seulement de 7 000 kHz à 7 100 kHz) Cette bande est un bon choix pour une distance autour de 500 km le jour et pour de longues distances, y compris des trajectoires intercontinentales, la nuit. • de 10 100 kHz à 10 150 kHz (bande de 30 mètres) La bande de 30 m présente une bonne propagation de jour et de nuit et peut être utilisée pour la communication de données. Elle n'est utilisée actuellement pour la voix à cause de sa largeur limitée. • de 14 000 kHz à 14 350 kHz (bande de 20 mètres) La bande de 20 m est le choix usuel pour les communications diurnes sur les longues distances. La propagation des bandes ci-après convient à des distances plus longues et à une forte activité des taches solaires: • de 18 068 kHz à 18 168 kHz (bande de 17 mètres) • de 21 000 kHz à 21 450 kHz (bande de 15 mètres) • de 24 890 kHz à 24 990 kHz (bande de 12 mètres) • de 28 000 kHz à 29 700 kHz (bande de 10 mètres) 74 5.2.4 Rapport sur la Question 16/2 Moyennes et longues distances par satellites de radioamateurs Les satellites de radioamateurs peuvent servir de variante aux liaisons d'ondes ionosphériques HF. Ils ne procurent pas une couverture globale permanente mais un certain nombre d'entre eux ont la fonctionnalité de mise en mémoire et d'acheminement ultérieur, permettant de transmettre des messages entre des stations sans accès simultané au satellite respectif. On peut s'attendre à ce que des développements complémentaires dans le service par satellite de radioamateurs augmentent les applications de ce service dans les communications en cas de catastrophe. 5.3 Sélection des fréquences de travail Les opérateurs radioamateurs sont libres de sélectionner en temps réel les fréquences de travail à l'intérieur des bandes attribuées au service. Le choix d'une bande dépend principalement de la distance à couvrir, et des modifications pourraient être nécessaires en fonction des conditions de propagation en un endroit et à un moment donnés. Des tables de calculs et un programme logiciel sont disponibles pour la prédiction des fréquences optimales pour une trajectoire quelconque donnée. Du fait des modifications rapides des conditions affectant la propagation d'ondes radio, de telles informations ne sont pas, comme les prévisions météorologiques terrestres, totalement fiables. 5.3.1 Plans des bandes Chacune des trois régions de l'IARU a ses propres plans de bandes, qui servent de lignes directrices pour les sous-bandes à utiliser pour les communications dans les différents modes. Généralement, les plans de bandes désignent des sous-bandes utilisées dans les communications par télégraphie, par données numériques, par la parole et par l'image. Bien que n'étant pas obligatoires selon les termes du Règlement des radiocommunications, il est nécessaire de strictement respecter les sous-bandes afin d'éviter des interférences entre utilisateurs opérant dans des modes différents. 5.3.2 Fréquences d'urgence Des fréquences pour les appels d'urgence ont été définies dans un certain nombre de pays. En cas de catastrophe, les administrations peuvent attribuer des fréquences spécifiques utilisables uniquement par des stations fournissant des communications d'urgence. Dans certains cas, les administrations ont attribué des fréquences adjacentes aux attributions de bande d'amateurs à des organisations de secours telles que le mouvement de la Croix-Rouge, facilitant ainsi leurs communications avec les stations de radioamateurs et permettant l'utilisation d'équipement et d'antennes de radioamateurs immédiatement disponibles. 5.4 Modes de communications Les stations d'amateurs peuvent utiliser n'importe quel type d'émission pour lequel les bandes de fréquence attribuées, les plans de bandes et les règlements nationaux des radiocommunications fournissent une largeur de bande appropriée. 5.4.1 Radiotélégraphie La radiotélégraphie utilisant le code Morse international est toujours largement répandue sur tous les services d'amateurs et peut jouer un rôle important dans les communications en cas de catastrophe, en particulier lorsqu'il faut employer un équipement simple ou une faible puissance des émetteurs. L'utilisation du code Morse aide également à surmonter les barrières linguistiques dans les communications internationales. Son utilisation efficace requiert des opérateurs ayant des compétences supérieures aux exigences minimales pour les licences. Rapport sur la Question 16/2 5.4.2 75 Communication de données par radioamateurs Les communications de données ont l'avantage de la précision et de la création d'enregistrements pour une référence ultérieure. Les messages peuvent être enregistrés dans la mémoire d'ordinateurs ou sur papier. La communication de données numériques par radioamateur est réalisée par un ordinateur personnel portable ou de bureau en tant que dispositif de bande de base et par un processeur de transmission, parfois appelé contrôleur de nœuds de terminal (TNC). Le processeur de transmission effectue le codage et le décodage, éclate les données en blocs de transmission et les restaure en un flux. Il compense également les dégradations de transmission, comprime et décomprime les données et gère les conversions analogiques/numériques et numériques/analogiques. 5.4.2.1 Données HF Sur les ondes décamétriques (HF), le service de radioamateurs utilise un grand nombre de protocoles de communication de données. Le protocole PACTOR II est un des modes propriétaires disponibles pour les communications amateurs en cas de catastrophe et est également utilisé sur plusieurs réseaux d'urgence de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations. En fonctions des exigences spécifiques d'un réseau, d'autres modes de données pourraient être préférables, parmi lesquels le mode PSK-31 comme mode de communication de données en temps réel, remplaçant la plupart des liaisons par radiotélétype (RTTY). 5.4.2.2 Radio par mode paquets La radio par mode paquets peut être un outil puissant pour le traitement de trafic. Des messages textuels peuvent être préparés et édités hors ligne puis être transmis dans les plus brefs délais, réduisant ainsi l'encombrement sur les canaux de trafic chargés. La radio par mode paquets peut être utilisée par des stations tant fixes que mobiles ou portatives. La radio par mode paquets est un mode de correction d'erreur qui utilise efficacement le spectre radioélectrique. Il permet simultanément plusieurs communications sur la même fréquence et fournit une communication par programmation. En mémorisant les messages sur les panneaux d'affichage électronique par paquets (PBBS) ou dans des boîtes à lettres, les stations peuvent communiquer avec d'autres stations qui ne sont pas en ligne à ce moment-là. La radio par mode paquets fonctionne sur des réseaux permanents ou temporaires, et toute station ayant accès à ces réseaux peut ainsi étendre sa capacité de communication. Avec toutes ces caractéristiques, les radioamateurs utilisent le paquet pour de nombreuses applications diverses, y compris le traitement de trafic, les contacts par satellite, les communications à longue distance et les communications en cas de catastrophe. 5.4.2.3 Données d'ondes métriques/décimétriques (VHF/UHF) Sur les bandes VHF et UHF, le protocole AX.25 de la radio par mode paquets est une méthode fiable et efficace de communication de données à des débits compris entre 1 200 bits/s et 9 600 bits/s, en fonction de l'équipement utilisé. 5.4.3 Radiotéléphonie à bande latérale unique La radiotéléphonie à bande latérale unique avec porteuse supprimée (SCSSB ou SSB) avec une bande passante audio de 300 Hz à 2 700 Hz est le mode vocal le plus couramment utilisé dans les services radiotéléphoniques amateurs et HF 5.5 Communication par image Bien que cela ne soit pas d'une utilisation largement répandue dans les communications en cas de catastrophe, des stations d'amateurs convenablement équipées peuvent émettre et recevoir des images de 76 Rapport sur la Question 16/2 télécopie ou de télévision. Pour les communications par image, les radioamateurs utilisent fondamentalement trois techniques: la télévision d'amateur à balayage rapide (FSTV) également appelée télévision d'amateur (ATV), la télévision d'amateur à analyse lente (SSTV) et la télécopie (fax). De plus, un certain nombre de modes de données permettent la transmission de fichiers contenant des images. 5.6 Satellites de radioamateurs Le service radioamateur par satellites est une extension des réseaux de radioamateurs terrestres. Du fait de la nature même du service, les communications par de tels satellites exigent des opérateurs compétents et, au moins dans le cas de certains satellites de radioamateurs, un équipement qui peut ne pas convenir à une utilisation sans des connaissances techniques spécifiques. Entre les mains d'opérateurs expérimentés, ces satellites peuvent néanmoins fournir des services utiles dans les communications en cas de catastrophe, et des développements complémentaires augmenteront les possibilités de telles applications. 5.6.1 Transpondeurs analogiques Les stations de répétition retransmettent les signaux afin de procurer une couverture plus large. De plus, il s'agit essentiellement de la fonction de tout satellite de télécommunications, y compris ceux gérés par des organisations de radioamateurs. Alors qu'une antenne de répétition peut se trouver à une dizaine, voire une centaine de mètres au-dessus du terrain environnant, le satellite est à des centaines ou des milliers de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre. La zone accessible par les signaux du satellite est donc beaucoup plus étendue que la zone de couverture des répéteurs terrestres même les mieux placés. Il s'agit d'une caractéristique des satellites qui les rend attractifs pour la communication. Les satellites de radioamateurs agissent généralement en tant qu'un répéteur analogique, retransmettant les signaux simultanément et comme ils ont été reçus, ou en tant que système de mise en mémoire et d'acheminement ultérieur de paquets, recevant des messages des stations au sol et les retransmettant ultérieurement à partir d'une autre position de leur orbite. Dans le cas des satellites d'amateurs, la différence entre les fréquences d'émission et de réception, appelée division de fréquence, est dans la plupart des cas considérablement plus grande que celle des répétiteurs terrestres types. La transmission depuis le satellite (la liaison descendante) se produit souvent dans une autre bande de fréquences que la transmission vers le satellite (la liaison montante). Ainsi, une transmission reçue par le satellite dans la bande de 2 mètres peut être retransmise sur une fréquence dans la bande de 10 mètres. Cette exploitation à bandes croisées permet l'utilisation de filtres moins complexes dans le satellite ainsi qu'au niveau des stations terrestres. Les stations fonctionnant par l'intermédiaire d'un satellite dans ce mode à bandes croisées peuvent, de plus, utiliser le mode duplex, en transmettant et recevant simultanément. Au contraire de la plupart des satellites de communications commerciaux, les satellites de radioamateurs ne sont pas toujours immédiatement accessibles. Ils utilisent en majeure partie les orbites basses terrestres (LEO) elliptiques à environ 1 000 km au-dessus de la surface de la Terre, faisant accomplir au satellite une orbite complète en 100 minutes environ. Les mouvements combinés du satellite et de la Terre aboutissent à une couverture périodique de différentes régions. Du point de vue d'un observateur au sol, un satellite LEO s'élève à l'horizon, voyage dans le ciel selon un arc et puis descend de nouveau. Il peut en être ainsi six à huit fois par jour. Pour les «passages» où le satellite passent pratiquement au-dessus des têtes, ce cycle de montée et de descente dure 15 ou 20 minutes. Sur certaines orbites, la trajectoire du satellite fait qu'il s'élève seulement à un faible angle audessus de l'horizon, tout comme le soleil hivernal près du cercle arctique. Le temps pendant lequel le satellite se trouve dans la portée d'une station spécifique est alors beaucoup plus court. Dans la plupart des cas, le temps total pendant lequel un satellite LEO quelconque du service de radioamateurs est disponible en un endroit donné est de l'ordre de l'heure. Rapport sur la Question 16/2 5.6.2 77 Transpondeurs numériques Un changement fondamental dans la radio d'amateurs au cours de ces récentes années a été l'utilisation de la radio par mode paquets par satellites. Leur combinaison a abouti au PACSAT, un type de satellite transportant un transpondeur par radio par mode paquets. Les PACSAT fonctionnent d'une manière fondamentalement différente des satellites à transpondeurs analogiques. Lorsqu'une station au sol transmet un message numérique, le satellite enregistre le message dans la mémoire de son ordinateur à bord; il retransmet le message, seulement une fois qu'il passe au-dessus de la station au sol à laquelle le message est destiné. L'opération de mise en mémoire et d'acheminement ultérieur permet des communications dans le monde entier en utilisant un satellite à orbite basse terrestre sans le recours nécessaire à une liaison de trafic avec une station de commande terrestre. Chaque PACSAT peut mémoriser une grande quantité de données et, parce que ces satellites sont optimisés pour les données plutôt que pour le mode vocal, ils constituent en plus un système particulièrement efficace de transmission de bulletins. 5.7 Service d'urgence radioamateur (ARES) Les groupes de service d'urgence radioamateur, appelés ARES dans plusieurs pays, sont composés d'amateurs licenciés qui ont volontairement enregistré leurs qualifications et leurs équipements en vue d'une tâche de communication, dans l'intérêt du public, en cas de catastrophe. Tous les amateurs licenciés sont habilités à être membres de l'ARES. Les membres des groupes ARES utilisent leur propre équipement personnel à alimentation secourue ou exploitent l'équipement que le groupe a acquis et entretient spécialement pour les communications en cas de catastrophe. L'aperçu des procédures standard de l'ARES, présenté dans la section suivante, peut également servir de ligne directrice aux équipes de prise en charge des communications en cas de catastrophe en général. 5.7.1 Fonctions avant le départ Il convient que les chefs d'équipe fournissent aux membres de l'ARES une notification de leur activation et affectation, que des références soient fournies pour leur reconnaissance auprès des autorités locales. Il est recommandé de tenir un briefing opérationnel et technique, en s'appuyant sur les informations obtenues des autorités compétentes et complétées par des rapports émanant de radios d'amateurs, de radios commerciales et autres sources. Ce briefing doit inclure un aperçu des exigences identifiées en matière d'équipement et de main d'œuvre, des contacts ARES et des conditions régnant dans la zone de la catastrophe. 5.7.2 Fonctions pendant le trajet Il convient de profiter du temps du trajet jusqu'au site sinistré pour procéder avec l'équipe à un examen de la situation. Cet examen peut comporter des affectations de tâches, des listes de contrôle, le profil de la zone sinistrée, le plan de la mission qui concerne les opérations de secours aux sinistrés, les forces et les faiblesses des réponses précédentes et actuelles, des cartes, des documents techniques, des listes de contacts, des procédures d'opérations tactiques ainsi que les exigences concernant les équipes d'intervention. 5.7.3 Fonctions à l'arrivée A leur arrivée, il convient que les chefs d'équipe s'enregistrent auprès des officiels locaux de l'ARES et obtiennent des informations sur les fréquences utilisées, sur les actions en cours, sur le personnel disponible, sur l'équipement informatique et l'équipement de communication ainsi que sur les installations de soutien. Il convient qu'ils obtiennent le plan ARES en vigueur pour la catastrophe spécifique. Une priorité devrait être l'établissement d'un réseau initial de communication à l'intérieur de l'équipe et de liaisons HF ou VHF avec la base. Il convient que les chefs d'équipe rencontrent les agences desservies, le 78 Rapport sur la Question 16/2 personnel chargé des communications dans les clubs de radioamateurs, les autorités locales chargées des communications et d'autres encore selon les besoins afin de recueillir des informations et de coordonner l'utilisation des fréquences. Il convient que la sélection des sites de communications tienne compte des exigences concernant les équipes et les contraintes locales. 5.7.4 Fonctions sur le site Il convient que les chefs d'équipe effectuent une évaluation initiale des réseaux et installations de communications que les autres équipes d'intervention ont mis en fonctionnement, afin de coordonner les opérations et réduire la duplication des efforts. Il est nécessaire de suivre des procédures et pratiques de sécurité correctes. Il convient d'effectuer des critiques périodiques de l'efficacité des communications avec les unités concernées et le personnel chargé des communications. 5.7.5 Fonctions de démobilisation Il convient de négocier une procédure d'extraction des correspondants amateurs avec les agences desservies et les hôtes officiels avant qu'on en est besoin. Pour obtenir des volontaires leur engagement à voyager et à participer aux opérations, il faut leur assurer qu'une fin sera mise à leur engagement. Les engagements indéterminés de volontaires sont indésirables, en partie parce qu'ils font hésiter les volontaires potentiels à s'impliquer. Il faut que les chefs collaborent avec les agences desservies, afin de déterminer le moment où l'on n'a plus besoin de l'équipement et du personnel. Il convient donc de mettre en vigueur un plan de démobilisation. Il convient d'effectuer une critique d'équipe, en la commençant au cours du voyage de retour, et de préparer l'évaluation des performances individuelles. Il convient que les problèmes dus aux conflits de personnalité soient traités et/ou résolus en dehors des rapports officiels car ils ajoutent seulement de la distraction relativement à ces rapports. Il convient de comptabiliser l'équipement, de tenir une réunion d'évaluation postcatastrophe et de préparer un rapport final. 5.7.6 Procédures standard La dimension d'une catastrophe affecte l'importance de la réaction mais pas les procédures. Des procédures standard existent pour des questions telles que l'utilisation de répéteurs et un autopatch, le pointage sur une fréquence de réseau et le format des messages. Dans les communications en cas de catastrophe, il est toujours préférable de suivre ces principes standard de fonctionnement que d'introduire de nouvelles procédures que l'on n'a probablement pas essayées au préalable. Les amateurs ont besoin de formation sur les procédures de travail et les compétences liées aux communications. En cas d'urgence, les radios ne communiquent pas – les personnes le font. Une formation correcte aux catastrophes doit préparer les participants à une tâche systématique et précise, même dans l'environnement le plus chaotique. 5.8 Activité de formation Il convient que la formation couvre les sujets de base: les communications en cas d'urgence, le traitement du trafic, le fonctionnement des réseaux ou des répéteurs ainsi que les connaissances techniques. Des activités pratiques de radiodiffusion (un jour de revue ou un test de simulation de situations d'urgence (SET) par exemple) offrent sur le plan national des opportunités de formation à des individus et à des groupes et révèlent les zones faibles dans lesquelles il est nécessaire d'apporter plus de formation ou d'améliorations de l'équipement. De plus, des manœuvres et des essais peuvent être spécialement conçus pour vérifier l'état de préparation et la fiabilité des équipements d'urgence qui ne sont pas utilisés de façon permanente. Rapport sur la Question 16/2 5.8.1 79 Exercice pratique, manœuvres et essais Une manœuvre ou un essai qui présente de l'intérêt et une valeur pratique fait qu'un groupe est heureux d'y participer car il lui semble que ses efforts sont mérités. Afin de présenter un scénario réaliste, il convient de centrer la formation sur une simulation de situation de catastrophe et, dans la mesure du possible, de la combiner à des exercices de formation conçus par d'autres partenaires de l'assistance en cas d'urgence. Il convient que la formation comprenne l'activation des réseaux d'urgence, la répartition des stations mobiles entre les agences desservies, l'émission et le traitement de messages ainsi que l'utilisation de répéteurs alimentés pour les cas d'urgence. Comme le justifient les charges de trafic, il peut être nécessaire d'affecter les stations de liaison à recevoir du trafic sur le réseau local et à le relayer vers des destinations extérieures. La valeur de tout exercice dépend dans une large mesure de son évaluation soignée et de l'application des leçons apprises. 5.8.2 Exercice quotidien sur le terrain Un exercice quotidien sur le terrain (FD) encourage les amateurs à opérer dans les conditions d'urgence simulées. Une prime est placée sur les compétences opérationnelles et sur l'adaptation de l'équipement pour relever les défis des conditions d'urgence et de la logistique qui leur est liée. Les amateurs sont habitués à exploiter des stations capables de communications à longue distance, dans pratiquement n'importe quel endroit et dans des conditions difficiles. Ils sont également familiarisés avec les alternatives à l'énergie commerciale telles que l'utilisation de générateurs, de batteries et de l'énergie éolienne et solaire. 5.8.3 Tests de simulation de situations d'urgence Un test de simulation de situations d'urgence (SET) génère des compétences en matière de communications en cas d'urgence. Les objectifs du test SET sont: − d'aider les opérateurs à acquérir de l'expérience dans la communication en utilisant les procédures standard dans des conditions d'urgence simulées et à expérimenter un certain nombre de nouveaux concepts; − de déterminer les points forts, les capacités et les limitations en fournissant des communications en cas d'urgence afin d'améliorer la réaction à une urgence réelle; et − de fournir, aux agences desservies et au public par l'intermédiaire des médias, la démonstration de la valeur du service de radioamateurs, particulièrement en cas de besoin. Le test SET sert en outre à: − exercer les interfaces VHF vers HF au niveau local; − à encourager une utilisation accrue des modes numériques afin de traiter des trafics de gros volume et des messages de bien-être point à point; − à renforcer la coopération entre les opérateurs radioamateurs, les utilisateurs et les organisations de réaction aux catastrophes; − à concentrer les énergies sur les communications ARES au niveau local, sur l'utilisation et la reconnaissance des communications tactiques ainsi que sur les procédures destinées au trafic de messages réglementaires. 5.9 Réseaux pour le trafic sur le service des radioamateurs Le traitement du trafic comprend la transmission de messages depuis et vers d'autres que les opérateurs radioamateurs. Lorsque les réglementations nationales l'autorisent, les stations radio amateurs peuvent traiter ce trafic de tiers, dans les situations de routine comme en cas de catastrophe. Ces communications 80 Rapport sur la Question 16/2 de service public font des radioamateurs une ressource publique de valeur et assurent la meilleure formation aux communications en cas de catastrophe. Les structures de réseaux pour le trafic diffèrent dans de nombreux pays mais la structuration indiquée dans la section suivante peut servir d'exemple. 5.9.1 Réseaux tactiques Le réseau tactique est le réseau en première ligne activé pendant un incident. Il s'agit d'un réseau utilisé par une seule agence gouvernementale pour la coordination avec des opérations de radioamateurs qui ont lieu à l'intérieur de leur juridiction. Plusieurs réseaux tactiques peuvent être en place pour un seul incident, en fonction du volume du trafic et du nombre d'agences impliquées. Généralement, les communications comprennent le traitement de trafic et la mobilisation de ressources. 5.9.2 Réseau de ressources Pour des incidents à plus grande échelle, un réseau de ressources est utilisé pour recruter des opérateurs et obtenir des équipements qui viennent à l'appui des opérations sur les réseaux tactiques. Lorsqu'un incident exige plus d'opérateurs ou d'équipement, le réseau de ressources se transforme en lieu de pointage pour que les volontaires s'enregistrent et reçoivent leurs affectations. 5.9.3 Réseau de commandement Lorsque la dimension d'une opération de réaction aux catastrophes augmente et que davantage de partenaires sont engagés dans les opérations en cas de catastrophe, un réseau de commandement peut devenir nécessaire. Ce réseau permet aux gestionnaires des opérations en cas de catastrophe de communiquer les uns avec les autres afin de résoudre les problèmes qui surviennent à l'intérieur des agences ou entre les agences, en particulier entre des villes, ou dans des zones d'opérations plus vastes. On conçoit qu'un tel réseau soit surchargé par un gros volume de trafic. Il peut donc être nécessaire de créer plusieurs réseaux de commandement afin de couvrir tous les besoins. 5.9.4 Réseaux ouverts et réseaux fermés Un réseau peut fonctionner en réseau ouvert ou en réseau fermé avec une station de commande de réseau qui contrôle le flux de communications. Lorsque le trafic est faible ou sporadique, une commande de réseaux ne sera pas nécessaire et le réseau ouvert constitue la forme appropriée. Les stations participant au réseau annoncent leur présence et restent en attente. Si elles ont du trafic, elles appellent directement une autre station après avoir vérifié que le canal n'est pas occupé à ce moment-là. Dans un réseau fermé, toute station souhaitant établir un contact appelle la station de commande du réseau, qui pourra autoriser une communication directe sur le canal appelant ou affecter un canal de travail aux stations respectives. A la fin de leur communication, les stations participantes font un rapport à la station de commande du réseau sur la fréquence principale. Pour ce type de fonctionnement, il est essentiel que la station de commande du réseau tienne un registre des activités de toutes les stations et de tous les canaux de travail attribués. On s'assure ainsi que toutes les stations restent en permanence disponibles pour des messages urgents. 5.9.5 Formation des opérateurs de réseaux Les procédures de discipline dans le réseau et de traitement des messages sont des concepts fondamentaux du fonctionnement des réseaux de radioamateurs. Il convient que la formation engage autant d'opérateurs différents que possible dans la station de commande du réseau et dans d'autres fonctions; il est moins utile que le même opérateur accomplisse les mêmes fonctions dans toutes les sessions de formation. Rapport sur la Question 16/2 5.10 81 Traitement de l'information Le caractère fondamentalement informel des opérations de radioamateurs rend nécessaire de porter une attention particulière aux procédures de traitement des messages à l'intérieur des différents réseaux, entre les différents réseaux et entre le service radioamateur et d'autres réseaux. Les réseaux de trafic établis de manière permanente constituent le moyen idéal d'assurer un traitement efficace des messages pendant une situation d'urgence. 5.10.1 Centre des opérations d'urgence Les communications de radioamateurs en cas d'urgence utilisent fréquemment les concepts combinés de Poste de commandement (PC) et de Centre des opérations d'urgence (COU). Le PC contrôle principalement les activités initiales dans les situations d'urgence et de catastrophe, et est généralement une entité établie spontanément qui s'autoenclenche. Les fonctions initiales du PC consistent à évaluer la situation, à rapporter à un coordonnateur et à identifier et demander les ressources appropriées. Le Centre des opérations d'urgence (COU) répond aux demandes d'un PC en expédiant l'équipement et le personnel, en anticipant la nécessité de fournir un soutien et une assistance supplémentaires et en plaçant à l'avance des ressources supplémentaires dans une zone de stockage intermédiaire. Si la situation change sur le site de l'événement, le PC fournit au COU une mise à jour et maintient le contrôle jusqu'à l'arrivée de ressources supplémentaires ou spécialisées. En étant situé à l'extérieur du périmètre de danger potentiel, le COU peut utiliser tout type de communications approprié, se concentrer sur la collecte de données provenant de tous les partenaires et mobiliser et expédier les moyens de réaction demandée. 5.10.2 Centre d'information Que le trafic soit tactique, qu'il se fasse par messages formels, par radio par mode paquets ou par la télévision d'amateurs, le succès dépend de la connaissance des possibilités et des limitations des ressources de télécommunication disponibles. Le trafic tactique appuie les opérations de réaction initiales dans une situation d'urgence, engageant généralement un petit nombre d'opérateurs à l'intérieur d'une zone limitée. Le trafic tactique, bien que non formaté et rarement écrit, est particulièrement important lorsque des entités organisationnelles différentes sont engagées dans les opérations. L'utilisation d'une fréquence d'appel VHF ou UHF, y compris éventuellement l'utilisation de répéteurs et de fréquences de réseau, est plus typique des communications tactiques. Une façon de rendre le fonctionnement des réseaux tactiques transparent est d'utiliser des indicatifs d'appel tactiques, c'est-à-dire des mots qui décrivent une fonction, un lieu ou une agence, plutôt que les indicatifs d'appel du service des radioamateurs. Lorsque les opérateurs changent d'équipe ou d'endroit, le jeu d'appels tactiques reste le même. Des indicatifs d'appel tels que «Sièges de catastrophe», «Commande de réseau» ou «Centre météorologique» favorisent l'efficacité et la coordination dans les activités de communication au service du public. Il faut toutefois que les stations de radioamateurs identifient leurs stations à intervalles réguliers par les indicatifs d'appel attribués. Les opérations d'un réseau tactique exigent de la discipline et le fait de suivre les instructions données aux opérateurs peut servir d'exemple: − faites un rapport à la station de commande du réseau (NCS) immédiatement à votre arrivée à votre station; − demandez au centre NCS la permission avant d'utiliser la fréquence; − utilisez la fréquence exclusivement pour le trafic indispensable; − répondez immédiatement lorsque le centre NCS vous appelle; − utilisez des indicatifs d'appel tactiques; − suivez les procédures de réseau établies par le centre NCS. 82 Rapport sur la Question 16/2 Dans un certain nombre d'activités de secours, les réseaux tactiques deviennent des réseaux de ressources ou de commandement. Un réseau de ressources est utilisé pour un événement qui dépasse les frontières d'une seule juridiction et lorsqu'une aide mutuelle est nécessaire. Un réseau de commandement est utilisé pour les communications entre le COU et les chefs de l'ARES. Pourtant avec le grand nombre de réseaux, le fait de mettre toutes les parties sur la radio, plutôt que d'essayer d'interpréter leurs mots, est parfois l'approche la plus pratique. 5.10.3 Trafic de messages réglementaires Le trafic de messages réglementaires est traité dans un format de message standard et principalement sur des réseaux HF et VHF établis de façon permanente ou temporaire. Des liaisons peuvent exister entre des réseaux locaux, régionaux et internationaux. Lorsque la précision est plus importante que la vitesse, le formatage d'un message avant de le transmettre augmente la précision de l'information transmise. 5.10.4 Fonctionnement pendant les catastrophes Lorsqu'une situation d'urgence se produit, la mobilisation de l'organisation ARES locale ne dépend pas des instructions des quartiers généraux de rang supérieur. Chaque groupe répond spontanément aux besoins des agences de sauvetage locales. 5.10.5 Traitement des messages par la radio par mode paquets La radio par mode paquets est le mode préféré pour le traitement des messages réglementaires. Elle permet également la transmission de trafic entre les différents réseaux avec un minimum de reformatage, assurant ainsi la précision. 5.11 Groupes d'urgence de radioamateurs Dans de nombreux endroits, les radioamateurs souhaitant mettre leurs compétences et leurs ressources à la disposition de la communauté ont formé des groupes locaux. Des opérateurs formés sont ainsi prêts à fournir des communications en cas de catastrophe lorsque d'autres services échouent complètement ou ne peuvent pas couvrir les besoins. Les groupes d'urgence de radioamateurs recrutent souvent leurs membres dans des clubs existants et peuvent comprendre des amateurs à l'extérieur de la zone du club spécifique car les opérations de réaction aux catastrophes peuvent englober une zone plus large. 5.11.1 Catastrophes et calamités naturelles Malgré le large spectre de besoins dans une situation de catastrophe, il ne convient pas que les radioamateurs recherchent ou acceptent de quelconques tâches autres que les radiocommunications. Par exemple, les préposés volontaires aux communications ne prennent pas de décision majeure, n'agissent pas en tant que sauveteurs et ne louent pas de générateurs, de tentes ou de lampes au public. Les radioamateurs traitent des radiocommunications en soutien à ceux qui fournissent une réponse au cas d'urgence tel qu'il est décrit dans la section suivante. 5.11.2 Trafic santé et bien-être Il peut y avoir une quantité considérable de trafic par radio à traiter, pendant une catastrophe, en partie parce que des lignes téléphoniques encore opérationnelles devraient être réservées à une utilisation dans les opérations. Peu après une catastrophe majeure, les messages d'urgence à l'intérieur de la zone de la catastrophe ont souvent une urgence de vie ou de mort. Naturellement, ils reçoivent une priorité primordiale. Une grande partie de leur trafic a lieu sur VHF ou UHF. En deuxième position par rapport à ce trafic prioritaire, des messages de nature liée à l'urgence mais pas de la plus extrême urgence, peuvent être traités. Enfin, le trafic bien-être provenant d'évacués dans les abris ou dans les hôpitaux peut être relayé par les radioamateurs. Rapport sur la Question 16/2 83 Il convient de traiter le trafic santé et bien-être entrant seulement après que tout le trafic d'urgence et de priorité aura été dégagé. Les interrogations de bien-être parvenant dans une zone de catastrophe peuvent mettre longtemps à obtenir des réponses qui pourraient avoir déjà été fournies par le biais de circuits rétablis. Les stations dans les abris, en tant que stations de commande de réseau, peuvent échanger directement des informations sur les bandes HF avec les zones de destination comme le permet la propagation. Elles peuvent également traiter le trafic réglementaire par le biais d'opérateurs extérieurs. 5.11.3 Enquête sur les dommages matériels Les officiels à proximité de la zone sinistrée ont besoin de moyens de communications pour relater les rapports sur les dégâts aux agences appropriées. Les opérateurs radioamateurs peuvent offrir leur aide mais peuvent avoir besoin d'une identification correcte pour avoir accès à des zones réservées. Alors que le trafic peut souvent être informel, il convient que les opérateurs tiennent un journal et prennent des notes pour s'y référer ultérieurement. 5.11.4 Accidents et dangers locaux En se servant des caractéristiques des radios mobiles et portatives VHF modernes, un opérateur pourrait activer un répéteur autopatch en envoyant un code. Le répéteur se connecte à une ligne téléphonique et achemine les signaux audio entrants et sortants, selon le cas. En composant un numéro d'urgence, l'opérateur a accès à des agences chargées de l'application des lois. La capacité à demander de l'assistance sans dépendre d'une autre station qui contrôle le canal fait gagner du temps. 5.11.5 Coopération avec les organismes de sécurité publique Les radioamateurs peuvent fournir à des agences de sécurité publique, telles que la police locale et les officiels de la lutte contre les incendies, une ressource supplémentaire de valeur en cas d'urgence. Pour que le service des radioamateurs soit utile en tant que ligne de sécurité de service public dans une situation d'urgence, il est nécessaire que ses possibilités soient pleinement comprises par les agences de sécurité publique, et l'établissement de contacts permanents entre les deux parties est un impératif. 5.11.6 Recherches et sauvetage Les radioamateurs peuvent aider les équipes de recherche et de sauvetage pendant et après les catastrophes, en particulier après des orages et séismes dévastateurs. Dans certains cas, leurs compétences techniques pourraient encore être d'une valeur plus grande par rapport aux équipements électroniques qui sont de plus en plus utilisés dans les opérations de recherche. 5.11.7 Communications des hôpitaux Les hôpitaux et les établissements similaires pourraient, après une catastrophe, se trouver sans communications. Cela affecte en particulier la coordination entre les divers fournisseurs de services de santé. A l'intérieur d'un hôpital, les opérateurs de l'ARES peuvent temporairement servir à remplacer une radiomessagerie et à maintenir des communications interdépartementales critiques. Il convient que les groupes d'urgence de radioamateurs locaux préparent à l'avance les communications d'hôpital. 5.11.8 Déversement/fuites de produits chimiques toxiques Les communications d'amateurs ont aidé dans des situations impliquant des produits chimiques et la contamination des systèmes d'approvisionnement en eau. Sur les instructions du poste de commandement, les amateurs fournissent des communications en appui à l'évacuation des habitants, à la coordination entre le site sinistré et les sites ou abris d'évacuation. Comme indiqué ci-après, les opérateurs radioamateurs peuvent également fournir des communications liées à l'identification des matériaux impliqués et la réponse appropriée. 84 Rapport sur la Question 16/2 5.11.9 Incidents dus aux matières dangereuses Le terme de «matières dangereuses» (HAZMAT) se rapporte à des substances ou matières qui, si elles sont libérées de manière incontrôlée, sont nocives pour les personnes, les animaux, les récoltes, les systèmes d'approvisionnement en eau ou autres éléments de l'environnement. La liste comprend les gaz explosifs, inflammables et combustibles, les liquides et les matériaux solides, les substances toxiques et infectieuses, les matériaux radioactifs et les substances corrosives. Le problème initial dans un accident impliquant ces matériaux est la détermination de la nature et de la quantité des produits chimiques impliqués. Des institutions diverses tiennent des registres de matières dangereuses afin de fournir des indications rapides sur les dangers associés à des substances potentiellement dangereuses, mais cette information vitale ne sera pas disponible à moins de pouvoir rétablir immédiatement les communications. Les opérateurs ARES peuvent se voir demander d'établir des communications avec ces institutions. Il convient d'inclure dans le matériau de briefing des groupes ARES les informations sur les sources d'information et sur les marquages standard des produits dangereux. 5.12 Communications de tiers dans le service radioamateur Une liaison de communication de radioamateurs engage normalement deux parties: les opérateurs. Toutefois, outre la communication entre eux, ces opérateurs peuvent se voir demander de transmettre un message au nom d'un tiers, à savoir une personne ou une organisation qui n'est pas nécessairement présente à la station radio. Du point de vue de la réglementation, il est nécessaire de distinguer deux cas: si les deux parties de la liaison radio se trouvent dans un seul pays, le trafic de tiers est soumis aux réglementations nationales. Si le message est émis par un radioamateur dans un pays donné mais est destiné à un tiers dans un autre pays, il est nécessaire de respecter en plus les règlements des radiocommunications de l'UIT concernant le trafic international de tiers. Ces règlements assurent que dans le service des radioamateurs ce trafic n'est pas autorisé à moins que n'existe un accord bilatéral entre les administrations nationales concernées qui autorise spécifiquement ces messages. Un certain nombre d'administrations peuvent tolérer le trafic de tiers ou s'engager dans des accords temporaires si ce type de trafic est d'utilité publique, comme lorsque les autres canaux de communication ont été interrompus. Il convient que les opérateurs sachent qu'il y a une règle générale pour les radiocommunications qui stipule que, lorsque la sauvegarde de la vie humaine et des biens est en jeu, les réglementations administratives peuvent être levées temporairement. Une révision de l'article S.25 du Règlement des radiocommunications, applicable à ces questions, est au programme de la Conférence mondiale des radiocommunications prévue en 2003. Rapport sur la Question 16/2 85 CHAPITRE 6 Diffusion La diffusion est effectivement un système semi-privé, avec un nombre illimité de récepteurs mais un nombre déterminé d'émetteurs. En plus des réglementations régissant les services radio, la diffusion est aussi soumise normalement aux réglementations concernant les médias en général et il est nécessaire que les éventuelles applications aux communications en cas de catastrophe en tiennent compte. Dans tous les cas, la vérification de la fiabilité de l'information avant sa distribution à un très large public a une importance primordiale et il est nécessaire de définir clairement les responsabilités qui lui sont liées. 6.1 Diffusions d'urgence sur les réseaux radiphoniques, télévisuels et câblés Les systèmes radiophoniques, télévisuels et câblés locaux sont des moyens principaux pour alerter le public en cas de conditions potentiellement dangereuses telles que les fortes pluies ou les tempêtes de neige, les ouragans, les tornades, les inondations et autres catastrophes que l'on peut anticiper au moins brièvement avant leur impact. Une fois que la catastrophe s'est produite, les mêmes moyens, s'ils sont encore opérationnels, sont des outils inestimables pour informer les populations sinistrées des mesures prises ou à prendre. Dans les endroits présentant un risque élevé de phénomènes météorologiques violents, des réseaux permanents ont été mis en place. En plus et en soutien de ces réseaux officiels gérés par les autorités nationales ou locales, les groupes de radioamateurs ont mis en place des réseaux tels que «Alertes à la tornade», qui à leur tour avisent les autorités locales et les stations de radiodiffusion du danger imminent. Les services météorologiques nationaux transmettent généralement les informations météorologiques aux radiodiffuseurs. Cela peut comprendre l'activation des réseaux de radiodiffusion d'urgence (EBS) lorsqu'ils sont en place. Dans ce cas, l'autorité ou le fonctionnaire désigné active le système EBS, avisant les points de commande des réseaux radiophoniques, télévisuels et câblés. La télévision peut fournir des informations utiles sous la forme de cartes et d'images mais, du fait des faibles exigences technologiques du côté récepteur, les radiodiffusions demeurent le meilleur moyen pour la distribution des informations d'urgence après une catastrophe. Les récepteurs de télévision dépendent en majeure partie de la disponibilité de la puissance en ligne et d'antennes fixes, ou de connexions par réseau de câble, qui pourraient toutes être touchées par la catastrophe. Les radios-transistors portatifs sont peu coûteuses. En association avec des batteries de rechange ou si elles sont alimentées par des cellules solaires ou d'autres sources de puissance indépendantes, elles serviront pendant toute la durée de la phase aiguë de la plupart des catastrophes. 6.2 Diffusion mobile d'urgence Du côté émetteur, les stations FM portatives de faible puissance peuvent assurer le service de radiodiffusion lorsque les installations permanentes sont touchées. Elles peuvent être mises en marche depuis un véhicule ou d'un abri temporaire quelconque. Les systèmes de diffusion numérique par satellite joueront probablement un rôle croissant. Le développement de récepteurs de faible coût destinés à ces services sera une condition préalable à leur application étendue aux communications en cas de catastrophe. 86 Rapport sur la Question 16/2 CHAPITRE 7 Coordination des télécommunications Les télécommunications sont des outils principaux de coordination mais elles peuvent remplir leur tâche seulement si elles sont bien coordonnées elles-mêmes. L'expérience montre que, en cas de catastrophe majeure qui nécessite la coopération entre plusieurs services publics et de sauvetage, la connectivité entre les unités provenant de districts différents fait souvent défaut. Cela s'applique encore plus en cas d'assistance internationale, où il est nécessaire que des partenaires n'évoluant pas normalement dans un site commun communiquent à tous les niveaux. Dans ces cas, le Secrétariat du Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence, financé par l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) à Genève, a reçu le mandat de faciliter les arrangements entre tous les partenaires concernés. 7.1 Rôle du fonctionnaire chargé de la coordination des télécommunications En tant que partie du cadre de coopération dans l'assistance humanitaire internationale, la Commission permanente interagence (IASC) en sa qualité d'organisme de coordination pour l'assistance humanitaire internationale a adopté le concept de Fonctionnaire chargé de la coordination des télécommunications (TCO) comme le principe de base d'une approche commune aux télécommunications en cas de catastrophe. En cas de catastrophes majeures comportant une réaction internationale, l'expert en télécommunications d'une équipe UNDAC ou le haut fonctionnaire chargé des télécommunications de l'une des institutions participant dans les efforts de secours est désigné comme TCO. Le TCO appuie l'équipe de gestion des opérations en cas de catastrophe (EGO) dans toutes les questions liées aux télécommunications et rédige un rapport au chef de cette équipe. Il ou elle facilite la coopération entre les fonctionnaires chargés des télécommunications de toutes les agences participantes et, au nom de tous les utilisateurs des télécommunications en cas de catastrophe, assure la liaison avec les autorités nationales chargées des télécommunications. Les fonctions du TCO ont une nature opérationnelle, technique et réglementaire. Elles comprennent la compatibilité des réseaux ou au moins leur interaction par le biais d'un soutien mutuel commun qui utilise les ressources techniques et humaines de tous. Il est nécessaire que le TCO soit totalement familiarisé avec les instruments réglementaires internationaux, en particulier avec la Convention de Tampere sur la mise à disposition de ressources de télécommunication pour l'atténuation des effets des catastrophes et pour les opérations de secours en cas de catastrophe, et avec leur application. 7.2 Idée d'entité de direction Similaire à une structure qui, dans les mécanismes de réaction humanitaire internationale, est connue comme l'«idée d'agence de direction», il pourrait être approprié dans un certain nombre de cas qu'un opérateur, prestataire de services ou organisation unique accepte la responsabilité globale de la mise à disposition des services de télécommunication en cas de catastrophe. Cette option dépend de deux questions principales: en premier lieu, de la disponibilité des ressources nécessaires à une entité unitaire, et en second lieu de la recevabilité de cette entité par rapport aux implications commerciales ou politiques des activités globales. L'accord sur la nomination d'une «entité de direction» prendra probablement beaucoup de temps et le concept est donc principalement applicable aux opérations de plus longue durée. Rapport sur la Question 16/2 87 Manuel sur les télécommunications en cas de catastrophe PARTIE 3 ANNEXE TECHNIQUE QUELQUES ASPECTS TECHNIQUES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CAS DE CATASTROPHE Table des matières Page 1 Introduction à la Partie 3 du présent Manuel .......................................................... 90 2 Choix des technologies appropriées pour les télécommunications en cas de catastrophe ....................................................................................................................... 91 2.1 Simplicité et nouvelles technologies ................................................................................... 91 2.2 Fiabilité de l'infrastructure................................................................................................... 91 2.3 Transport et mobilité ........................................................................................................... 91 2.4 Interopérabilité .................................................................................................................... 92 2.5 Comparaison des systèmes à satellites pour les télécommunications en cas de catastrophe 2.5.1 Satellites sur orbite terrestre basse .......................................................................... 2.5.2 Satellites géostationnaires ....................................................................................... 2.5.2.1 INMARSAT par opposition aux microstations (VSAT) et aux nanostations (USAT) ................................................................................ 2.5.2.2 INMARSAT ............................................................................................. 2.5.2.3 VSAT........................................................................................................ 2.5.2.4 Réseaux USAT ......................................................................................... 92 92 92 92 93 95 96 3 Méthodes de radiocommunication .............................................................................. 96 3.1 Fréquences........................................................................................................................... 3.1.1 Attribution internationale des fréquences ............................................................... 3.1.2 Attribution nationale des fréquences....................................................................... 3.1.3 Assignation de fréquence ........................................................................................ 96 96 99 100 3.2 Propagation.......................................................................................................................... 3.2.1 Ondes de sol ............................................................................................................ 3.2.2 Propagation des ondes ionosphériques.................................................................... 3.2.2.1 Ondes ionosphériques à incidence quasi verticale.................................... 3.2.3 Propagation à ondes métriques/décimétriques ........................................................ 3.2.3.1 Liaisons point à zone ................................................................................ 3.2.3.2 Liaisons point à point................................................................................ 3.2.3.3 Formules de conversion............................................................................ 100 100 101 101 103 103 104 104 88 Rapport sur la Question 16/2 Page 4 L'antenne: partie essentielle de toute station radioélectrique .............................. 105 4.1 Choix de l'antenne ............................................................................................................... 105 4.2 Considérations relatives au système d'antenne.................................................................... 4.2.1 Sécurité.................................................................................................................... 4.2.2 Emplacement de l'antenne....................................................................................... 4.2.3 Polarisation de l'antenne.......................................................................................... 4.2.4 Accord de l'antenne ................................................................................................. 4.2.5 Lignes de transmission ............................................................................................ 4.2.6 Adaptation d'impédance dans le système d'antenne................................................ 4.2.7 TOS-mètres ............................................................................................................. 4.2.8 Réseaux adaptateurs d'impédance d'antennes ......................................................... 105 105 106 106 107 107 108 108 109 4.3 Antennes utilisées dans la pratique...................................................................................... 4.3.1 Doublet demi-onde.................................................................................................. 4.3.2 Doublet replié à large bande.................................................................................... 4.3.3 Antenne verticale quart d'onde................................................................................ 4.3.4 Antennes pour émetteurs-récepteurs portatifs......................................................... 4.3.5 Antennes verticales pour ondes métriques et décimétriques................................... 4.3.6 Boucle delta............................................................................................................. 4.3.7 Antennes directives ................................................................................................. 4.3.7.1 Antennes log-périodiques ......................................................................... 109 109 111 112 115 115 116 117 118 5 Sources d'alimentation et batteries ............................................................................. 118 5.1 Sécurité de l'alimentation..................................................................................................... 118 5.2 Alimentation de secteur ....................................................................................................... 119 5.3 Transformateurs d'alimentation ........................................................................................... 119 5.4 Batteries et chargement ....................................................................................................... 5.4.1 Capacité de batterie ................................................................................................. 5.4.2 Batteries primaires................................................................................................... 5.4.3 Batteries secondaires ............................................................................................... 120 120 121 121 5.5 Inverseurs ............................................................................................................................ 123 5.6 Générateurs.......................................................................................................................... 5.6.1 Considérations relatives à l'installation ................................................................... 5.6.2 Maintenance du générateur ..................................................................................... 5.6.3 Mise à la terre du générateur ................................................................................... 123 124 124 124 5.7 Alimentation solaire ............................................................................................................ 5.7.1 Types de piles solaires............................................................................................. 5.7.2 Spécifications relatives aux piles solaires ............................................................... 5.7.3 Stockage de l'énergie solaire ................................................................................... 5.7.4 Une application typique .......................................................................................... 5.7.5 Quelques conseils pratiques .................................................................................... 5.7.6 Installation des panneaux solaires ........................................................................... 125 125 125 126 127 128 128 Rapport sur la Question 16/2 89 Page 6 Répéteurs et réseaux avec partage des ressources .................................................. 128 6.1 Communication au-delà de la visibilité directe par le biais de relais .................................. 128 6.2 Répéteur de Terre ................................................................................................................ 129 6.3 Systèmes radioélectriques mobiles terrestres avec partage de ressource – unité d'échange centrale ................................................................................................................................ 129 Systèmes radioélectriques mobiles terrestres avec partage des ressources – pas d'unité d'échange centrale................................................................................................................ 130 Bibliographie annotée: choix de textes sur les télécommunications d'urgence ............................. 131 Appendices ................................................................................................................................... 136 6.4 90 Rapport sur la Question 16/2 PARTIE 3 ANNEXE TECHNIQUE QUELQUES ASPECTS TECHNIQUES DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN CAS DE CATASTROPHE 1 Introduction à la Partie 3 du présent Manuel La Partie 1 du présent Manuel avait pour objet de fournir des définitions au lecteur mais aussi de l'informer de divers éléments de politique générale ayant trait aux télécommunications en cas de catastrophe. Après une discussion d'ordre général, le lecteur était invité à examiner les recommandations plus précises qui sont nécessaires pour exploiter un réseau de télécommunication en cas de catastrophe (voir la Partie 2) et qui s'adressent au personnel opérationnel. Afin d'améliorer le thème développé dans les Parties 1 et 2, on trouvera une synthèse des détails techniques et des formules dans la Partie 3. Les deux parties précédentes ont donc été rédigées dans un style narratif, sans compter que le texte a été rendu plus aisément lisible pour le planificateur et le décideur qui ont besoin d'avoir un aperçu général des problèmes, des solutions ainsi que des techniques en matière de télécommunications en cas de catastrophe. Organisation de la Partie 3: • Choix des technologies appropriées pour les télécommunications en cas de catastrophe. • Méthodes de radiocommunication. • L'antenne: partie essentielle de toute station radioélectrique. • Utilisation de stations relais (répéteurs) et de systèmes à commutation automatique de canaux. • Sources d'alimentation (y compris les batteries). De plus, une liste bibliographique donne un certain nombre de références qui permettront au lecteur de consulter une liste complète de sources historiques. Cette liste fournit aussi des informations sur des sources utiles de renseignements supplémentaires en vue d'approfondir les sujets évoqués plus brièvement dans le présent Manuel. A la fin du texte on trouvera un appendice renfermant un certain nombre de documents utiles émanant de diverses sources originales. Enfin, pour que cette introduction soit complète, il convient d'adresser des remerciements à un certain nombre d'organisations participantes sans lesquelles ce travail n'aurait pas été possible. Il y a lieu en particulier de signaler la contribution de différentes personnes travaillant dans deux organisations qui portent un vif intérêt à la question des télécommunications en cas de catastrophe. Il s'agit du Bureau des Nations Unies pour la coordination des secours en cas de catastrophe (OCHA) à Genève et de l'Union internationale des radioamateurs (IARU), notamment son Bureau technique à Washington, DC. Ont également contribué à cette partie: L.M. Ericsson et Volunteers in Technical Assistance (VITA). Rapport sur la Question 16/2 91 2 Choix des technologies appropriées pour les télécommunications en cas de catastrophe 2.1 Simplicité et nouvelles technologies D'une manière générale, les techniques de radiocommunication les plus simples, qui ont résisté à l'épreuve du temps, sont les plus indiquées en cas de catastrophe. Parmi celles-ci, on notera la téléphonie à bande latérale unique (BLU), la télégraphie (CW) en code morse à ondes décamétriques et la téléphonie MF à ondes métriques/décimétriques. De plus, les équipements ont été perfectionnés au fil du temps et leur installation, leur maintenance et leur exploitation sont comprises de tous. Il existe des versions robustes de ces équipements, conçus pour faire face aux rigueurs des moyens de transport et de l'exploitation sur le terrain. Toutefois, des techniques plus nouvelles offrent des fonctions susceptibles de faciliter les télécommunications en cas de catastrophe: les téléphones cellulaires, les systèmes de dispatching radioélectrique, la télécopie, les communications de données, la télévision et les satellites. Chacune de ces technologies a des avantages et des inconvénients qu'il convient d'étudier soigneusement dans la planification. Quant aux technologies émergentes comme les systèmes cellulaires de troisième génération (IMT-2000), la fonction radioélectrique définie par logiciel (SDR), les systèmes à large bande et multimédias, il convient d'évaluer leur aptitude à fonctionner dans des situations d'urgence. La formation du personnel de radiocommunication est un aspect important du choix des technologies appropriées. Il serait vain d'envisager de mettre en œuvre un équipement de télégraphie morse à ondes décamétriques si les opérateurs ne sont pas dûment formés et expérimentés. Le recours à la téléphonie BLU pour éviter de devoir former des télégraphistes morse n'est pas nécessairement une solution à moins que ce personnel n'ait reçu une formation en matière d'installation, de maintenance et d'exploitation d'une station BLU. Il est aussi peu indiqué de mettre en œuvre de nouvelles technologies sans prévoir une offre suivie de main-d'œuvre suffisamment formée aux opérations de planification, d'installation, de maintenance et d'exploitation des systèmes. Le système de télécommunication idéal en cas de catastrophe est un système d'utilisation courante susceptible de fonctionner en cas de catastrophe ou dans d'autres conditions d'urgence. Un autre système à retenir en deuxième choix est celui qui pourra fonctionner périodiquement, sur une base hebdomadaire ou mensuelle, dans des conditions d'urgence simulées. 2.2 Fiabilité de l'infrastructure Les communications à ondes décamétriques, qu'il s'agisse de la téléphonie BLU ou de la télégraphie morse, n'exigent en général aucune infrastructure pour la retransmission ou le traitement: les communications peuvent être acheminées directement de la station d'origine vers la station de destination. Lorsque les distances à parcourir sont grandes, au-delà de 2 000 km, ou lorsque les conditions de propagation sont mauvaises, des stations de base ou des stations relais peuvent faciliter les communications mais ne sont pas absolument nécessaires. 2.3 Transport et mobilité Les nouvelles technologies recouvrent notamment les systèmes de télécommunication comme les stations terriennes portables, les stations de base téléphoniques cellulaires mobiles et portatives ainsi que les stations vidéo de base et distantes pour la télémédecine. Il est des cas où il serait souhaitable de recourir à ces nouvelles technologies dans la zone sinistrée. Néanmoins, il faut tenir compte du transport et de la mobilité avant de faire appel à de tels systèmes. Ainsi, une station terrienne montée sur des palettes pourrait exiger un équipement de traitement spécial pour le chargement et il se peut aussi d'ailleurs que le déchargement d'un aéronef soit réalisable au point d'origine mais pas au point de destination. 92 Rapport sur la Question 16/2 De plus, une fois que le système de télécommunication est déchargé à l'aéroport disponible le plus proche, il faudra avoir le transport au sol nécessaire pour l'acheminer vers la zone sinistrée. Il arrive souvent que les camions et le matériel de chargement soient pleinement déployés sur le lieu du sinistre mais qu'ils ne soient pas disponibles à l'aéroport. Il convient aussi de tenir compte de l'état des routes qui desservent la zone sinistrée. Dans bien des cas, il s'avère impossible d'acheminer les équipements de télécommunication vers le site où ils sont attendus d'urgence en raison des obstacles rencontrés en chemin. 2.4 Interopérabilité Il est important de pouvoir communiquer avec les organisations publiques de protection locales: police, pompiers et service médical, les forces armées locales ainsi qu'avec les organisations internationales de secours d'urgence et les pays voisins. Dans certains cas, il faut que toute station donnée puisse communiquer avec n'importe quelle autre station de la zone sinistrée. Cette aptitude à communiquer peut transcender les structures officielles existantes et permettre aux communications d'être acheminées sans retard vers le destinataire recherché mais aussi sans risque d'interprétation erronée par les intermédiaires. Dans d'autres cas, malheureusement, il faut prévoir des voies distinctes pour différents groupes de stations de sorte qu'il serait difficile, voire impossible à chacun d'utiliser la même voie. 2.5 Comparaison des systèmes à satellites pour les télécommunications en cas de catastrophe 2.5.1 Satellites sur orbite terrestre basse On peut utiliser des satellites sur orbite terrestre basse (LEO) pour relayer des signaux radioélectriques bien au-delà de la visibilité directe. Selon l'altitude, un seul satellite LEO peut relayer des signaux sur des trajets pouvant atteindre environ 5 000 km lorsque les deux stations terriennes sont visibles par le satellite. Cette visibilité ne dure que quelques minutes à des distances aussi grandes. Les stations plus rapprochées peuvent avoir une visibilité mutuelle du satellite pendant des périodes plus longues, pouvant éventuellement atteindre 20 minutes pour un passage favorable. Malheureusement, du fait de leurs orbites, les satellites LEO ne peuvent offrir des communications en temps réel que quelques fois par jour. On peut recourir aux constellations LEO pour assurer un relais continu en temps réel. A cet effet, il faut disposer d'un nombre suffisant de satellites pour qu'un seul satellite au moins soit visible en un point de la Terre à tout moment. De plus, il faut pouvoir mettre en réseau les satellites, par le biais de liaisons intersatellites (de satellite à satellite) ou de stations terriennes situées dans le monde entier. 2.5.2 Satellites géostationnaires Chaque satellite géostationnaire (OSG) positionné à 35 784 km au-dessus de la Terre peut communiquer avec des stations terriennes sur environ un tiers du globe. Ainsi, trois satellites OSG peuvent couvrir la Terre tout entière. 2.5.2.1 INMARSAT par opposition aux microstations (VSAT) et aux nanostations (USAT) Les systèmes de terminaux par satellite basés à terre qui utilisent le réseau à satellite portatif d'INMARSAT ou une microstation semi-fixe (VSAT) assurent les services ordinaires de téléphonie et de communication de données, dont les communications vocales, la télécopie et le courrier électronique. N'importe quel dispositif utilisant un combiné téléphonique ordinaire peut fonctionner avec ces systèmes à satellites. En plus des services susmentionnés, certains terminaux à satellite assurent le transfert de photographies numériques ou la visioconférence en direct. Rapport sur la Question 16/2 93 Figure 1 – Trois satellites en orbite géostationnaire peuvent couvrir la Terre tout entière Le choix entre le terminal INMARSAT et la microstation dépend des spécifications particulières du système en matière de télécommunication. Nombreuses sont les variables différentes qui influeront sur le choix d'une solution par rapport à une autre: coût, mobilité, volume important nécessaire. De plus, il faut aussi tenir compte de l'aptitude du système à prendre en charge plusieurs modes de communication: téléphonie ordinaire, données informatiques (connexions en réseau ou connexions e-mail autonomes), télécopie, messages de texte seulement et visioconférence. 2.5.2.2 INMARSAT Le système INMARSAT se compose de neuf satellites en orbite géostationnaire. Quatre de ces satellites, de la toute dernière génération INMARSAT-3, assurent une couverture mondiale, avec des zones d'exploitation qui se chevauchent. Chaque satellite couvre jusqu'à un tiers de la surface de la Terre et occupe une position stratégique au-dessus de chacune des quatre régions océaniques pour former une couverture ininterrompue. Chaque région est desservie par un satellite actif et par un satellite de rechange opérationnel. Les autres satellites sont utilisés comme réserve ou en tant que capacité louée. Seuls les deux pôles extrêmes de la Terre sont dépourvus d'une couverture satellitaire. Les stations terriennes terrestres relient le système INMARSAT aux réseaux mondiaux de télécommunication fixes. La plupart des appels téléphoniques INMARSAT sont établis à partir de la Terre. L'un des avantages des satellites INMARSAT-3 réside dans leur aptitude à concentrer de la puissance sur telle ou telle zone de trafic élevé à l'intérieur de leur empreinte. Chaque satellite utilise au maximum sept faisceaux ponctuels et un faisceau mondial. Le nombre de faisceaux ponctuels sera choisi en fonction des demandes de trafic. De plus, ces satellites peuvent réutiliser des portions de la bande L pour les faisceaux ponctuels non adjacents, avec pour effet de doubler la capacité du satellite. Les utilisateurs itinérants communiquent directement via les satellites INMARSAT. Des services de temps d'émission sont disponibles dans le monde entier grâce à un réseau de quelque 100 fournisseurs de services. Certains fournisseurs de services exploitent aussi des stations terriennes terrestres INMARSAT. Il existe près de 40 stations de ce type dans 31 pays. Ces stations reçoivent et transmettent des communications par l'intermédiaire des satellites INMARSAT et assurent la connexion entre le système à satellites et les réseaux de télécommunication fixes. 94 Rapport sur la Question 16/2 Figure 2 – Zones de couverture INMARSAT: région de l'océan Atlantique-Est, région de l'océan Atlantique-Ouest, région de l'océan Pacifique et région de l'océan Indien INMARSAT met à disposition une capacité de télécommunications mobiles mondiales par satellite avec plusieurs fonctions pour les besoins de la prévention des désastres et des opérations de secours. Les terminaux INMARSAT sont autonomes et peuvent être opérationnels dans un délai de 10 à 15 minutes après leur arrivée sur le lieu du sinistre. Ils ne dépendent pas des infrastructures locales de télécommunication et peuvent fonctionner avec des batteries ou un dispositif d'alimentation par générateur. Les terminaux INMARSAT peuvent être configurés de façon à assurer des communications entre deux équipes de secours indépendantes travaillant dans la même localité ou à établir des liaisons directes avec des organismes de secours et des fournisseurs de matériel dans le monde entier. Le fonctionnement de l'équipement INMARSAT est simple; celui-ci peut être monté et exploité par du personnel non formé qui se conformera aux instructions fournies avec le matériel. L'équipement est compact et léger. Certains modèles peuvent être portés à la main. Les terminaux INMARSAT peuvent être utilisés dans le monde entier, sous réserve de l'application de la réglementation locale. Pour appeler un terminal INMARSAT à partir d'un réseau fixe, il suffit que l'appelant compose l'ID du terminal souhaité, précédé d'un code spécial à 3 chiffres désignant la «région océanique». S'il téléphone à partir d'un mobile, l'utilisateur compose le numéro du réseau fixe ou mobile souhaité, précédé du code à trois chiffres de la station terrienne terrestre choisie. De nombreux navires commerciaux et militaires sont équipés de terminaux à satellites de station terrienne de navire INMARSAT-A qui permettent d'établir des contacts avec un navire en tout point du globe. Il existe désormais des terminaux INMARSAT-A transportables qui peuvent être logés dans deux conteneurs de la taille d'une valise. En principe, l'antenne parabolique a un diamètre égal ou supérieur à 1 m. Les accessoires sont logés dans une boite séparée qui pèse environ 27 kg. Des services téléphoniques, de télécopie et de courrier électronique peuvent être assurés. Les terminaux INMARSATA ne sont plus fabriqués à l'heure actuelle. Coût standard de temps d'utilisation: 5-7 USD par minute. Rapport sur la Question 16/2 95 Le terminal INMARSAT-B est une version numérique améliorée du terminal INMARSAT-A. Sa taille et son poids sont analogues à ceux d'un terminal INMARSAT-A. L'un et l'autre type de terminal exigent que l'antenne soit pointée en direction du satellite. Pour le service mobile, il faut absolument utiliser une antenne de poursuite. Le terminal INMARSAT-B peut offrir un service de télécopie à 9,6 kbit/s ainsi qu'un service téléphonique de bonne qualité à 16 kbit/s. Des services téléphoniques, de télécopie et de e-mail sont également disponibles. Certains modèles offrent des liaisons de données à grande vitesse ainsi que des lignes téléphoniques/de télécopie multiples (avec central public extérieur). La principale différence tient au fait que les données peuvent être transmises normalement au débit de 9,6 kbit/s ou à 64 kbit/s pour le dispositif de données à grande vitesse. Bien que les frais d'utilisation du réseau soient plus élevés, un débit de données plus rapide signifie que le service est utilisé pendant des périodes plus courtes, ce qui compensera les frais élevés en question. Coût standard d'une unité autonome: norme B: 23 000 USD; norme B + données à grande vitesse: 27 000 USD. Coût standard de temps d'utilisation: norme B: 4-7 USD par minute; norme B + données à grande vitesse: 10 USD par minute. Un terminal à satellite de norme C peut être logé dans une valise et comprend un ordinateur portatif, une imprimante et une antenne équidirective. L'antenne est de conception hémisphérique et n'exige ni pointage ni suivi de précision. Ces petits terminaux assurent des services en mode texte: courrier électronique, télex et messages de données à faible débit (pas de téléphonie). Le terminal comporte une batterie intégrée (capacité de réserve de 4 heures). Coût standard de l'unité 5 000 USD. Coût standard de temps d'utilisation: 0,01 USD par caractère. Le terminal par satellite de norme M est un attaché-case dont le couvercle est muni d'une antenne plate. Il nécessite un ordinateur portatif séparé ou un télécopieur et offre des services téléphoniques, de télécopie ou de courrier électronique. Sa capacité devrait être supérieure à celle d'un terminal INMARSAT-C mais inférieure à celle d'un terminal INMARSAT-B. Le terminal de norme M assure un service téléphonique à 4,8 kbit/s et un service de télécopie à un débit de 2,4 kbit/s. Les mini-terminaux M, moins coûteux que ceux qui sont nécessaires pour fournir les autres services, peuvent néanmoins assurer les services suivants à 2,4 kbit/s: téléphonie, télécopie, transmission de données et courrier électronique. A la différence des autres services décrits plus haut, les utilisateurs de mini-terminaux M communiquent par l'intermédiaire de faisceaux ponctuels puissants déployés du satellite vers la masse continentale située au-dessous. Ce système présente l'avantage de pouvoir utiliser des unités moins puissantes et plus petites ainsi que des antennes de dimensions plus petites. Ces terminaux sont beaucoup plus portatifs et peuvent être logés dans un boîtier de la taille d'une petite valise. Les faisceaux ponctuels peuvent couvrir des étendues d'eau considérables pour les besoins des applications maritimes. Coût standard de l'unité: 6 000 USD; coût standard de temps d'utilisation 2-3 USD par minute. 2.5.2.3 VSAT Le terminal à très petite ouverture d'antenne (microstation) est une technologie de télécommunication par satellite utilisant une petite antenne terrienne, dont le diamètre est généralement compris entre 0,9 et 1,8 mètre, qui sert à assurer des services fiables: téléphonie, données, audio, vidéo, multimédia et transmission à large bande. Les services de microstation forment un réseau composé d'une série de points distants reliés à un centre de commande principal, lequel est relié à son tour dans l'espace à un centre de données ou à un processeur central: la station centrale et un grand nombre de sites dispersés sur le plan géographique. L'une des nombreuses applications de cette technologie est l'Internet via satellite. Les réseaux de microstation se composent d'un secteur spatial et d'un secteur terrestre. Le secteur spatial comprend un satellite géostationnaire qui amplifie et convertit les fréquences. Le secteur terrestre comporte une station centrale (hub) et des microstations distantes. Les réseaux de microstation peuvent avoir une configuration en étoile ou une configuration maillée, les communications étant normalement acheminées par le biais de la station centrale ou directement acheminées entre les microstations (sans devoir recourir à un double bond). 96 Rapport sur la Question 16/2 Compte tenu de l'évolution technologique, la dimension des antennes a été réduite, le coût et la taille de l'électronique ont diminué, la largeur de bande a augmenté et il en est résulté de meilleures capacités de gestion. Lorsque les télécommunications doivent servir à établir une liaison longue distante entre deux nœuds ou plus d'un réseau fixe, un utilisateur peut choisir une microstation pour une durée complète d'utilisation, avec une largeur de bande garantie. Par exemple, certains fournisseurs de services Internet en Amérique du Sud et en Afrique relient leur routeur au principal fournisseur Internet par une liaison VSAT à grande vitesse et à plein temps. La microstation peut mettre à disposition une plate-forme de communication unique qui pourra desservir l'ensemble d'un pays ou d'une région. Pour les applications semi-permanentes ou permanentes, avec un volume important de trafic, la microstation peut s'avérer être la solution la plus appropriée pour un service de télécommunication. S'agissant des terminaux de microstation, le temps de montage varie entre 30 minutes et 3 heures, selon la complexité du système. 2.5.2.4 Réseaux USAT La diffusion de réseaux de microstation dans le service fixe par satellite (SFS) avec des stations terriennes équipées de petites antennes dans des sites distants – comme les terrasses de bâtiments administratifs, les hôtels, les centres commerciaux et autres emplacements utiles – a stimulé le développement d'antennes encore plus petites que celles des microstations, dont l'ouverture équivalente est en principe inférieure à 1 mètre. Dans ce cas, on parle en général de nanostations (VSAT). On observe une dégradation naturelle de la discrimination d'antenne à mesure que la taille de celle-ci diminue. Le service par satellite assure un accès direct et à large bande au réseau fédérateur de l'Internet pour la réception et/ou la réception-transmission des données de l'Internet. On utilise des connexions point à multipoint fondées sur la technologie du relais de trame à grande vitesse. Il est également possible de recourir à des connexions par satellite courantes avec une seule voie par porteuse ou d'utiliser les deux systèmes pour les besoins de la redondance. 3 Méthodes de radiocommunication 3.1 Fréquences Les fréquences radioélectriques devraient être choisies en fonction des caractéristiques de propagation, de l'attribution au service pour lequel ces fréquences sont utilisées et conformément aux règles d'octroi de licences applicables dans le pays où fonctionne la station. Exemple 1: Une station d'amateur qui a reçu une licence pour fonctionner dans un pays donné peut utiliser une fréquence de 7 050 kHz pour communiquer par ondes ionosphériques avec une station distante de 300 km car cette fréquence fait partie de l'attribution du service d'amateur (7 MHz). Exemple 2: Une station mobile terrestre qui a reçu une licence pour fonctionner dans un pays et à qui une fréquence de travail de 151,25 MHz a été assignée peut utiliser cette fréquence pour communiquer jusqu'à une distance d'environ 60 km avec d'autres stations autorisées. 3.1.1 Attribution internationale des fréquences Le spectre des fréquences radioélectriques est divisé en bandes de fréquences dans le cadre de conférences ayant valeur de traité international, qui sont organisées par l'Union internationale des télécommunications (UIT). Ces bandes sont attribuées à des services radioélectriques précis et sont énumérées dans l'article S5 du Règlement international des radiocommunications. Certaines bandes sont attribuées au(x) même(s) service(s) à l'échelle mondiale alors que d'autres sont attribuées à différents services sur une base régionale. Les trois Régions sont indiquées sur la carte ci-après. Rapport sur la Question 16/2 97 1 6 0 ° 1 4 0 ° 1 2 0 ° 1 0 0 ° 8 0 ° 6 0 ° 4 0 ° 2 0 ° C 0 ° 2 0 ° 4 0 ° B 6 0 ° 8 0 ° 1 0 0 ° 1 2 0 ° 1 4 0 ° 1 6 0 ° 1 8 0 ° 1 7 0 ° 1 7 0 ° Figure 3 – Régions définies par l'UIT A 7 5 ° 7 5 ° 6 0 ° R É G IO N R É G IO N 6 0 ° 1 2 4 0 ° 3 0 ° 2 0 ° 4 0 ° 3 0 ° 2 0 ° 0 ° 0 ° 2 0 ° 3 0 ° 4 0 ° 2 0 ° 3 0 ° 4 0 ° C 1 6 0 ° 1 4 0 ° 1 2 0 ° 1 0 0 ° 1 7 0 ° 6 0 ° 3 B 8 0 ° 6 0 ° 4 0 ° 2 0 ° R É G IO N A 0 ° 2 0 ° 4 0 ° 6 0 ° 8 0 ° 3 1 0 0 ° 1 2 0 ° 1 4 0 ° 1 6 0 ° 1 8 0 ° 6 0 ° 1 7 0 ° R É G IO N L a p a r tie o m b r é e c o r r e s p o n d à la Z o n e tr o p ic a le d é f in ie a u x n u m é r o s 5 .1 6 à 5 .2 0 e t 5 .2 1 . 5 -0 1 Un tableau simplifié des fréquences attribuées aux services d'amateur, fixe et mobile est reproduit ci-après (Tableau 1). Tableau 1 – Attribution aux services d'amateur, fixe et mobile (version simplifiée, sans les renvois) Région 1 Région 2 Région 3 1 800-1 850 AMATEUR 1 800-2 000 AMATEUR FIXE 1 850-2 000 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 1 850-2 000 AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique MOBILE sauf mobile aéronautique 2 000-2 045 FIXE 2 000-2 065 FIXE MOBILE 2 107-2 170 FIXE MOBILE 2 194-2 300 FIXE MOBILE 2 505-2 850 FIXE MOBILE 1 810-1 850 AMATEUR MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 2 045-2 160 FIXE MOBILE 2 194-2 300 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 2 502-2 625 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 2 650-2 850 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 98 Rapport sur la Question 16/2 Tableau 1 – Attribution aux services d'amateur, fixe et mobile (version simplifiée, sans les renvois) (suite) Région 1 3 155-3 400 Région 2 FIXE 3 500-3 800 AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique Région 3 MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 3 500-3 750 3 500-3 900 AMATEUR FIXE AMATEUR MOBILE 3 750-4 000 3 800-3 900 FIXE TERRESTRE MOBILE AMATEUR FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 3 950-4 000 FIXE 3 950-4 000 FIXE 4 000-4 063 4 438-4 650 FIXE FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 4 750-4 850 FIXE TERRESTRE MOBILE 4 850-4 995 5 005-5 060 5 060-5 450 5 450-5 480 FIXE TERRESTRE 4 750-4 850 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) FIXE MOBILE TERRESTRE FIXE FIXE 4 438-4 650 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 4 750-4 850 FIXE Mobile terrestre Mobile sauf mobile aéronautique MOBILE 5 450-5 480 FIXE TERRESTRE MOBILE 5 730-5 900 FIXE 5 730-5 900 FIXE 5 730-5 900 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) MOBILE sauf mobile aéronautique (R) Mobile sauf mobile aéronautique (R) 6 765-7 000 FIXE Mobile terrestre 7 000-7 100 AMATEUR 7 350-8 100 8 100-8 195 7 100-7 300 AMATEUR FIXE Mobile terrestre FIXE 9 040-9 400 FIXE 9 900-9 995 10 100-10 150 10 150-11 175 FIXE FIXE FIXE 11 400-11 600 FIXE 12 100-12 230 FIXE 13 360-13 410 13 410-13 570 FIXE FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 13 870-14 000 FIXE Mobile sauf mobile aéronautique (R) 14 000-14 250 AMATEUR 14 250-14 350 AMATEUR 14 350-14 990 FIXE 15 800-16 360 FIXE 17 410-17 480 FIXE 18 030-18 068 FIXE 18 068-18 168 AMATEUR 18 168-18 780 FIXE 19 020-19 680 FIXE 19 800-19 990 FIXE 20 010-21 000 FIXE 21 000-21 450 AMATEUR 21 850-21 924 FIXE AMATEUR PAR SATELLITE Amateur Mobile sauf mobile aéronautique (R) AMATEUR PAR SATELLITE Mobile sauf mobile aéronautique (R) AMATEUR PAR SATELLITE Mobile sauf mobile aéronautique Mobile AMATEUR PAR SATELLITE Rapport sur la Question 16/2 99 Tableau 1 – Attribution aux services d'amateur, fixe et mobile (version simplifiée, sans les renvois) (fin) Région 1 Région 2 22 855-23 000 FIXE 23 000-23 200 FIXE 23 200-23 350 FIXE 23 350-24 000 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 24 000-24 890 FIXE MOBILE TERRESTRE 24 890-24 990 AMATEUR 25 010-25 070 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 25 210-25 550 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 26 175-27 500 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 27,5-28 FIXE MOBILE 28-29,7 AMATEUR 29,7-47 FIXE Région 3 Mobile sauf mobile aéronautique (R) AMATEUR PAR SATELLITE AMATEUR PAR SATELLITE MOBILE 47-50 FIXE MOBILE 47-50 FIXE MOBILE MOBILE 50-54 AMATEUR 54-68 Fixe Mobile 54-68 FIXE 68-74,8 FIXE 68-72 Fixe Mobile 68-74,8 FIXE MOBILE MOBILE sauf mobile aéronautique 72-73 FIXE 75,4-87 FIXE MOBILE 87-100 FIXE MOB ILE MOBILE 74,6-74,8 FIXE 75,2-87,5 FIXE 75,2-75,4 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 75,4-76 FIXE 76-88 Fixe 137-138 Fixe MOBILE MOBILE MOBILE Mobile Mobile sauf mobile aéronautique (R) 138-144 FIXE 144-146 AMATEUR 146-148 FIXE MOBILE MOBILE AMATEUR PAR SATELLITE 146-148 AMATEUR MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 148-149,9 FIXE 138-144 FIXE 146-148 AMATEUR FIXE MOBILE 148-149,9 FIXE MOBILE 150,05-174 FIXE MOBILE MOBILE sauf mobile aéronautique (R) 150,05-174 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 174-216 Fixe Mobile 174-223 FIXE MOBILE 223-230 FIXE MOBILE 216-220 FIXE 220-225 AMATEUR 223-230 Fixe Mobile FIXE MOBILE 401-406 Fixe Mobile sauf mobile aéronautique 406,1-430 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 430-440 AMATEUR 430-440 Amateur 440-450 FIXE MOBILE sauf mobile aéronautique 450-470 FIXE MOBILE 3.1.2 Attribution nationale des fréquences Les tableaux d'attribution des bandes de fréquences de la plupart des pays suivent de près le Tableau international d'attribution des fréquences. Il existe des exceptions et il faut connaître et respecter les règles nationales concernant les fréquences et leur utilisation. 100 3.1.3 Rapport sur la Question 16/2 Assignation de fréquence Il appartient aux administrations nationales d'assigner des fréquences radioélectriques particulières aux stations radioélectriques. Tel est le cas pour les services fixe et mobile. Les stations d'amateur ne disposent généralement pas d'assignation de fréquence et sont libres de choisir dynamiquement telle ou telle fréquence de travail dans une bande attribuée. Dans certains cas, les administrations peuvent assigner des fréquences à des services ne faisant pas l'objet d'attributions dans le Tableau international des attributions de fréquences, à condition de ne pas causer de brouillage. Cette possibilité est prévue dans le Règlement des radiocommunications qui dispose ce qui suit: S4.4 Les administrations des Etats Membres ne doivent assigner à une station aucune fréquence en dérogation au Tableau d'attribution des bandes de fréquences du présent chapitre ou aux autres dispositions du présent Règlement, sauf sous la réserve expresse qu'une telle station, lorsqu'elle utilise cette assignation de fréquence, ne cause aucun brouillage préjudiciable à une station fonctionnant conformément aux dispositions de la Constitution, de la Convention et du présent Règlement, et qu'elle ne demande pas de protection contre les brouillages préjudiciables causés par cette station. Dans des situations d'urgence, les administrations peuvent appliquer la disposition ci-après du Règlement des radiocommunications: S4.9 Aucune disposition du présent Règlement ne peut faire obstacle à l'emploi par une station en détresse ou par une station lui portant secours, de tous les moyens de radiocommunication dont elles disposent pour attirer l'attention, signaler l'état et la position de la station en détresse et obtenir du secours ou prêter assistance. Les stations des services fixe et mobile engagées dans des missions de communication en cas d'urgence devraient pouvoir compter sur une famille de fréquences qu'elles pourront choisir en fonction des caractéristiques de propagation pour tel ou tel trajet. 3.2 Propagation Les signaux radioélectriques sont des ondes électromagnétiques qui se propagent dans l'atmosphère de la Terre et dans l'espace. Ces ondes se propagent par différents mécanismes, à savoir: ondes de surface, ondes directes ou d'espace (visibilité directe), diffraction (propagation sur une arête en lame de couteau), réfraction ionosphérique (ondes ionosphériques), réfraction troposphérique et conduits troposphériques. La propagation ionosphérique varie en fonction de l'heure du jour, de la saison de l'année, de l'activité solaire (nombre de taches solaires), de la distance du trajet et enfin, de l'emplacement des émetteurs et des récepteurs. La propagation troposphérique est, dans une certaine mesure, liée aux conditions climatiques. On peut se reporter à la Recommandation UIT-R P.1144 intitulée «Guide pour l'application des méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 des radiocommunications» pour déterminer les méthodes de propagation qu'il conviendrait d'utiliser pour différentes applications. Des programmes informatiques sont également disponibles auprès de l'UIT-R. 3.2.1 Ondes de sol Les ondes de sol sont limitées à la basse atmosphère de la Terre. Les distances dépendent de la puissance d'émission, du rendement de l'antenne, de la conductivité du sol et des niveaux de bruit atmosphérique. Les courbes de propagation de l'onde de sol pour des fréquences comprises entre 10 kHz et 30 MHz sont indiquées dans la Recommandation UIT-R P.368. Concrètement, pour les communications en cas d'urgence, les ondes de sol ne sont utiles qu'au niveau inférieur des fréquences élevées (proches de 3 MHz) et pour des distances relativement courtes de quelques kilomètres. Rapport sur la Question 16/2 3.2.2 101 Propagation des ondes ionosphériques Les ondes ionosphériques utilisent l'ionosphère de la Terre pour réfracter le signal. L'ionosphère est formée de plusieurs couches qui sont identifiées par des lettres de l'alphabet. La couche D se situe entre 60 et 92 km au-dessus de la Terre. La couche E se situe entre 100 et 115 km au-dessus de la Terre. La couche D est utilisée pour la propagation des ondes ionosphériques à ondes hectométriques. Les couches D et E absorbent les signaux aux fréquences de la partie inférieure de la bande des ondes décamétriques au voisinage de 3 MHz. La couche F (entre 160 -> 500 km) peut être scindée en deux couches, F1 et F2 et admettre des fréquences sur la totalité de la bande des ondes décamétriques sur de grandes distances. Les fréquences et les distances varient en fonction du trajet, de l'heure du jour, de la saison et de l'activité solaire. Pour la prévision de la propagation des ondes décamétriques dans la gamme de fréquences 2-30 MHz, il convient de se reporter à la Recommandation UIT-R P.533. Figure 4 – Illustration de la propagation des signaux radioélectriques à ondes décamétriques dans l'ionosphère. Les fréquences au-dessus de la fréquence maximale utilisable (MUF) pénètrent dans l'ionosphère et vont dans l'espace. Les fréquences situées au-dessous de la MUF sont réfractées vers la Terre. Les ondes de sol, les zones de silence ainsi que les trajets à bonds multiples sont représentés Ionosphère 2e bond Zone de silence 2e zone de silence Distance de saut 2e distance de saut Ondes de sol 3.2.2.1 Ondes ionosphériques à incidence quasi verticale Le terme «onde ionosphérique à incidence quasi verticale» (NVIS) décrit des trajets ionosphériques à grand angle couvrant de courtes distances. Cette onde est particulièrement indiquée pour des distances tout juste supérieures à celles qui s'appliquent aux ondes métriques ou décimétriques. Pour obtenir de bons résultats, il faut sélectionner des fréquences au-dessous de la fréquence critique, c'est-à-dire que les fréquences se situeront entre 2 et 6 MHz, soit la partie supérieure de la gamme pendant la journée et la partie inférieure pendant la nuit. L'angle de site de l'antenne est essentiellement droit dans le ciel de sorte qu'une antenne courante est polarisée horizontalement et à quelques mètres à peine au-dessus du sol. 102 Rapport sur la Question 16/2 Figure 5 – L'ionosphère comprend plusieurs régions de particules ionisées à différentes hauteurs au-dessus de la Terre. Les régions D et E disparaissent pendant la nuit, alors que, dans le même temps, les régions F1 et F2 se combinent en une seule région F IONOSPHÈRE COUCHE F PENDANT LA NUIT LES COUCHES F 1 ET F 2 SE COMBINENT PENDANT LA NUIT Rapport sur la Question 16/2 103 Figure 6 – Trajets des ondes ionosphériques à incidence quasi verticale COUCHE F1 COUCHE F2 COUCHE E 3.2.3 Propagation à ondes métriques/décimétriques Les signaux radioélectriques se propagent légèrement au-delà de la limite de visibilité directe optique, comme si le rayon de la Terre correspondait à 4/3 de sa taille réelle. On peut établir l'approximation suivante de l'horizon radioélectrique pour les signaux en ondes métriques/décimétriques par la formule: D = 4,124 h–2 où: D : distance exprimée en kilomètres h–2 : racine carrée de la hauteur d'antenne au-dessus du sol, exprimée en mètres. Pour calculer l'affaiblissement de transmission en espace libre on peut se reporter à la Recommandation UIT-R P.525. 3.2.3.1 Liaisons point à zone S'il existe un émetteur desservant de nombreux récepteurs distribués de façon aléatoire (par exemple, dans le service mobile), on calcule le champ en un point situé à une distance appropriée de l'émetteur par la relation: e = 30 p d où: e : valeur efficace du champ (V/m) (voir la Note 1) p : puissance isotrope rayonnée équivalente (p.i.r.e) dans la direction du point en question (W) d : distance de l'émetteur au point en question (m). 104 Rapport sur la Question 16/2 On peut recourir à la Recommandation UIT-R P.529 aux fins de prévision de la propagation pour le service mobile terrestre point à zone dans les bandes d'ondes métriques (10-600 km) et décimétriques (1-100 km). 3.2.3.2 Liaisons point à point Avec une liaison point à point, il est préférable de calculer l'affaiblissement en espace libre entre antennes isotropes, appelé aussi affaiblissement d'espace libre (symboles: Lbf ou A0), de la manière suivante: æ 4π d ö ÷÷ Lbf = 20 log çç è λ ø dB où: Lbf : affaiblissement d'espace libre (dB) d : distance λ : longueur d'onde d et λ sont exprimés avec la même unité. L'équation ci-dessus peut encore s'écrire en utilisant la fréquence au lieu de la longueur d'onde. Lbf = 32,4 + 20 log ƒ + 20 log d dB où: f : fréquence (MHz) d : distance (km). On peut recourir à la Recommandation UIT-R P.530 aux fins de prévision de la propagation point à zone pour la gamme 150 MHz-40 GHz et pour des distances allant jusqu'à 200 km. 3.2.3.3 Formules de conversion Sur la base d'une propagation d'espace libre, il possible d'utiliser les formules de conversion suivantes: Champ correspondant à une puissance isotrope rayonnée émise donnée: E = Pt – 20 log d + 74,8 Puissance isotrope reçue pour un champ donné: Pr = E – 20 log f – 167,2 Affaiblissement d'espace libre pour une puissance isotrope rayonnée et un champ donnés: Lbf = Pt − E + 20 log f + 167,2 Rapport sur la Question 16/2 105 Puissance surfacique pour un champ donné: S = E – 145,8 où: Pt : puissance isotrope rayonnée (dB(W)) r : puissance isotrope reçue (dB(W)) E : champ électrique (dB(µV/m)) f : fréquence (GHz) d : longueur du trajet radioélectrique (km) Lbf : affaiblissement de propagation en espace libre (dB) S : puissance surfacique (dB(W/m2)) Pour plus d'informations sur la propagation en visibilité directe point à point, voir la Recommandation UIT-R P.530. 4 L'antenne: partie essentielle de toute station radioélectrique 4.1 Choix de l'antenne Deux vérités concernant les antennes s'imposent très vite aux spécialistes en communication: • il est préférable d'avoir une antenne, quelle qu'elle soit, plutôt que ne pas en avoir; • si l'on souhaite améliorer les communications, mieux vaut en général consacrer du temps, des efforts et de l'argent au système d'antenne plutôt que réaliser un investissement équivalent dans n'importe quelle autre partie de la station. L'antenne convertit l'énergie en ondes radio lesquelles se transforment en énergie électrique, de sorte qu'il suffit d'une antenne pour assurer des communications radio bidirectionnelles. Le succès de la communication dépend principalement de l'antenne. Avec une bonne antenne, un récepteur normal peut donner de bons résultats et sembler beaucoup plus puissant même s'il n'a que quelques watts. Puisque la même antenne sert à l'émission et à la réception, toute amélioration apportée à l'antenne permet de renforcer le signal aux points de réception souhaités. Certaines antennes fonctionnent mieux que d'autres. Il est donc utile d'expérimenter différents types d'antennes. 4.2 Considérations relatives au système d'antenne 4.2.1 Sécurité La sécurité est le premier facteur qu'il faut prendre en considération dans l'installation d'un système d'antenne. Une antenne ou une ligne de transmission ne devrait jamais être installée sur des lignes d'alimentation électrique. Une antenne verticale ne devrait jamais être placée à proximité des lignes d'alimentation électrique en raison du risque d'électrocution si celles-ci devaient entrer en contact avec l'antenne. Les antennes devraient être placées à une hauteur suffisante par rapport au sol pour empêcher quiconque de les toucher. Lorsque l'émetteur est actif, les hautes tensions présentes aux extrémités d'une antenne pourraient causer un accident mortel ou du moins de graves brûlures. 106 Rapport sur la Question 16/2 Un parafoudre devrait être placé sur la ligne de transmission à l'entrée du bâtiment où sont logés les équipements d'émission et de réception. Pour des raisons de sécurité, une mise à la terre est nécessaire et le fil utilisé à cet effet devrait être un conducteur ayant un diamètre d'au moins 2,75 mm. Le gros fil en aluminium utilisé pour la mise à la terre des antennes de télévision donne de bons résultats. On peut aussi utiliser un fil tressé de cuivre de 20 mm de large. Comme prise de terre on pourra utiliser la canalisation d'eau, la structure métallique enterrée d'un bâtiment ou un ou plusieurs piquets de mise à la terre d'un diamètre de 15 mm, enfoncés à une profondeur d'au moins 2,5 mètres. Pour installer l'antenne, il faut parfois monter sur une tour, dans un arbre ou sur le toit. Il est risqué de travailler seul. Chaque mouvement doit être prévu au préalable. La personne qui se trouve sur l'échelle, la tour, dans l'arbre ou sur le toit devrait toujours porter une ceinture de sécurité et veiller à ce qu'elle soit bien attachée. Avant chaque utilisation il convient d'inspecter soigneusement la ceinture pour détecter tout éventuel dommage: entaille ou usure. Le port de la ceinture facilitera sensiblement le travail sur l'antenne et évitera aussi toute chute accidentelle. Il est également important de mettre un casque de protection et des lunettes de sécurité. Lorsqu'on monte sur une tour, dans un arbre, ou sur le toit, il ne faut pas porter les outils à la main mais les placer dans un porte-outils. Il faut que la ceinture soit attachée à une longue corde pendant jusqu'au sol, que l'on peut utiliser pour remonter d'autres objets nécessaires. Il est utile (et prudent) d'attacher tous les outils avec des ficelles ou des cordes légères. Cela évitera de perdre du temps à chercher les outils qui seraient tombés et permettra de limiter tout risque de blesser le personnel au sol venu offrir son aide. Les auxiliaires au sol ne devraient jamais rester postés directement au-dessous de l'antenne qui est en train d'être installée. Ils devraient tous porter des casques de protection et des lunettes de sécurité. En effet, la chute d'un petit outil d'une hauteur de 15 ou 20 mètres peut causer des blessures. L'auxiliaire doit toujours observer avec soin le travail effectué sur la tour. L'observateur chargé de veiller uniquement à prévenir tout danger éventuel devrait, si possible, être positionné de façon à avoir un bon aperçu des travaux en cours. 4.2.2 Emplacement de l'antenne Après avoir assemblé les éléments de l'antenne, il faut choisir un endroit approprié pour son installation. Il faut éviter de placer l'antenne parallèlement et à proximité des lignes d'alimentation ou téléphoniques car il pourrait en résulter un couplage électrique parasite occasionnant du bruit dans la ligne d'alimentation du récepteur de l'antenne ou la présence d'un signal sur les lignes d'alimentation ou téléphoniques. Il faut éviter de placer l'antenne à proximité d'objets métalliques comme les gouttières, les poutres métalliques, les revêtements métalliques ou même le câblage électrique sous le toit d'un bâtiment. Les objets métalliques peuvent faire écran à l'antenne ou en modifier le diagramme de rayonnement. 4.2.3 Polarisation de l'antenne La polarisation renvoie au champ électrique d'une onde. Une antenne qui est parallèle à la surface de la Terre produit des ondes à polarisation horizontale alors qu'une antenne qui est perpendiculaire à cette surface (à un angle de 90°), produit des ondes à polarisation verticale. La polarisation est tout particulièrement importante lorsqu'il faut installer des antennes fonctionnant à ondes métriques ou décimétriques. En général, la polarisation d'un signal de Terre à ondes métriques ou décimétriques ne varie pas de l'antenne d'émission à l'antenne de réception. Les stations d'émission et de réception devraient utiliser la même polarisation. La polarisation verticale s'utilise généralement avec les mobiles à ondes métriques/décimétriques (émetteurs-récepteurs portatifs), dans les véhicules et les stations de base. Dans le cas des communications en ondes ionosphériques (HF), les signaux radioélectriques ont tendance à subir une rotation dans l'ionosphère, si bien que l'on peut utiliser indistinctement des antennes à polarisation horizontale ou à polarisation verticale. Il est préférable de recourir aux antennes à polarisation horizontale pour la réception car elles ont tendance à rejeter le bruit artificiel local qui est généralement à polarisation verticale. Rapport sur la Question 16/2 107 Les antennes verticales ont un rayonnement angulaire faible mais nul vers le haut (aucun rayonnement d'énergie). Elles se prêtent donc aux trajets plus longs des ondes ionosphériques qui nécessitent un angle de site faible et ne sont pas recommandées pour les trajets d'ondes ionosphériques à incidence quasi verticale (NVIS) compris entre 0 et 500 km. 4.2.4 Accord de l'antenne La longueur d'antenne exprimée par une équation n'est qu'une approximation. Différents facteurs influent sur la fréquence de résonance d'une antenne: les arbres, les bâtiments ou les grands objets métalliques situés à proximité, ainsi que la hauteur au-dessus du sol. L'utilisation d'un TOS-mètre peut aider à déterminer s'il convient de raccourcir ou d'allonger l'antenne. La longueur correcte indique la meilleure adaptation d'impédances de l'émetteur. Après avoir coupé le fil à la longueur indiquée dans l'équation, il convient d'accorder l'antenne de façon à obtenir le meilleur fonctionnement possible. Une fois que l'antenne est finalement installée sur le site prévu, il faut observer le TOS à différentes fréquences dans la bande souhaitée. Si ce taux est beaucoup plus élevé à proximité des fréquences basses de la bande, l'antenne est trop courte. Dans ce cas, on peut attacher une longueur supplémentaire de fil à chaque extrémité avec une pince crocodile. On pourra alors raccourcir progressivement la longueur supplémentaire jusqu'à trouver la longueur qui convient. Si le taux est trop élevé à l'extrémité des fréquences supérieures de la bande, l'antenne est trop longue. Lorsque l'antenne est bien accordée, les valeurs les plus faibles du TOS devraient se situer autour de la fréquence de travail préférée. 4.2.5 Lignes de transmission Le câble coaxial dans lequel un conducteur est entouré d'un autre conducteur est le type de ligne de transmission le plus fréquent utilisé dans un système d'antenne. Le câble coaxial offre plusieurs avantages: il est facilement disponible et résistant aux intempéries. Il peut être enterré dans le sol si nécessaire, plié, courbé et placé à côté d'une structure métallique sans aucun problème particulier. La plupart des antennes ordinaires à ondes décamétriques sont conçues pour une utilisation avec des lignes de transmission ayant une impédance caractéristique d'environ 50 ohms. Câbles coaxiaux les plus courants: RG-8, RG-58, RG-174 et RG-213. Les câbles de type RG-8 et RG-213 sont similaires et se caractérisent par l'affaiblissement le plus faible par rapport aux différents types énumérés ici. L'affaiblissement du signal est plus faible dans les gros câbles coaxiaux (RG-8, RG-213, RG-11) que dans les petits. Si la ligne d'alimentation est inférieure à 30 mètres de long, le petit affaiblissement supplémentaire du signal relevé dans les bandes d'ondes décamétriques est négligeable. En revanche, les pertes dans les bandes d'ondes métriques/décimétriques sont beaucoup plus perceptibles, surtout lorsque la ligne d'alimentation est longue. Pour ces bandes, l'utilisation de câbles coaxiaux RG-213 de grande qualité ou même de câbles coaxiaux rigides à plus faible perte ou semi-rigides permet de minimiser les pertes pour les lignes de transmission supérieures à 30 mètres. Les connecteurs des câbles coaxiaux constituent une partie importante de la ligne d'alimentation du câble coaxial. Il est prudent de vérifier périodiquement les connecteurs pour voir s'ils sont propres et étanches, afin de minimiser les pertes. Si l'on soupçonne une mauvaise soudure, il convient de nettoyer les joints et de les ressouder. Le choix des connecteurs dépend généralement des connecteurs d'adaptation sur les radios. De nombreuses radios à ondes décamétriques et à ondes métriques utilisent des connecteurs SO-239. Le connecteur homologue est un connecteur PL-259 (Figure 7). Il est parfois appelé connecteur à ondes décimétriques, bien que les connecteurs à impédance constante comme celui de type-N soient les plus indiqués pour les bandes d'ondes décimétriques. Les connecteurs PL-259 sont conçus pour une utilisation avec des câbles RG-8 ou RG-213. Lorsqu'on utilise un câble coaxial pour connecter la ligne de transmission, il faut placer un connecteur SO-239 à la fin de la ligne au niveau de l'isolateur central et utiliser un connecteur PL-259 à l'extrémité de raccordement avec la radio. 108 Rapport sur la Question 16/2 Figure 7 – Connecteur coaxial PL-259 Gaine extérieure Tresse Conducteur central Diélectrique interne Conducteur central Coupleur Modèle coupé (D) 4.2.6 Etain Conducteur central - Soudure Soudeur - Tresse (4 endroits) Adaptation d'impédance dans le système d'antenne Si le système d'antenne n'arrive pas à adapter l'impédance caractéristique de l'émetteur, une partie de la puissance est réfléchie de l'antenne vers l'émetteur. En pareil cas, la tension RF et le courant ne sont pas uniformes le long de la ligne. La puissance qui se propage de l'émetteur vers l'antenne est appelée puissance incidente et elle est rayonnée à partir de l'antenne. Le taux d'ondes stationnaires (TOS) est le taux des amplitudes maximales et minimales du courant dans une ligne. Un TOS-mètre mesure l'adaptation d'impédance relative entre une antenne et sa ligne d'alimentation. Lorsque les valeurs du TOS sont faibles, cela signifie qu'il existe une meilleure adaptation d'impédance entre l'émetteur et le système d'antenne. Si l'adaptation est parfaite, le TOS est 1:1. Le TOS définit la qualité d'une antenne vue depuis l'émetteur mais un TOS faible ne garantit pas que l'antenne rayonnera l'énergie RF qui lui est fournie par l'émetteur. Un TOS de 2:1 dénote une assez bonne adaptation d'impédance. 4.2.7 TOS-mètres L'application la plus courante d'un TOS-mètre consiste à accorder une antenne pour qu'elle résonne sur une fréquence donnée. Une valeur du TOS égale ou inférieure à 2:1 est tout à fait acceptable alors qu'une valeur supérieure ou égale à 4:1 est inacceptable. Cela signifie qu'il existe un défaut d'adaptation grave des impédances entre l'émetteur, l'antenne ou la ligne d'alimentation. La mesure du TOS dépend du type d'appareil utilisé pour réaliser ces mesures. Certains TOS-mètres disposent d'une commande de variation de la SENSIBILITÉ et d'un commutateur de puissance INCIDENTE/RÉFLÉCHIE. Dans ce cas, on obtient en général une lecture directe du TOS. Pour utiliser cet appareil, il faut enclencher le commutateur sur la position PUISSANCE INCIDENTE, puis régler la commande de SENSIBILITÉ et la puissance de sortie de l'émetteur pour lire les valeurs indiquées sur l'appareil. Sur la face avant de certains appareils de mesure, on peut lire «RÉGLAGE» ou «ÉTALONNAGE». Le commutateur doit rester sur cette position. Il faut ensuite le commuter sur la position PUISSANCE RÉFLECHIE, opération qui doit être réalisée sans réajuster la puissance de l'émetteur ou de la commande de SENSIBILITÉ de l'appareil de mesure. On obtient désormais la valeur du TOS. Il faudra alors rechercher la fréquence de résonance d'une antenne en connectant l'appareil de mesure entre la ligne d'alimentation et l'antenne. Cette technique mesurera l'adaptation d'impédance relative entre l'antenne et sa ligne d'alimentation. Il faut privilégier les paramètres qui fournissent le TOS le plus faible à la fréquence de travail. Rapport sur la Question 16/2 4.2.8 109 Réseaux adaptateurs d'impédance d'antennes Le réseau adaptateur d'impédance est un autre accessoire utile. On l'appelle aussi circuit d'adaptation d'antenne, boîte d'accord d'antenne, adaptateur d'impédance d'antenne ou tout simplement tuner. Le réseau compense tout défaut d'adaptation d'impédance entre l'émetteur, la ligne de transmission et l'antenne. Un tuner permet d'utiliser une antenne sur plusieurs bandes de fréquences. Il est connecté à l'antenne et au TOS-mètre, si cet appareil est utilisé. Le TOS-mètre sert à indiquer la puissance minimale réfléchie sur laquelle est réglé le tuner. Il ne manque plus qu'une opération à réaliser pour que l'antenne soit totalement installée. Après avoir acheminé le câble coaxial vers votre station, il faut le couper à la longueur voulue et installer le connecteur qui sera utilisé avec l'émetteur. Ce connecteur sera en général de type PL-259, parfois appelé connecteur à ondes décimétriques. La Figure 7 indique comment il faut raccorder ces éléments au câble RG-8 ou au câble RG-11. Il est important de placer la bague de raccordement sur le câble avant le corps du connecteur. Avec un câble RG-58 ou RG-59, il faut utiliser un adaptateur pour raccorder le câble au connecteur. Le connecteur femelle SO-239 est courant sur bon nombre d'émetteurs et de récepteurs. Si le TOS est très élevé, il peut se poser un problème qui ne saurait être résolu par un accord simple. En effet, cela peut signifier que la ligne d'alimentation est ouverte ou raccourcie mais aussi que la connexion est mauvaise ou qu'il existe un espace insuffisant entre l'antenne et les objets environnants. 4.3 Antennes utilisées dans la pratique 4.3.1 Doublet demi-onde L'antenne à ondes décamétriques qui est probablement la plus courante se présente sous la forme d'un fil coupé à une demi-longueur d'onde (½ λ) à la fréquence de travail. La ligne de transmission passe à travers un isolateur au centre du fil. Il s'agit du doublet demi-onde, souvent appelé doublet ou antenne bipôle. (bi signifie deux, de sorte que le doublet est composé de deux parties égales. Un doublet peut avoir une longueur autre que ½ λ). La longueur totale d'un doublet demi-onde est de ½ λ. La ligne d'alimentation relie le centre de sorte que chaque côté de ce doublet a une longueur de ¼ λ. On peut déterminer la longueur d'onde dans l'espace en divisant le chiffre constant de 300 par la fréquence exprimée en mégahertz (MHz). Par exemple, à 15 MHz, la longueur d'onde est 300/15 = 20 mètres. Les signaux radioélectriques se déplacent plus lentement dans un fil que dans l'air si bien que l'on peut utiliser l'équation qui suit pour trouver la longueur totale d'un doublet ½ λ pour une fréquence donnée. On notera que dans cette équation la fréquence est exprimée en MHz et que la longueur d'antenne est exprimée en mètres. L (en mètres) = 143 f MHz Cette équation tient également compte d'autres facteurs, souvent appelés effets d'antenne. L'équation donne la longueur approximative du fil pour un doublet à ondes décamétriques; elle ne sera pas aussi précise pour les antennes fonctionnant à ondes métriques/décimétriques. Le diamètre de l'élément correspond à un pourcentage plus important de la longueur d'onde pour les ondes métriques et les ondes supérieures. Cette équation est également moins précise aux ondes métriques/décimétriques en raison de la présence d'autres effets tels que les effets d'extrémité. 110 Rapport sur la Question 16/2 Tableau 2 – Longueurs approximatives des doublets ½ λ pour bandes destinées aux services fixe, mobile et d'amateur Fréquence (MHz) 3,3 3,5 3,8 4,5 4,9 5,2 5,8 6,8 7,1 7,7 9,2 9,9 10,1 10,6 11,5 Longueur (m) 43,3 40,8 37,6 31,8 29,2 27,5 24,6 21,0 20,1 18,6 15,5 14,4 14,1 13,5 12,4 Fréquence (MHz) 12,2 13,4 13,9 14,2 14,6 16,0 17,4 18,1 20,0 21,2 21,8 23,8 24,9 25,3 29,0 Longueur (m) 11,7 10,7 10,3 10,0 9,8 8,8 8,2 7,9 7,1 6,7 6,5 6,0 5,7 5,6 4,9 Fréquence (MHz) 30 35 40 50 145 150 155 160 165 170 435 450 455 460 465 Longueur (m) 4,8 4,1 3,6 2,86 99 cm 95 92 89 87 84 33 32 31,4 31 30,7 Figure 8 – Construction d'un doublet demi-onde simple. En haut: assemblage des éléments du doublet. En bas à gauche: connexion des extrémité des brins aux isolateurs. En bas à droite: connexion de la ligne de transmission au centre du doublet Câble coaxial enroulé autour de l'isolateur Longueur calculée Hauban vers le support Isolateur Câble coaxial Câble coaxial enroulé autour de l'isolateur Soudure Oeil de l'isolateur Soudure Tresse Ne pas serrer cette boucle Protéger ce point avec un ruban isolant pour éviter toute humidité dans le câble coaxial Soudure Conducteur interne Câble coaxial Rapport sur la Question 16/2 111 Le fil électrique de type domestique ainsi que le fil torsadé s'allongeront avec le temps, phénomène qui sera beaucoup moins notable avec un fil d'acier, gainé de cuivre épais. Le doublet devrait être coupé conformément aux dimensions indiquées dans l'équation ci-dessus (longueur totale d'un doublet de ½ λ), mais il convient de prévoir une longueur supplémentaire pour entourer les extrémités autour des isolateurs. Il faut une ligne de transmission coaxiale ou parallèle pour relier l'antenne à l'émetteur. Il faut aussi trois isolateurs. Si le support de l'antenne se trouve au milieu, les deux extrémités s'affaisseront vers le sol. Cette antenne, connue sous le nom de doublet en V renversé, est presque omnidirective et offre le meilleur rendement lorsque l'angle entre les brins est égal ou supérieur à 90°. Un doublet peut aussi être soutenu à une seule extrémité; dans ce cas, on parle de doublet incliné. Figure 9 – Différentes façons d'installer un doublet. La configuration à gauche est un doublet en V renversé. Un doublet incliné est représenté à droite. Un symétriseur (non représenté) peut être utilisé au point d'alimentation, car il s'agit là d'une antenne équilibrée Vers le support Arbre, mât, tour, etc. Câble coaxial vers station Angle de 90 à 100° Poteau de support 2 à 3 mètres au minimum Doublet en V renversé (B) Câble coaxial de 50 ou 72 ohms Poteau de support de 2 à 3 mètres Vers la station Doublet incliné Les doublets présentent le meilleur rayonnement lorsqu'ils décrivent un angle de 90° par rapport aux brins de l'antenne. Supposons par exemple qu'un doublet soit installé de telle sorte que les extrémités du brin soient orientées dans le sens est/ouest. En admettant que cette antenne soit située à une hauteur suffisante au-dessus du sol (par exemple, hauteur de ½ λ), elle enverrait des signaux de plus grande intensité vers le nord et vers le sud. Un doublet peut aussi émettre de l'énergie radioélectrique directement vers le haut ou vers le bas. Il va de soi que le doublet émet aussi de l'énergie aux extrémités du brin mais ces signaux seront affaiblis. Si cette antenne permet d'établir un contact avec des stations situées à l'est et à l'ouest, les signaux émis en direction de stations au nord et au sud auront une intensité plus forte. 4.3.2 Doublet replié à large bande La version large bande du doublet, le doublet replié (Figure 10) a une impédance d'environ 300 ohms, et peut être alimentée directement avec n'importe quelle longueur de ligne d'alimentation à 300 ohms. On dit de cette variante du doublet qu'elle est à large bande car elle permet une meilleure adaptation à la ligne d'alimentation sur une gamme de fréquences légèrement plus grande. Lorsqu'un doublet replié est installé comme doublet en V renversé, il est essentiellement équidirectif. On trouve dans le commerce plusieurs doublets repliés à large bande qui permettent un fonctionnement acceptable à ondes décamétriques même sans tuner. 112 Rapport sur la Question 16/2 Figure 10 – Doublet replié à large bande. L = 143/fMHz Brins espacés de 10 à 15 cm Ligne de transmission 4.3.3 Antenne verticale quart d'onde L'antenne verticale quart d'onde est efficace et facile à construire. Elle n'exige qu'un seul élément et qu'un seul support. Dans les bandes d'ondes décamétriques, elle est souvent utilisée pour les communications longue distance. Les antennes verticales sont des antennes dites non directives ou équidirectives car elles émettent de l'énergie radioélectrique de façon équivalente dans toutes les directions de compas. Elles ont aussi tendance à concentrer les signaux vers l'horizon car l'angle de leur diagramme de rayonnement est faible et elles ne rayonnent généralement pas de signaux à forte intensité vers le haut. La Figure 11 montre comment construire une antenne verticale simple. Cette antenne verticale possède un élément rayonnant d'une longueur de ¼ λ. On utilisera l'équation qui suit pour calculer la longueur approximative de l'élément rayonnant. Dans cette équation, la fréquence est indiquée en mégahertz et la longueur en mètres. L (en mètres) = 71 f MHz Pour obtenir de bons résultats, il faut que l'antenne verticale ¼ λ dispose d'un système radial permettant de réduire les affaiblissements dus à la Terre et d'agir comme un plan de sol. Pour un fonctionnement aux fréquences supérieures, l'antenne verticale peut être située au niveau du sol et les conducteurs être placés au sol. Il faut utiliser au moins 3 conducteurs qui seront disposés comme les rayons d'une roue, l'antenne verticale étant placée au centre. Ces conducteurs doivent avoir une longueur d'au moins ¼ λ ou plus à la fréquence de travail la plus faible. La plupart des antennes verticales utilisées à ondes décamétriques ont une longueur égale ou inférieure à ¼ λ avec des réseaux de charge appropriés. A ondes métriques et décimétriques, les antennes sont suffisamment courtes pour permettre l'utilisation d'antennes verticales plus longues. L'antenne verticale 5/8 λ, souvent appelée antenne-fouet, est une antenne mobile populaire, car elle concentre une plus grande partie de l'énergie radioélectrique vers l'horizon qu'une antenne verticale ¼ λ. Rapport sur la Question 16/2 113 Figure 11 – Antenne verticale quart d'onde simple Elément rayonnant quart d'onde Mât de support Colonne isolante Conducteur radio quart d'onde au sol Ligne d'alimentation Point d'alimentation 114 Rapport sur la Question 16/2 Tableau 3 – Longueur approximative des antennes unipolaires et des conducteurs au sol pour les bandes utilisées dans les services fixe, mobile et d'amateur Fréquence (MHz) Longueur (m) Fréquence (MHz) Longueur (m) Fréquence (MHz) Longueur (m) 3,3 21,6 12,2 5,9 30 2,4 3,5 20,4 13,4 5,3 35 2,1 3,8 18,8 13,9 5,1 40 1,8 4,5 15,9 14,2 5,0 50 1,43 4,9 14,6 14,6 4,9 145 50 cm 5,2 13,7 16,0 4,5 150 48 5,8 12,3 17,4 4,1 155 46 6,8 10,5 18,1 3,9 160 44 7,1 10,0 20,0 3,5 165 43 7,7 9,3 21,2 3,3 170 42 9,2 7,7 21,8 3,2 435 117 9,9 7,2 23,8 3,0 450 16 10,1 7,1 24,9 2,9 455 16 10,6 6,7 25,3 2,8 460 16 11,5 6,2 29,0 2,5 465 15 Les antennes verticales disponibles dans le commerce ont besoin d'une ligne d'alimentation coaxiale, généralement avec un connecteur PL-259. Tout comme pour le doublet, on peut utiliser une ligne coaxiale RG-8, RG-11 ou RG-58. Certains fabricants proposent des antennes verticales multibandes qui utilisent des circuits accordés en série pour permettre la résonance de l'antenne à différentes fréquences. Pour installer une antenne «ground plane» ou antenne plan (Figure 12) à ondes décamétriques dans un arbre, on connecte une longueur du câble RG-58 au point d'alimentation de l'antenne que l'on relie à un isolateur. Les conducteurs radio sont soudés à la ligne coaxiale tressée en ce point. Le sommet de l'élément rayonnant est suspendu à une branche d'arbre ou à un autre support approprié qui, à son tour, soutient le reste de l'antenne. Les dimensions de l'antenne sont les mêmes que pour une antenne verticale ¼ λ Les trois brins de l'antenne ont une longueur de ¼ λ, de sorte que l'antenne est généralement utile à 7 MHz et dans les bandes supérieures, car il pourrait être difficile d'avoir des supports temporaires de plus de 10 ou 15 mètres. Rapport sur la Question 16/2 115 Figure 12 – Construction d'une antenne plan dans un arbre. L = 143/fMHz 4.3.4 Antennes pour émetteurs-récepteurs portatifs Les émetteurs-récepteurs portatifs à ondes métriques et décimétriques utilisent en général des antennes courtes, souples qui sont peu coûteuses, petites, légères et robustes mais qui présentent quelques inconvénients: leur conception repose sur une solution de compromis inefficace, tant et si bien que leur performance n'est pas aussi bonne que celle des antennes plus grandes. En revanche, les types d'antennes télescopiques ¼ λ et 5/8 λ, qui sont souvent disponibles comme accessoires séparés, permettent d'obtenir de meilleurs résultats. 4.3.5 Antennes verticales pour ondes métriques et décimétriques L'antenne verticale ¼ λ constitue un choix idéal pour un fonctionnement dans des emplacements fixes. Le modèle à 145 MHz représenté à la Figure 13 utilise un châssis en aluminium auquel les conducteurs sont reliés par des vis à métaux. On forme un coude à 45°, qui peut être réalisé avec un étau ordinaire, dans chacun des conducteurs radio. Un connecteur de châssis SO-239 est monté au centre de la plaque d'aluminium, la partie filetée du connecteur étant orientée vers le bas. La partie verticale de l'antenne est constituée d'un fil de cuivre de 10 mm soudé directement à la broche du connecteur SO-239. 116 Rapport sur la Question 16/2 Figure 13 – Antenne plan à ondes métriques ou décimétriques avec 4 conducteurs «tombants». L = 143/fMHz La construction est simple à réaliser car il suffit d'un connecteur SO-239 et d'un matériel courant. On prend une petite boucle formée à l'extrémité interne de chaque conducteur pour attacher celui-ci directement aux trous de fixation du connecteur coaxial. Une fois que le connecteur est fixé par un dispositif au connecteur SO-239, on utilise un grand fer à souder ou un chalumeau à propane pour souder le conducteur et les pièces de montage au connecteur coaxial. Les conducteurs sont courbés à un angle de 45° et la partie verticale est soudée à la broche, pour compléter l'antenne. Il est prudent d'appliquer une petite quantité de mastic d'étanchéité tout autour de la broche du connecteur pour éviter que l'eau ne pénètre dans le connecteur et dans la ligne coaxiale. 4.3.6 Boucle delta La boucle delta est un autre type d'antenne pratique qu'utilisent les organisations de secours d'urgence pour travailler sur le terrain. Ce type d'antenne présente trois grands avantages: 1) un plan de sol n'est pas nécessaire; 2) une boucle pleine onde (en fonction de la taille) a un gain supérieur à un doublet; et 3) une boucle fermée est une antenne de réception «plus silencieuse» (rapport signal/bruit amélioré) que la plupart des antennes verticales ou que certaines antennes horizontales. Le choix du point d'alimentation permet de déterminer le type polarisation: verticale ou horizontale. A partir de différents points d'alimentation on obtiendra différents angles de rayonnement. Le système est assez souple et peut maximiser les communications à courte ou à longue distance (angle presque droit/angle faible). Les différentes configurations possibles sont représentées à la Figure 14. La largeur de bande à la fréquence de résonance est analogue à un doublet. Il est recommandé d'utiliser un adaptateur d'impédance d'antenne (ATU) pour adapter le système à l'émetteur dans les parties de la bande où le TOS est élevé. Aucune règle ne détermine la forme d'une boucle en onde entière. Il peut être utile d'utiliser une forme triangulaire dont la pointe occupe le sommet si bien qu'un seul support principal est nécessaire en pareil cas. Des formes circulaire, carrée ou rectangulaire ont été utilisées. Rapport sur la Question 16/2 117 Figure 14 – Différentes configurations d'une antenne en boucle Delta onde entière. Longueur totale du brin d'antenne: environ 286/fMHz Pointe vers le haut Alimentation par la pointe Configuration Polarisation Angle de rayonnement 4.3.7 Pointe vers le bas Alimentation par la pointe Pointe vers le haut Alimentation par le côté inférieur Pointe vers le haut Alimentation par le côté A B C D Horizontale Horizontale Horizontale Verticale Moyennement grand Grand Moyennement grand Faible Antennes directives Les antennes directives offrent deux avantages importants par rapport à des antennes équidirectives plus simples comme les doublets et les antennes unipolaires verticales. En effet, en tant qu'antennes d'émission, elles concentrent la plupart du rayonnement dans un seul sens. De plus, pour la réception, les antennes directives peuvent être orientées vers le sens souhaité ou être éloignées d'une source de bruit. Bien qu'elles soient en général de grandes dimensions et de coût élevé au-dessous d'environ 10 MHz, les antennes directives sont souvent utilisées aux bandes de fréquences supérieures, par exemple de 10 MHz à 30 MHz. Les antennes directives sont en principe utilisées à ondes métriques et décimétriques du fait de leur taille relativement faible. L'antenne directive la plus courante est l'antenne Yagi, mais il existe aussi d'autres types d'antennes. Une antenne Yagi compte plusieurs éléments rattachés à un boom central (voir la Figure 15). Les éléments sont parallèles entre eux et sont placés en ligne droite le long du boom. Bien que plusieurs facteurs influent sur la valeur du gain de l'antenne Yagi, la longueur du boom produit l'effet le plus important: plus le boom est long, plus le gain est élevé. La ligne de transmission ne relie qu'un seul élément appelé élément alimenté. Sur une antenne Yagi à trois éléments comme celle qui est représentée à la Figure 15, l'élément alimenté se situe au milieu. L'élément placé à l'avant de l'antenne (vers la direction privilégiée) est un élément directeur. Le réflecteur se trouve derrière l'élément alimenté qui a une longueur d'environ ½ λ à la fréquence de conception de l'antenne. L'élément directeur est un peu plus court que ½ λ et le réflecteur est un peu plus long. Les antennes Yagi peuvent comporter plus de trois éléments et dans ce cas, on ajoute alors en général des éléments directeurs. Les éléments directeurs et les réflecteurs sont appelés éléments non alimentés car ils ne sont pas alimentés directement. Pour réaliser des communications dans différentes directions, on tourne l'antenne en utilisant un dispositif d'entraînement rotatif dans le plan azimutal (horizontal) orienté dans différents sens. 118 Rapport sur la Question 16/2 Figure 15 – Antenne Yagi à trois éléments: réflecteur, élément alimenté et élément directeur s'appuyant sur un boom R éflecteur E lém ent alim enté Elém ent directeur B oom D irection privilégiée 4.3.7.1 Antennes log-périodiques Les antennes log-périodiques sont une variante de l'antenne directive. Leur largeur de bande est plus grande mais leur gain directif est plus faible que celui d'une antenne Yagi. Une antenne log-périodique est un système d'éléments alimentés, conçu pour fonctionner sur un large éventail de fréquences. Elle présente l'avantage d'avoir une caractéristique pratiquement constante sur toute la gamme de fréquences – la même résistance de rayonnement (et par conséquent le même TOS) et les mêmes caractéristiques de rayonnement (à peu près le même gain et le même rapport avant-arrière). 5 Sources d'alimentation et batteries 5.1 Sécurité de l'alimentation Comme pour les travaux d'antenne et pour des raisons de sécurité, tous les travaux électriques doivent être effectués en présence d'une seconde personne. Un commutateur ne doit jamais être utilisé sur le fil du neutre sans effectuer également la déconnexion de l'équipement d'une ligne active ou «en service». Tous les équipements de communication doivent être reliés de manière fiable à la terre au moyen d'une ligne séparée et de calibre important. Le conducteur neutre de câblage d'alimentation ne doit pas être utilisé pour cette mise à la terre de sécurité. On met donc le châssis de l'équipement au potentiel de terre, pour que l'énergie radioélectrique sur le châssis soit minimale. Cela constitue une mesure de sécurité pour l'opérateur en cas de court-circuit ou de fuite accidentelle à une extrémité de la ligne d'alimentation vers le châssis. Rapport sur la Question 16/2 119 Aucune batterie ne doit être soumise à des chaleurs, des vibrations ou à des chocs inutiles. Les batteries doivent être maintenues propres. Une inspection fréquente des fuites est recommandée. Il faut nettoyer toutes les surfaces d'une batterie dont l'électrolyte fuit de manière liquide ou gazeuse. L'électrolyte, active chimiquement et conductrice électriquement, peut irrémédiablement endommager l'équipement électrique. L'acide peut être neutralisé avec du bicarbonate de sodium (bicarbonate de soude). On peut neutraliser les alcalis avec un acide léger tel que le vinaigre. Ces deux substances de neutralisation se dissolvent dans l'eau, et doivent être nettoyées rapidement. Il ne faut pas qu'elles puissent se propager dans la batterie. Le gaz s'échappant des batteries de stockage peut être explosif. Les flammes et les produits tabagiques allumés doivent être tenus à l'écart. Lorsque l'on travaille avec des générateurs électriques, la sécurité doit constituer un souci de tous les instants. L'essence est un produit chimique dangereux qui ne pardonne aucune négligence. Ce carburant ne peut être stocké que dans des conteneurs appropriés, très loin du générateur et à l'abri du soleil. Le générateur doit être éteint et refroidi avant tout ajout de carburant. L'essence et les chiffons imbibés d'huile doivent être éliminés avec soin. Leur empilement pourrait provoquer une combustion spontanée. Un extincteur doit être placé à proximité du générateur. Il doit être interdit de fumer près du générateur. Les moteurs à combustion interne génèrent de la chaleur. Plus le moteur est grand, plus sa vitesse de rotation est importante, et plus l'on produit de la chaleur. La présence conjointe, dans un espace réduit, de fumées d'essence et de chaleur émanant du moteur est dangereuse. Les fumées dégagées par le moteur peuvent être mortelles. Que l'on utilise de l'essence, du diesel, du gaz naturel ou du propane, il faut s'assurer que les fumées dégagées sont ventilées correctement hors de la zone d'exploitation. La ventilation naturelle ne suffit en général pas à maintenir une atmosphère saine. Il convient d'utiliser une soufflerie ou un ventilateur pour ramener de l'air frais de l'extérieur, ainsi qu'un ventilateur d'évacuation pour rejeter la chaleur vers l'extérieur. 5.2 Alimentation de secteur L'alimentation de secteur doit être utilisée dès que possible afin d'économiser les systèmes d'alimentation autonomes et les réserver à des fins de secours. Même une alimentation de secteur peu fiable peut être utilisée pour charger les batteries. On achemine les services électriques dans les bâtiments grâce à au moins deux fils fournissant des courants alternatifs de 100-130 V ou 200-260 V, à une fréquence de 50 ou de 60 Hz. On peut diviser les circuits en plusieurs branches et les protéger par des interrupteurs ou des fusibles. Il est également souhaitable d'installer, pour des raisons de sécurité, un disjoncteur de défaut de terre (GFCI ou GFI, ground fault circuit interrupter), devant si possible appartenir au réseau d'alimentation électrique. 5.3 Transformateurs d'alimentation De nombreux facteurs doivent être étudiés lors du choix du transformateur, tels que les mesures en voltsampères (VA) en entrée et en sortie, la température ambiante, le coefficient d'utilisation et la conception mécanique. Dans le cas d'un équipement de courant alternatif, on utilise plus souvent le terme «volt-ampère» que celui de «watt», parce que les composantes alternatives doivent traiter à la fois la puissance réactive et la puissance réelle. Le nombre de volts-ampères fournis par un transformateur ne dépend pas uniquement des exigences de charge en courant continu, mais aussi du type de filtre de sortie continu utilisé (capacité ou inductance en entrée), et du type de redresseur utilisé (prise centrale à double alternance ou pont à double alternance). Avec un filtre d'entrée capacitif, l'effet de chaleur dans le second cas est plus important à cause du rapport courant crête à courant moyen élevé. Les volts-ampères générés par le transformateur peuvent être supérieurs de plusieurs multiples à la puissance fournie à la charge. Le nombre de volts-ampères sera un peu plus important au niveau de l'enroulement primaire à cause des pertes du transformateur. 120 Rapport sur la Question 16/2 Un transformateur fonctionne en produisant un champ magnétique dans son tore et ses bobinages. L'intensité de ce champ varie directement avec la tension instantanée appliquée au bobinage primaire du transformateur. Ces variations, couplées à celles du bobinage secondaire, produisent la tension de sortie souhaitée. Le transformateur vu de la source apparaissant comme une inductance en parallèle avec la charge (équivalente), le bobinage primaire se comportera comme un court-circuit si un courant continu lui est appliqué. L'inductance non chargée du bobinage primaire doit être suffisamment élevée pour ne pas induire une quantité excessive de courant d'entrée à la fréquence choisie lors de la conception (en général 50 ou 60 Hz). A cette fin, on fait un nombre de tours suffisant sur le bobinage primaire et on utilise un tore magnétique suffisamment grand pour que celui-ci ne soit pas saturé après chaque demi-cycle. Pour éviter d'éventuelles surchauffes dommageables, les transformateurs et d'autres équipements électromagnétiques conçus pour des systèmes à 60 Hz ne doivent pas être utilisés avec les systèmes d'alimentation à 50 Hz à moins d'être spécifiquement conçus pour les basses fréquences. 5.4 Batteries et chargement L'existence d'équipements à état solide rend commode l'utilisation de batteries dans des conditions de mobilité ou d'urgence. Si les émetteurs-récepteurs et autres instruments portables en sont des applications évidentes, les émetteurs-récepteurs générant une sortie de 100 W constituent une utilisation pratique de l'alimentation par batterie (par exemple, l'alimentation de secours pour les émetteurs-récepteurs haute fréquence). Les appareils à faible puissance peuvent être alimentés par deux types de batteries. La batterie primaire est destinée à une seule utilisation, avant d'être rejetée; la batterie de stockage (ou secondaire) peut être rechargée plusieurs fois. Une batterie est un ensemble de piles chimiques, habituellement connectées en série pour fournir un certain multiple de la tension de la pile. Chaque combinaison de substances chimiques utilisées dans la pile donne une certaine tension nominale. Il faut tenir compte de cela pour établir une tension de batterie particulière. Par exemple, quatre piles de carbone-zinc de 1,5 V constituent une batterie de 6 V et six piles plomb-acide de 2 V forment une batterie de 12 V. 5.4.1 Capacité de batterie L'unité de mesure usuelle de la capacité de batterie est l'ampère-heure (Ah), c'est-à-dire le produit du courant de décharge par le temps. On utilise généralement le symbole C; C/10, par exemple, serait le courant disponible continûment pendant 10 heures. La valeur de C varie avec le taux de décharge et peut être de 110 à 2 A (Ampères), mais peut valoir seulement 80 à 20 A. La capacité peut varier de 35 mAh pour certaines batteries auditives de faible dimension, à plus de 100 Ah pour une batterie de stockage à 20 cycles poussés de taille 28. Les piles primaires hermétiques sont le plus souvent utilisées de façon intermittente (plutôt que continue). La période de repos permet la réalisation des réactions chimiques nécessaire à l'élimination des produits secondaires de la décharge. Les tensions de sortie de toutes les batteries chutent lors de la décharge. La condition de «décharge», pour une batterie plomb-acide de 12 V, par exemple, ne doit pas être inférieure à 10,5 V. Il est souhaitable également de tenir à jour un relevé des informations hydrométriques, mais les indications habituelles de 1 265 en charge et de 1 100 en décharge s'appliquent uniquement à une décharge longue et à faible débit. Des charges importantes présentes dans le circuit peuvent induire une décharge de la batterie avec une faible diminution de la valeur des relevés hydrométriques. Rapport sur la Question 16/2 121 Des batteries qui refroidissent disposent d'une charge moins importante, et il peut être intéressant d'essayer de maintenir une batterie à une température suffisante avant utilisation. Une batterie peut perdre dans des conditions de froid extrême plus de 70% de sa capacité, qu'elle retrouve lorsque la température augmente. Si toutes les batteries ont tendance à geler, le risque est moins important pour les batteries en pleine charge. Une batterie plomb-acide à pleine charge fonctionne en toute sécurité jusqu'à –26 °C ou à des températures inférieures. Les batteries de stockage peuvent voir leur température augmenter quelque peu suite à une charge ou à une décharge. Des souffleries d'air chaud ou des flammes ne doivent jamais être utilisées pour chauffer un type quelconque de batterie. Une limite pratique à la décharge survient lorsque la charge ne correspond plus à des conditions d'exploitation satisfaisantes pour une faible tension de sortie près du point de «décharge». Beaucoup d'équipements destinés à une utilisation «mobile» sont certes conçus pour fonctionner à une tension moyenne de 13,6 V et une tension crête de quelque 15 V, mais ces équipements connaîtront des difficultés de fonctionnement au-dessous de 12 V. Pour une utilisation optimale de la charge de la batterie, un équipement devrait fonctionner correctement (à défaut d'être à pleine puissance) à seulement 10,5 V, alors que sa tension nominale de fonctionnement varie entre 12 et 13,6 V. On peut faire des observations analogues dans le cas du remplacement des piles carbone-zinc par des piles de stockage NiCd. Huit piles de carbone zinc développeront une tension de 12 V, alors qu'il faut 10 piles NiCd pour produire la même tension. Si on utilise une batterie comprenant 10 piles, l'équipement doit être conçu pour une tension de 15 V dans le cas où il s'agit de piles carbone-zinc. 5.4.2 Batteries primaires La pile alcaline constitue l'un des types de piles primaires les plus courants, dans laquelle l'oxydation chimique survient au cours de la décharge. Lorsqu'il n'y a pas de courant, l'oxydation s'arrête quasiment jusqu'à ce que du courant soit demandé. La réaction chimique se poursuit cependant lentement, ce qui fait que les batteries chargées finissent par se dégrader jusqu'à ce que la batterie ne fournisse plus le courant souhaité. La batterie alcaline fournit une tension nominale de 1,5 V. Des piles de plus grande taille permettent de produire davantage de milliampères-heures et d'induire moins de chute de tension que dans le cas des piles de dimensions plus réduites. Des batteries industrielles à forte capacité ont généralement des durées de vie plus grandes. Les batteries primaires à lithium présentent en général une tension nominale d'environ 3 V par pile et offrent très largement les meilleures caractéristiques de capacité, de décharge, de conservation et de température. Le prix élevé est un inconvénient, et elles ne peuvent pas rapidement être remplacées par d'autres types de piles en cas d'urgence. La batterie lithium-chloride de thionyle est constituée d'une pile primaire et ne doit être rechargée en aucun cas. Le processus de chargement dégage de l'hydrogène, ce qui peut conduire à une explosion catastrophique. Il faut également éviter une charge accidentelle consécutive à des erreurs de câblage ou à un court-circuit. On utilise des batteries à oxyde d'argent (1,5 V) et à mercure (1,4 V) lorsque l'on souhaite disposer de tensions quasi constantes à des faibles courants pendant de longues périodes. Elles sont surtout mises en œuvre dans le cas des équipements de petites dimensions. Il ne faut pas décharger des batteries primaires, pour deux raisons : cela peut se révéler dangereux à cause de la chaleur générée dans les piles étanches, et même en cas de relatif succès, la charge et la durée de vie seraient toutes deux limitées. Un type de batterie alcaline est rechargeable, et comporte une indication à cet effet. 5.4.3 Batteries secondaires La batterie nickel-cadmium (NiCd), dont la tension nominale par pile est de 1,2 V, correspond au type de batterie rechargeable de petite taille le plus courant. Utilisée avec précaution, elle peut subir plus de 122 Rapport sur la Question 16/2 500 cycles de charge et de décharge. Pour une longue durée de vie, la batterie NiCd ne doit pas être complètement déchargée. Lorsqu'il y a plus d'une pile dans la batterie, la pile la plus déchargée peut subir une inversion de polarisation, ce qui entraîne un court-circuit ou une rupture de joint. Toutes les batteries de stockage présentent des limites de décharge, et les batteries de type NiCd ne doivent pas être déchargées à moins de 1,0 V par pile. Les piles nickel-cadium ne se limitent pas à la taille «D» ou aux tailles inférieures. Elles sont également disponibles sous des formes très diverses, dont les unités à «énorme» capacité de 1 000 Ah comportant des poignées sur les côtés et sur le sommet pour l'adjonction d'eau, à l'instar des batteries de type plomb-acide. On les utilise beaucoup pour fournir une alimentation sans interruption. Si l'on recherche des capacités élevées, la batterie rechargeable la plus utilisée est de type plomb-acide. Une batterie automobile doit en général se décharger partiellement à un rythme très élevé, et se recharge rapidement pendant que l'alternateur alimente également la charge électrique. La batterie la plus appropriée pour les applications électroniques à haute puissance et de longue durée est appelée batterie «à cycle poussée» («deep-cycle» battery). Ces batteries peuvent fournir entre 1 000 et 1 200 Wh par charge à température ambiante. Si elles font l'objet de soins attentifs, on peut espérer qu'elles pourront subir plus de 200 cycles. Elles disposent souvent de poignée de traction et de bornes à vis, ainsi que de bornes coniques classiques pour batterie automobile. Elles peuvent également être équipées d'accessoires tels que des étuis de transport en plastique, avec ou sans chargeurs intégrés. On peut aussi trouver des batteries plomb-acide qui sont également disponibles avec électrolyte gélifié. Couramment appelées «piles gélifiées», elles peuvent être installées dans n'importe quelle position appropriée. La conception d'une batterie automobile plomb-acide répond à un objectif: fournir beaucoup de courant pendant une courte durée. La tension de sortie d'une telle batterie ne reste pas constante durant le cycle de décharge, et il ne serait pas pertinent d'effectuer une décharge complète. Une batterie automobile ne pourra pas subir un nombre trop important de décharges complètes sous peine d'être irrémédiablement endommagée. Une batterie plomb-acide à décharge complète se prête beaucoup plus à des besoins d'alimentation en cas d'urgence. Elle peut subir sans dommage des décharges à répétition, et conservera l'intégralité de sa tension de sortie durant la plus grande partie du cycle de décharge. Ce type de batterie est disponible au niveau des points de sortie distributive d'un bateau ou d'une automobile. Les batteries ne coûtent pas beaucoup plus cher que des batteries automobiles classiques et sont conçues pour fournir un courant d'intensité moyenne pendant de longues périodes. La batterie hybride nickel-métal (NiMH) est semblable à la batterie NiCd, à ceci près que l'électrode en cadmium est remplacée par une électrode en alliage métallique poreux qui piège l'oxygène (d'où le nom d'hybride métallique). Beaucoup de caractéristiques de base de ces piles sont semblables à celles des batteries NiCd. Par exemple, la tension est pratiquement identique, elles peuvent être chargées lentement à partir d'une source de courant continu et peuvent subir sans dommage des cycles de décharge poussée. Des différences importantes subsistent cependant. Ainsi, elles présentent souvent, à taille égale, des capacités plus élevées, souvent deux fois plus grandes que celles relatives au type NiCd. Une pile NiMH de taille AA typique offre une capacité variant entre 1 000 et 1 300 mAh, à comparer avec les 600 à 830 mAh de la batterie NiCd de taille identique. Un autre avantage de ces piles est qu'elles ne sont pas aucunement sujettes à des effets de mémoire. Les piles NiMH ne contiennent aucune substance dangereuse, alors que les piles NiCd et les piles plomb-acide contiennent au contraire un grand nombre de métaux lourds toxiques. Les piles lithium-ion (Li-ion) constituent une autre alternative possible à l'utilisation des piles NiCd. A énergie de stockage identique, le poids d'une pile Li-ion est égale au tiers, et son volume est égal à la moitié de celui d'une pile NiCd. Sa vitesse d'auto-décharge est également plus faible. Généralement, à température ambiante, une pile NiCd perd par jour 0,5 à 2% de sa charge. La pile ion-lithium perd moins de 0,5% par jour, et ce chiffre finit même par diminuer lorsque 10% de la charge sont perdus. Cette différence est encore plus grande aux températures élevées. Il apparaît donc que les piles lithium-ion constituent un meilleur choix pour les opérations courantes pour lesquelles des recharges fréquentes ne sont pas possibles. La tension au niveau d'une pile constitue la différence majeure entre les piles NiCd et les piles Li-ion. La tension nominale pour une pile NiCd est environ de 1,2 V, alors qu'elle est de 3,6 V, Rapport sur la Question 16/2 123 avec une tension de chargement de pile maximale de 4 V, dans le cas d'une pile Li-ion. Il n'est pas possible de remplacer directement des piles Li-ion par des piles NiCd. Des chargeurs destinés à des batteries NiCd ne doivent pas être utilisés avec des batteries Li-ion, et inversement. 5.5 Inverseurs Un convertisseur continu-alternatif, plus couramment appelé inverseur, constitue une source d'alimentation en courant alternatif que l'on peut utiliser sur le terrain. La sortie en courant alternatif d'un inverseur présente souvent une forme d'onde carrée. C'est pourquoi certains types d'équipement ne peuvent pas être exploités par un inverseur. Certains types de moteurs comptent au nombre des dispositifs nécessitant une sortie en onde sinusoïdale. Outre les ondes carrées délivrées en sortie, les inverseurs présentent certains autres traits qui ne plaident pas en faveur de leur utilisation sur le terrain. Les modèles disponibles courants ne présentent pas une grande capacité de puissance. Il existe des modèles fournissant des puissances plus grandes, mais leur prix est très élevé. 5.6 Générateurs Un générateur est un équipement indispensable pour des opérations de secours à long terme. Il fournira de la puissance tant qu'il reste du carburant. Un entretien approprié est toutefois nécessaire pour que le générateur continue à fonctionner de manière fiable. Lorsque le générateur ne fonctionne pas, on peut utiliser une alimentation par batterie jusqu'à la remise en marche du générateur. Le niveau d'huile de lubrification doit être contrôlé régulièrement. Si le carter d'huile est vide, le moteur peut se gripper, ce qui met la station hors de fonctionnement et occasionne de coûteuses réparations. N'oublions pas qu'un moteur en marche produit du monoxyde de carbone. Un générateur en marche ne doit jamais fonctionner en milieu fermé et doit être placé loin de portes ou de fenêtres ouvertes, pour éviter que des fumées n'entrent dans les bâtiments. Des générateurs de la gamme 3-5 kW peuvent facilement être manipulés par deux personnes et peuvent alimenter des équipements radioélectriques ou d'autres appareils électriques. La plupart des générateurs fournissent en sortie une tension continue de 12 V et une tension alternative de 120/240 V. Certains générateurs présentent un régime de puissance continue et un régime de puissance alternative. Si la puissance totale que nécessite la station est supérieure à la puissance disponible du générateur, les émetteurs-récepteurs n'utiliseront la totalité de la puissance fournie que durant la phase d'émission, et il n'y aura pas d'émission durant 100% du temps imparti. Il est nécessaire de faire en sorte que la consommation de puissance totale possible ne soit pas supérieure à celle autorisée par le régime de puissance alternatif du générateur. Les générateurs doivent faire l'objet de tests réguliers. Le combustible doit être récent. Les opérations de maintenance (réglage ou changement d'huile) doivent être effectuées régulièrement. Il convient de vérifier soigneusement l'état des bougies, et les bougies de rechange doivent être entretenues. Les filtres à d'air doivent être vérifiés et nettoyés conformément aux instructions du fabricant. Le générateur doit faire l'objet de vérifications pour fonctionner correctement. S'il y a une fuite quelconque de carburant, il faut immédiatement arrêter le moteur et régler le problème. Le silencieux doit être inspecté. Tous les boîtiers isolants doivent être en place. Il convient également de tester la tension de sortie. Si le générateur ne bénéficie pas d'une protection de surtension intégrée, il faut que la valeur de la tension soit correcte avant de fournir la puissance à l'équipement radioélectrique. Il faut enfin vérifier le bruit radioélectrique du générateur. Pour certains générateurs, les bruits d'allumage ne sont pas complètement supprimés. En cas de problème, on peut utiliser des bougies de type résistif ou des câbles d'allumage. Une mise à la terre adéquate avec un piquet de terre peut permettre de minimiser le bruit. 124 5.6.1 Rapport sur la Question 16/2 Considérations relatives à l'installation Un moteur à combustion interne est bruyant et gênant lorsqu'un équipement de communication est exploité à proximité. L'emplacement choisi pour une usine électrique est important, quelle que soit la taille de celle-ci. Un moteur tournant à 3 600 tours par minute, même muni d'un système silencieux efficace, génère du bruit et des vibrations. Celles-ci se propagent du socle sur lequel le moteur est monté vers le sol et les murs du bâtiment abritant le système. Des constructions en briques ou en béton réduiront le niveau de bruit, mais si la chape entourant le générateur est métallique, la réduction de bruit sera moindre. Les panneaux métalliques risquent de vibrer en résonance avec la source sonore, accroissant d'autant le vacarme. L'application de composantes de calfeutrage durcissant sur les bords verticaux des panneaux métalliques peut éliminer certains bruits, tout comme l'utilisation de matériaux insonorisants pour isoler la chape. Il convient de prendre en compte la distance séparant l'alternateur de l'exploitant. L'intensité sonore varie de façon inversement proportionnelle au carré de la distance à la source. Le bruit à 20 mètres de la source est quatre fois moins important qu'à 10 mètres de celle-ci. A 30 mètres, il n'est plus égal qu'à un neuvième du bruit à 10 mètres. Il faut également étudier la consommation de carburant, tant sous l'angle de l'installation que sous celui du problème de sécurité susceptible d'être posé. Un générateur de 2,5 à 5 kW consomme 2 à 4 litres de carburant par heure. On doit pouvoir disposer d'un réservoir important permettant au moins 48 heures d'exploitation. Si l'on utilise de l'essence, le stockage dans des bonnes conditions de sécurité peut se révéler délicat. Il convient de stocker l'essence dans une zone distincte de celle hébergeant le générateur, et de ne transporter à chaque fois que la quantité d'essence nécessaire au remplissage du réservoir. Lorsque l'on se trouve dans une zone dans laquelle existe du propane ou du gaz naturel, il peut être intéressant d'envisager l'utilisation de ces sources d'énergie. Certains alternateurs peuvent être alimentés par plusieurs types de carburant (essence ou gaz naturel/propane). Un système de carburation particulier est nécessaire pour le gaz naturel ou le propane. 5.6.2 Maintenance du générateur Une maintenance appropriée est nécessaire pour obtenir les grandeurs de sortie voulues et une longue durée de vie du moteur à essence. Un certain nombre de mesures simples prolongeront la durée de vie de l'équipement et permettront de maintenir le niveau de fiabilité souhaité. Le manuel du fabricant doit constituer la source principale d'informations relatives à la maintenance et doit être la référence ultime pour toute procédure d'exploitation et d'opération liée à la sécurité. Ce manuel devra fera l'objet d'un examen approfondi de la part de toute personne chargée de l'exploitation et de la maintenance de l'unité. Le combustible doit être propre, récent et de bonne qualité. De nombreux problèmes relatifs aux générateurs à essence trouvent leur origine dans des problèmes de carburant. On peut citer, par exemple, la présence de saleté ou d'eau dans du carburant vieux et inerte. La composition de l'essence stockée pendant une durée quelconque se modifie à mesure que s'évaporent les composantes les plus volatiles. Les substances en excès les plus solides encrasseront alors le carburateur. Si le générateur est immobilisé pendant une longue période, il est souhaitable de le faire fonctionner au préalable jusqu'à ce que tout le carburant ait été consommé. Des bougies défectueuses sont une cause habituelle d'incendie. Des bougies de rechange doivent être conservées avec l'unité, ainsi que les outils nécessaires à leur mise en place. 5.6.3 Mise à la terre du générateur Une mise à la terre correcte du générateur est nécessaire tant pour des raisons de sécurité que pour assurer une exploitation correcte des équipements alimentés par l'unité. La plupart des générateurs sont alimentés par une sortie à trois fils. Pour certains générateurs, le bâti doit également être mis à la Terre. Un conduit ou un piquet de terre approprié doit être enfoncé dans le sol près du générateur et connecté au serre-fils ou à la cosse prévu à cet effet. Rapport sur la Question 16/2 5.7 125 Alimentation solaire Une pile solaire est un semi-conducteur très simple. Il s'agit en fait d'une diode semi-conductrice à surface large. De manière simplifiée, lorsque les photons des rayons lumineux bombardent la barrière dudit semiconducteur, des paires trous-électrons sont libérées dans cette jonction P-N, ce qui a pour conséquence une polarisation en sens direct de la jonction, exactement comme dans le cas des phototransistors. Cette jonction polarisée en sens direct peut fournir un courant à une charge. Le courant généré peut être important, car la zone exposée d'une pile solaire peut être très importante. Le courant de sortie d'une pile photonique est directement proportionnel à l'intensité du bombardement photonique, ainsi qu'à l'étendue de la surface de la photopile exposée. 5.7.1 Types de piles solaires A l'origine, on créait des piles solaires en coupant des tranches dans une tige de silicium-cristal et en les soumettant à un processus de dopage et de métallisation. Ces piles solaires sont désignées sous le terme de piles monocristalline car chacune d'elle correspond à seulement une couche cristalline. Leur forme ronde est identique à celle de la tige de silicium dont elles sont issues. Une tranche de 50 mm de ce matériau peut permettre de créer une photopile, mais permet également de générer jusqu'à un millier de transistors. La plupart sont protégés en polarité grâce à une diode en série avec la ligne de tension positive. Lorsque la luminosité diminue et que la tension de sortie chute, la diode empêche que le courant ne commence à circuler de la batterie vers le panneau solaire. Les panneaux solaires fournissent typiquement 15 à 18 V entre 600 et 1 500 mA en pleine lumière solaire. Cela n'endommagera pas une batterie à haute capacité, à cycle poussé par exemple. Il suffit de brancher la batterie, de placer le panneau solaire en pleine lumière, et de commencer le chargement. La batterie régulera la tension maximale que lui fournit le panneau. Si l'on souhaite utiliser un panneau solaire pour recharger une batterie de plus petites dimensions, telle qu'une batterie au Nickel-Cadmium (NiCd) ou une batterie plomb-acide à l'électrolyte gélifié, il faut porter davantage d'attention aux détails. Ces types de batteries pouvant se détériorer en cas de chargement trop rapide, il est nécessaire de procéder à une charge régulière. Un convertisseur continu-alternatif, ou un inverseur, transforme une tension de 12 V en une sortie continue à onde carrée d'environ 60 Hz. Toutefois, la puissance de sortie des inverseurs est en général limitée à une valeur située environ entre 100 et 400 W, et certains équipements (en particulier les moteurs) ne peuvent pas être alimentés par une onde carrée. Un inverseur est susceptible d'alimenter quelques ampoules ou un petit fer à souder et peut constituer un complément utile à une station alimentée par batterie. Certains inverseurs parmi les plus récents utilisent la technique de commutation, et sont très légers. Les piles polycristallines sont généralement fabriquées comme des blocs rectangulaires de cristaux de silicium apparemment arrangés au hasard à partir desquelles sont découpées les couches de piles. On reconnaît ces piles à leur forme, à leur configuration aléatoire et à leur surface colorée. Les piles polycristallines sont moins chères à fabriquer que les piles monocristallines. Des panneaux amorphes fiables sont disponibles auprès de nombreux fabricants. Ils peuvent se présenter sous plusieurs formes : montés sur un verre fin, encadrés, ou même montés sur des substrats flexibles tels que l'acier. 5.7.2 Spécifications relatives aux piles solaires Exposée au soleil, chaque pile présente une tension en circuit ouvert variant, suivant le type considéré, entre 0,6 et 0,8 V. Cette tension de sortie chute quelque peu lorsque la courant provient d'une pile solaire. On parle alors de courbe de charge de la pile. La tension en circuit ouvert est de l'ordre de 0,7 V, et la tension de sortie en charge optimale est normalement égale à 0,45. Ce courant de sortie est maximal pour les terminaux dont la sortie est en court-circuit. Ce courant maximum est appelé courant de court-circuit, et il dépend du type et de la taille de la pile. Le courant de sortie de la pile restant relativement constant dans des conditions de charge variables, on peut considérer cette pile comme une source de courant constant. 126 Rapport sur la Question 16/2 Comme dans le cas des batteries, on peut faire fonctionner les piles solaires en série afin d'augmenter la tension de sortie, et/ou en parallèle pour accroître les capacités de courant de sortie. Plusieurs fabricants proposent des tableaux ou des panneaux avec un certain nombre de piles en connexion série-parallèle pouvant être utilisées, par exemple, pour charger la batterie. Des techniques ont été développées pour l'élaboration de piles amorphes : celles-ci sont fabriquées en série en découpant des couches métalliques qui ont été déposées par vaporisation sur la couche de silicium amorphe. Ce découpage est effectué au laser. La largeur de piles de ces panneaux peut aller jusqu'à plusieurs dizaines de centimètres, et la capacité de courant de sortie de ces panneaux relativement économiques est excellente. L'efficacité de ces piles solaires est variable : elle peut aller jusqu'à 15% pour des piles mono cristallines, varie entre 10 et 12% pour des piles polycristallines et entre 6,5 et plus de 10% pour des piles amorphes, suivant le processus de fabrication considéré. On spécifie la puissance de sortie des tableaux ou des panneaux solaires en watts. En règle générale, les puissances mentionnées sont mesurées en pleine exposition à la lumière solaire, à un potentiel nominal de 7 V pour un système à 6 V, 14 V pour un système à 12 V, etc. On peut calculer le courant maximum susceptible d'être fourni par un panneau solaire en divisant la puissance de sortie spécifiée par la tension du panneau. 5.7.3 Stockage de l'énergie solaire Le soleil ne brillant pas 24 heures sur 24 en de nombreux endroits, il est nécessaire de disposer de moyens de stockage de l'énergie recueillie. On utilise en général à cet effet des batteries, dont on exprime souvent la capacité en ampères-heures (Ah) ou en milliampères-heures (mAh), ce qui correspond simplement au produit du courant de décharge par le temps de décharge exprimé en heures. Par exemple, une batterie NiCd de bonne qualité, à pleine charge de 500-mAh, peut fournir un courant de décharge de 100 mA pendant 5 heures, ou un courant de 200 mA pendant 2,5 heures, avant qu'il ne soit nécessaire de procéder à une recharge. On utilise généralement trois types de batteries rechargeables: • les batteries nickel-cadium (NiCd). Elles sont le plus souvent utilisées pour des applications à relativement faible énergie telles que les émetteurs-récepteurs portables, les scanners, etc. Le développement de l'électronique grand public a contribué à la croissance rapide de l'offre des batteries NiCd (dont les coûts ont diminué à un rythme un peu moins rapide que ladite croissance). Les batteries NiCd présentent plusieurs avantages : elles sont scellées hermétiquement, elles peuvent fonctionner dans n'importe quelle position et ont une durée de vie satisfaisante (plusieurs centaines de cycles de charge/décharge), si elles sont entretenues correctement. • les batteries plomb-acide à électrolyte gélifié. Ces batteries hermétiquement scellées peuvent développer de moins de 1 Ah à plus de 50 Ah. Elles conviennent idéalement pour alimenter une station radioélectrique, mais leur coût (pour des capacités de plus 10 Ah) est plutôt élevé. Pour des stations portables et de faible puissance, il est toutefois difficile de trouver mieux que ce type de batterie. Ces batteries peuvent être utilisées dans n'importe quelle position, mais leur chargement doit être effectué en position verticale. Correctement entretenues (l'inversion de polarité des piles lors d'une décharge poussée est impossible dans ces conditions et elles sont stockées dans un état de charge complète), les piles à électrolyte gélifié bénéficient d'une longue durée de vie (environ 500 cycles). • autres types batteries plomb-acide. On les trouve dans leur version classique pour les automobiles, dans une version à décharge poussée pour les bateaux et les véhicules de camping, et dans une version destinée aux voiturettes de golf. Examinons les différences entre ces versions. Ainsi, les batteries automobiles tombent souvent en panne (du fait de l'utilisation pour leur construction d'une plaque fine et d'un matériau d'isolation), ce qui entraîne l'apparition de courts-circuits internes prématurés. Les batteries de voiturettes de golf, de bateaux et de véhicules de camping de marine/de tourisme disposent de plaques fines mieux isolées les unes des autres, ce qui leur permet de supporter des décharges plus poussées sans déformation de plaque ou rupture interne. Les batteries à décharge profonde conviennent idéalement pour des stations radioamateurs. Certaines d'entre elles nécessitent Rapport sur la Question 16/2 127 une attention particulière (il faut veiller à maintenir le niveau de l'électrolyte) et leur durée de vie est maximale si on les maintient chargées. Ces batteries doivent rester en position verticale, car elles contiennent un électrolyte humide (eau) et ne sont pas, pour la plupart, scellées hermétiquement. 5.7.4 Une application typique Voici un exemple concret permettant de calculer les spécifications en termes de puissance relative à une station radioélectrique hyperfréquence alimentée par l'énergie solaire. Il convient en premier lieu de définir les exigences en matière de puissance. Supposons que l'on dispose d'un émetteur de 100 W. Cette grandeur représente en fait la consommation de puissance maximale, qui est uniquement utilisée durant l'exploitation en ondes continues et durant les crêtes de transmission téléphonique BLU (en bande latérale unique) lorsqu'on fournit une tension nominale de 13,6 V (correspondant à une batterie en pleine charge). La manière la plus fiable de calculer des spécifications de puissance réalistes est de déterminer la puissance utilisée durant une longue période de temps, par exemple une semaine ou un mois. Puisque l'on a plus ou moins des habitudes hebdomadaires, nous choisirons la semaine comme unité temporelle de base (on peut remplacer les chiffres ci-après par d'autres chiffres afin d'adapter ce calcul au cas d'un émetteur exploité dans d'autres conditions). Supposons que l'émetteur fonctionne cinq jours durant. Pendant chaque période de deux heures, une heure et demie est consacrée à l'écoute, la transmission occupant la demi-heure restante. Supposons que l'émetteur-récepteur utilise pendant la phase de réception un courant de 2 A; durant les pics d'émission à 100 W, l'intensité du courant s'élève à 20 A. Le manuel utilisateur de l'émetteur doit indiquer la valeur maximale de la consommation de courant continu. La valeur moyenne du courant nécessaire durant la phase d'émission en bande latérale unique ne s'élève qu'à environ 4 A. Il est donc nécessaire de disposer d'une batterie fournissant un courant crête d'au moins 20 A et d'un courant moyen de 4 A. Calculons à présent l'énergie totale (exprimée en ampères-heures) utilisée pendant une semaine: A la réception: 2 A × 21/2 heures/jour x 5 jours = 25 Ah A l'émission: 4 A × 1/2 heures/jour x 5 jours = 10 Ah. L'énergie totale utilisée par semaine est de 25 + 10 = 35 Ah, ce qui correspond à une valeur journalière (moyenne) de 35 ÷ 7 = 5 Ah. Si le système était «parfait», il suffirait simplement de fournir à la batterie 35 Ah par semaine (soit 5 Ah par jour). Dans la pratique, des imperfections liées à la construction de la batterie induisent certaines pertes (auto-décharge) que doit compenser le système de charge. Nous devons ensuite calculer la capacité de batterie minimale que requiert cette application. La conception du système doit permettre d'alimenter suffisamment l'équipement pour permettre son fonctionnement durant deux jours consécutifs sans soleil (ce chiffre est quelque peu arbitraire, certains emplacements étant plus critiques que d'autres à cet égard). Puisque ces jours sans soleil peuvent correspondre à des jours d'exploitation, et qu'il n'est pas recommandé de décharger une batterie à moins de 50% de sa capacité (sous peine de diminuer sa durée de vie), il faut que cette batterie ait une capacité d'au moins 2 (jours) × 5 (Ah) ÷ 0,5 (pour que subsiste une capacité de charge de 50% après 3 jours sans soleil) = 20 Ah. Si cet emplacement risque de ne pas être ensoleillé pendant toute une semaine, ce chiffre s'élèverait à 7 × 5 ÷ 0,5 = 70 Ah. Il faut majorer ce chiffre d'environ 10 % pour compenser les effets de l'auto-décharge et des autres pertes (ce qui signifie généralement l'utilisation de la batterie de taille immédiatement supérieure à celle utilisée au départ pour les calculs). Pour que la batterie reste suffisamment chargée, il convient en premier lieu d'estimer le nombre d'heures d'ensoleillement annuel moyen dans la zone considérée. On peut trouver cette information dans un almanach. A titre de référence, l'exposition solaire moyenne annuelle est d'environ 3 200 heures dans les régions ensoleillées. Ailleurs, ce chiffre diminue jusqu'à environ 1 920 heures dans les régions climatiques de l'extrême nord. Le panneau solaire doit être placé dans une position fixe avec un angle optimal par rapport à la Terre. Dans les régions tempérées, cet angle peut varier entre environ 30° au printemps et environ 60° en hiver. Les panneaux solaires fixes ne peuvent pas capter l'énergie solaire maximale, et ce pour des raisons évidentes. En pratique, ils ne captent environ que 70% de la durée totale d'ensoleillement, ce qui 128 Rapport sur la Question 16/2 correspond à un nombre d'heures annuel variant entre 1 340 et 2 240 (c'est-à-dire entre 26 et 43 heures par semaine), en fonction de l'emplacement considéré. Pour le reste, la mise en place du système est aisée. Les calculs précédents ont montré que les piles solaires doivent être chargées à raison de 35 Ah par semaine, ce qui, en ajoutant les 10% relatifs aux compensations des pertes, nécessite une capacité de batterie de l'ordre de 38,5 Ah. Les Etats du sud des Etats-Unis (le«Sunbelt») bénéficiant de 43 heures d'ensoleillement par semaine, le courant de charge requis est de 38,5 Ah ÷ 43 heures = 0,9 A. Dans la partie nord des Etats-Unis, ce chiffre passe à 38,5 Ah ÷ 25,8 heures = 1,5 A. Pour le système à 12 V décrit ici, le panneau solaire fonctionne avec une batterie à pleine charge d'environ 13,6 V, une diode en série induisant une chute de tension. Si sa tension à pleine charge est de 14 V, un panneau exposé dans une région climatique nord doit fournir une puissance de 21 W (14 V × 1,5 A). En pratique, on peut obtenir cette puissance par le biais d'un panneau solaire de bonne qualité dont la surface ne dépasse pas 65 cm2. Dans les régions ensoleillées, une puissance de 12,6 W (14 V × 0,9 A) peut être suffisante. 5.7.5 Quelques conseils pratiques Les panneaux solaires peuvent être branchés en série pour fournir une tension de sortie plus importante. Si la tension totale en sortie d'un tableau de piles est supérieure à 20 V, des diodes de shuntage devront être placées entre les différentes piles solaires. De la même façon, on peut brancher des panneaux solaires en parallèle pour accroître la capacité de courant de sortie. Il faut installer une diode en série afin d'empêcher que la batterie ne se décharge dans les panneaux solaires. On peut utiliser une diode de Schottky dans les applications pour lesquelles il est important de maintenir une chute de tension la plus faible possible (et une perte minimale de courant de charge). Des précautions doivent être prises pour empêcher la surcharge de la batterie et les décharges gazeuses associées à l'intérieur de la batterie. Plusieurs fabricants proposent à cet effet de simples régulateurs de charge qui déconnectent le panneau solaire de la batterie lorsque celle-ci est en pleine charge. Certains chargeurs permettent la reprise de la charge lorsque la batterie a atteint un certain niveau de décharge. NOTE – Ces valeurs concernent uniquement les batteries plomb-acide; un ensemble de critères de charge complètement différents s'applique dans le cas des batteries NiCd. 5.7.6 Installation des panneaux solaires Si l'on souhaite installer des panneaux solaires à titre permanent, il faut envisager de les placer au niveau du sol sur un simple cadre en bois ou en métal, ou de les monter sur un toit. Ce dernier choix est judicieux si l'on dispose d'un toit dont les pentes présentent les angles voulus (30-60°) et la bonne direction (toute direction entre le sud-est et le sud-ouest convient). La façon la plus simple d'installer des panneaux solaires à titre définitif est d'utiliser un adhésif de silicium. Il faut préalablement placer les diodes en série au dos de chaque panneau. Si l'on souhaite installer des panneaux solaires dans des régions soumises à la foudre, il est particulièrement important de relier à la terre les cadres métalliques entourant ces panneaux. Il faut utiliser pour cette connexion un fil séparé, indépendant des lignes d'alimentation. 6 Répéteurs et réseaux avec partage des ressources 6.1 Communication au-delà de la visibilité directe par le biais de relais Avec les ondes métriques et décimétriques, il est impératif de disposer d'un certain type de système de relais ou de réseau pour assurer des communications fiables au-delà de la visibilité directe. Rapport sur la Question 16/2 6.2 129 Répéteur de Terre Il est possible d'utiliser une seule station de répéteur dans un emplacement approprié (sur une colline ou en haut d'un bâtiment) pour retransmettre des signaux entre des points sans visibilité directe. Figure 16 – Dessin du haut: les stations A et B ne peuvent pas interfonctionner car la propagation est entravée par la présence de collines. Dessin du bas: une station de répéteur peut relayer les signaux entre les stations A et B 6.3 Systèmes radioélectriques mobiles terrestres avec partage de ressource – unité d'échange centrale On parle de partage des ressources en cas de partage automatique d'un ensemble commun de dix fréquences ou plus dans un système de répéteurs multiples. Le partage des ressources peut être effectué dans un seul site ou dans des sites multiples pour assurer une large couverture. Les systèmes avec partage des ressources supposent que chaque utilisateur n'émet que pendant un faible pourcentage du temps, si bien qu'il est possible d'offrir une capacité plus globale avec une bande que si chaque station ou groupe d'utilisateurs possède sa propre fréquence. Lorsque les répéteurs sont reliés, la couverture géographique est meilleure qu'avec un seul répéteur. Un réseau avec partage des ressources offre une certaine redondance qui peut être bénéfique dans les situations de catastrophe. De plus, si cela est établi au préalable, les systèmes avec partage des ressources peuvent offrir une fonction d'urgence pour les appels téléphoniques ou de transmission de données à destination de certaines unités mobiles. 130 Rapport sur la Question 16/2 Un système avec partage des ressources dispose au moins d'un canal de commande qui émet en permanence des données numériques produites par ordinateur afin de contrôler les radios installées à bord de véhicules ou de types portatifs à proximité. Des canaux sont attribués à un groupe pour les seuls besoins du trafic, ce qui permet de libérer les canaux pour d'autres utilisateurs. On procède ainsi pour que les utilisateurs n'entendent que le trafic destiné à leur groupe, lequel est entièrement transparent pour les autres utilisateurs. Il existe deux types de système de commande: le canal de commande spécialisé et le canal de commande réparti. Dans le système de commande spécialisé, le canal de commande fonctionne sur une fréquence. Le système de commande réparti utilise n'importe quel canal libre pour les transmissions de commande. Des identificateurs ainsi qu'un répéteur de rattachement sont attribués aux unités mobiles. Lorsqu'une unité mobile n'émet pas, elle surveille toujours le répéteur de rattachement pour les messages de données. Lorsqu'elle émet, elle envoie une identification par le biais d'un protocole de prise de contact numérique qui ne prend qu'une fraction de seconde. Les caractéristiques des systèmes mobiles terrestres numériques sont décrites dans le Rapport UIT-R M.2014. Ces systèmes prévoient une exploitation avec ou sans partage des ressources, permettant d'établir des communications de téléphonie vocale directes, mobile-mobile au groupe, l'utilisateur pouvant sélectionner diverses fonctions (appel sélectif et communication confidentielle). 6.4 Systèmes radioélectriques mobiles terrestres avec partage des ressources – pas d'unité d'échange centrale Il existe aussi des systèmes de partage des ressources faisant appel à des techniques d'accès multivoies et des protocoles appropriés qui n'exigent pas d'unité d'échange centrale pour la détection d'un canal radioélectrique libre. Ces systèmes sont appelés «système radioélectrique personnel» et «système de radiocommunication numérique de courte portée». Ces deux systèmes utilisent la bande des 900 MHz. Ils comptent jusqu'à 80 canaux et leur puissance d'émission peut atteindre 5 W. Des indications plus détaillées concernant ces deux systèmes figurent dans la Recommandation UIT-R M.1032. Tous les émetteurs-récepteurs de ces systèmes sont normalement en état de veille sur un canal de commande, prêts à recevoir un signal d'appel sélectif. Une station d'appel cherche et trouve un canal de trafic libre, dont elle enregistre le numéro dans sa mémoire. Ensuite, la station d'appel envoie sur un canal de commande un signal d'appel sélectif qui inclut au moins son propre numéro d'identification, celui de la station appelée et celui du canal libre identifié. Les stations en attente détectant leur numéro d'identification dans le signal reçu passent sur le canal de trafic indiqué et entrent en communication. A la fin de la communication, tous les postes reviennent en état de veille. Rapport sur la Question 16/2 131 Bibliographie annotée: choix de textes sur les télécommunications d'urgence Andersen, Verner, et Hansen, Vivi N. (Ed.), Proceedings of the International Emergency Management Society Conference 1997 (Copenhague, 1997). Différents textes sur les aspects technologiques et réglementaires de la gestion des urgences, dont les systèmes de télécommunication employés pendant les situations de catastrophe (421 pages). Anderson, Peter S., Creating virtual emergency operations centres: The integration of fixed and mobile emergency management information systems (dans: Abstracts for the Pan Pacific Hazard '96 Conference and Trade Show, Vancouver, 1996). Résumé d'un texte sur des travaux menés actuellement au Laboratoire de télématique de la Simon Fraser University en vue de mettre en place un centre expérimental virtuel d'opérations d'urgence (1 page). Anselmo, L., Laneve, G., Ulivieri, C., Design of a Constellation of Small Satellites in Low Orbit for the Detection and Monitoring of Natural Disasters. (Document présenté au 45ème Congrès de la Fédération internationale d'astronautique, IAF-94-A.6.056) (Jérusalem, 1994). Cet ouvrage définit les besoins en matière de petits satellites fonctionnant sur orbite basse pour faire face aux risques temporels non continus et assurer le suivi des catastrophes ainsi que les besoins en matière de liaisons de télécommunication associées. En conclusion, les auteurs indiquent que ces systèmes sont possibles et qu'ils complètent les systèmes géostationnaires et les systèmes fonctionnant sur orbite à haute altitude (9 pages). Atkins, Thomas B. J., Amateur Radio: A National and International Resource (Emergency Communications) (dans: Exposés des conférenciers, p. 79-81, Sommet des stratégies, Telecom 96) (Genève, 1996). L'auteur décrit brièvement le rôle d'un radioamateur chargé d'assurer des télécommunications en cas d'urgence et précise les avantages ainsi offerts ainsi que la qualité du travail assuré (3 pages). Borba, Gary, et Botterell, Art, The Internet and Emergency Management: Two Articles from the Net (dans: The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 10, No. 4, pp. 42-43, Mount Macedon, Australie, été 1995/96). Dans «The Internet and Disaster Response», consacré à l'Internet pour le trafic en cas d'urgence, Borba indique certains avantages de cette utilisation mais aussi les problèmes et les solutions possibles. Dans «Network Technology in the Practice of Emergency Management», Botterell explique l'importance qu'il y a de réorganiser en permanence les organisations (appelées organisations Ameta) à l'ère de la technologie du réseau, en particulier pour fournir des réponses rapides lorsqu'il s'agit de gérer des cas d'urgence (3 pages). Braham, Mike, “Endeavouring to Prepare Life and Property: A Canadian Approach to Integrated and Comprehensive Emergency Management”, The Australian Journal of Emergency Management, Vol. 11, No. 2, pp. 14-26, Mount Macedon, Australie, hiver 1995). L'auteur traite des télécommunications d'urgence dans le contexte des opérations communes menées au niveau fédéral et des Etats en matière de planification et d'intervention en cas d'urgence au Canada (13 pages). Agence Caraïbe de réaction aux catastrophes (CDERA), Activity Report: Regional Communications Exercise «Region RAP '94» (Barbade, 1994). Ce rapport a pour objet de décrire l'exercice qui a été mené à bien dans les Caraïbes en 1994 ainsi que les problèmes précis qui se sont posés au cours de l'utilisation des télécommunications pour les secours en cas de catastrophe, notamment en ce qui concerne les réseaux internationaux à ondes courtes et les liaisons par satellite INMARSAT de norme C. Annexe: résumé des incidences de la tempête tropicale «Debbie» à Sainte-Lucie (9 pages + Annexe). Cate, Fred H. (Ed.), Harnessing the Power of Communications to Avert Disasters and Save Lives, International Disaster Communications, The Annenberg Washington Program, Communications Policy Studies, Northwestern University (Washington DC, 1994). Articles sur les télécommunications d'urgence et les informations y relatives, dont le rapport de la table ronde intitulée the Media, Scientific Information and Disasters à la Conférence Yokohama de la décennie IDNDR, auteurs: Webster D., Vessey R., Aponte J., Wenham, B., Rattien S. (62 pages). 132 Rapport sur la Question 16/2 Cate, Fred, Communications and Disaster Mitigation, information paper for the Scientific and Technical Committee of the International Decade for Natural Disaster Reduction (Washington DC, 1995). Analyse de l'application des technologies de télécommunications de pointe en vue d'atténuer les effets des catastrophes, fondée sur une évaluation critique de l'expérience acquise au cours de catastrophes récentes (35 pages). Coile, Russell C., The Role of Amateur Radio in Providing Emergency Electronic Communication for Disaster Management (Pacific Grove, CA, 1996). Introduction de différents services de radioamateurs dans le monde entier et rôle possible dans les télécommunications d'urgence (5 pages HTLM). Corbett, John R. G., Where There Is No Telephone (publié par la Baptist Missionary Society) (Didcot, Angleterre, 1988). Manuel sur les communications radioélectriques à ondes courtes pour les besoins des missions et des agences chargées de dispenser une assistance dans les pays en développement. S'adresse aussi bien aux techniciens qu'aux non-techniciens, couvre tous les aspects, depuis la planification du réseau jusqu'aux instructions techniques détaillées de l'installation des équipements (118 pages). DHA, Nations Unies – Département des affaires humanitaires – Glossaire international multilingue agréé de termes relatifs à la gestion des catastrophes (Genève, 1992). Glossaire anglais-françaisespagnol, avec la définition agréée des termes suivants: catastrophe, atténuation des effets, télédétection, secours, système de télécommunications mobiles par satellite (Satcom), etc. (83 pages). Elotu, Joseph, Telecommunications for Emergency Relief Operations (UIT, Genève, 1985). Dans ce document, l'auteur décrit un système global de télécommunication d'urgence d'application locale ou nationale/régionale utilisant toutes les technologies disponibles, y compris les moyens de télécommunication traditionnels. De plus, le mandat et le rôle de l'UIT y sont précisés (28 pages). Ewald, Steve, ARES Field Manual, (publié par l'American Radio Relay League), (Newington, CT 2000). Manuel d'utilisation pratique sur le service radioamateur d'urgence (76 pages + annexes). Ewald, Steve, The ARRL Emergency Coordinator’s Manual, (publié par l'American Radio Relay League), (Newington, CT, 1997). Manuel pour les radioamateurs responsables de la coordination des services d'urgence (65 pages + annexes). Federal Emergency Management Agency, Emergency Information Public Affairs (FEMA – EIPA), three articles on emergency management issues (Washington, 1995). La FEMA envisage de modifier ses programmes d'aide aux sinistrés en vue d'améliorer le service à la clientèle et de réduire les coûts, en insistant sur le partage des responsabilités de la gestion des urgences entre le secteur public et le secteur privé (1 page). Voir également Bib. 99. Les autres articles sont les suivants: Earthquake Service Centers to Close, But Services to Remain Available (1 p.) in Los Angeles; A Training Set for Housing Seismic Retrofit Contractors (1 p.) in Los Angeles. Harbi, Mohamed, Emergency Telecommunication: towards a global approach (dans: Worldaid '97 directory, p. 77-78, Genève, 1997). Dans cet article, l'auteur indique pourquoi il faut une convention sur l'assistance assurée par le biais des télécommunications en cas d'urgence, précise les principales caractéristiques cibles et enfin, les objectifs à suivre. IFRC, Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge Emergency Response Unit «Telecommunications» (Genève, 1995). Manuscrit décrivant les tâches et la structure de l'unité d'intervention d'urgence «Télécommunications»; on trouvera en annexe un plan du programme de formation associé, une liste des fréquences normalisées pour les unités d'intervention d'urgence ainsi qu'une liste des équipements normalisés (33 pages). Rapport sur la Question 16/2 133 Imai, Yoshinori (Ed.), Media, Technology & Disaster Communications (Special Session of the International Institute of Communications (IIC) Conference, Osaka, 1995). Principaux points traités: rôle des médias et importance des télécommunications d'urgence pendant une catastrophe (31 pages). Inmarsat, Free Airtime Policy Boosts Relief Efforts (dans: Transat, No. 32, p. 1, Londres, mai 1995). Décrit la mise en œuvre de la décision prise par le Conseil d'Inmarsat d'accorder un temps d'antenne gratuit pendant les catastrophes de grande ampleur (1 page). UIT (Ed.), Special Session S.5: Emergency Telecommunications (Rapport de la Session spéciale S.5 du Sommet des stratégies d'Americas Telecom 96, Rio de Janeiro, juin 1996). Principales questions traitées: expériences vécues et rôle des radioamateurs dans les télécommunications d'urgence (4 pages). UIT, Règlement des radiocommunications, (1998). UIT, Recommandation UIT-R M. 1032, Caractéristiques techniques et d'exploitation des systèmes mobiles terrestres faisant appel à des techniques d'accès multivoies sans unité d'échange centrale (1994). UIT, Recommandation UIT-R M.1042, Services d'amateur et d'amateur par satellite: communications en cas de catastrophe (1998). UIT Recommandation UIT-R P.1144, Guide pour l'application des méthodes de prévision de la propagation de la Commission d'études 3 des radiocommunications (2000). UIT, Recommandation UIT-T F.1 Division B (code Morse), dispositions applicables à l'exploitation du service public international des télégrammes (03/98). UIT, Rapport UIT-R M.2014, Systèmes mobiles terrestres numériques à haute efficacité spectrale pour le trafic de dispatching (1998). On y trouve les caractéristiques techniques des systèmes suivants: système Projet 25 de l'APCO, DIMRS, EDACS, FHMNA, IDRA, TETRA et TETRAPOL. Kenney, Gerald I., Disaster Mitigation via Communications in Areas Prone to Volcanic Activity (Document présenté au Pan Pacific Hazards –96 Conference and Trade Show, Vancouver, 1996). Souligne l'importance des techniques de communication modernes dans la prévisibilité et l'état de préparation pour les activités volcaniques. Deux projets de ce type menés par l'Agence canadienne de développement international (ACDI) y sont également décrits (5 pages). Klenk, Jeff, Emergency Information Management & Communications (Training manual (Bib. Z-69A) and trainer's guide (Bib. Z-69B) prepared for UN/DHA/DMTP/CETI Unit, Madison, WI, 1997). Manuel très pratique comportant notamment une section sur les télécommunications d'urgence (p. 36-50). Les problèmes traités concernent notamment ceux qui ont trait à la politique/ l'organisation ainsi qu'à l'équipement/l'infrastructure. On y trouvera aussi une explication sur les systèmes stratégiques et tactiques de télécommunication (60 pages). Los Angeles County, Emergency Management System Overview Briefing (Los Angeles 1990). Présente un aperçu général illustré du système de gestion des urgences dans le comté de Los Angeles, Californie, Etats-Unis, et en particulier de la mise en place d'un centre d'opérations d'urgence. On y trouvera aussi des cartes et des schémas d'implantation du centre d'urgence, le plan des secteurs couverts par les services de défense civile et enfin, les plans des zones de commandement et d'exploitation (17 pages). Lucot, Jean-Paul, Management des Télécommunications dans les Organismes de Secours Internationaux (Genève, 1990). Description complète des systèmes de télécommunication, du CICR et de l'IFRC essentiellement, avec des références aux questions de réglementation (336 pages + annexes). 134 Rapport sur la Question 16/2 MPT Japon, MPT Issues White Paper on Information and Communications Industry for FY 1994 (dans: New Breeze, p. 8-14, été 1995) (Tokyo, 1995). Au paragraphe A de la Section II, il est question des enseignements tirés du grand tremblement de terre Hanshin et Awaji en ce qui concerne la nécessité d'améliorer les moyens de survie et de rétablissement des réseaux de télécommunication (7 pages). National Research Council (Ed.), Practical Experiences from the Loma Pieta Earthquake, Rapport d'un colloque parrrainé par le Geotechnical Board and the Board on Natural Disasters of the National Research Council (Washington DC, 1994). Le Chapitre 5 (Lifeline Perspectives) décrit l'effet du tremblement de terre sur les systèmes de télécommunication publics existants, en fournissant des détails sur les dommages très limités causés à l'infrastructure de télécommunication par rapport aux effets très graves subis sur le plan de la surcharge des systèmes (237 pages + annexes). Office of Foreign Disaster Assistance (OFDA / USAID) (Ed.), Field Operations Guide, (Washington DC, 1994). Renferme des instructions concernant l'évaluation des dommages causés à l'infrastructure des télécommunications et aux télécommunications utilisées sur le terrain par les équipes OFDA/DART durant les situations d'urgence (format de poche, environ 300 pages). Oh, Ei Sun, et Zimmermann, Hans, A Beacon in Time of Distress (dans: Global Communications Asia 1998, p. 52-53, 1998). Sujets traités dans l'article: rôle important des télécommunications pour atténuer les effets des catastrophes; nécessité d'élaborer une convention internationale sur ce sujet et élaboration de cette convention; contenu et adoption au cours de la Conférence intergouvernementale ICET-98 (2 pages). Parada, Carlos avec Gariott, Gary et Green, Janet, The Essential Internet: Basics for international NGOs, Washington, 1997. Ce manuel donne des indications sur la façon dont les ONG pourraient utiliser les (télé)communications. Il contient aussi un chapitre sur la technologie des télécommunications à appliquer dans les actions en cas de catastrophe, en mettant en évidence les problèmes réglementaires ainsi que la technologie qui pourrait être choisie pour les communications en cas de catastrophe et fournit quelques exemples réels (160 pages); également disponible en espagnol. Salmon, Anthony, Draft description of the UN Telecommunications Network for Humanitarian and Disaster Relief (document élaboré pour la deuxième séance plénière du WGET, Genève, 1984). Analyse des incidences de la Résolution 50 de la Conférence de plénipotentiaires de l'UIT (Nice, 1989), sur l'utilisation des réseaux des Nations Unies, en particulier les liaisons VSAT, par d'autres organismes des Nations Unies ou individus (3 pages). Telecommunications Office, Disaster Prevention Bureau, National Land Agency (NLA), Tokyo, NLA's Disaster Prevention Radio System, Tokyo. Présentation du système de communication radioélectrique de prévention des catastrophes de la NLA dans laquelle est indiqué aussi l'équipement de télécommunication que cette agence utilise pour atténuer les effets des catastrophes (18 pages). UNCRD United Nations Centre for Regional Development, The Socioeconomic Impact of Disasters, rapport et résumé des débats du quatrième International Research and Training Seminar on Regional Development Planning for Disaster Prevention (Nagoya, Japon, 1990). Etudes de cas relatives à l'incidence des catastrophes sur l'infrastructure et conséquences pour les entreprises de la zone sinistrée (181 pages). PNUD, Programme des Nations Unies pour le développement, Emergency Relief Items – Compendium of Generic Specifications, Vol. 1 (New York, 1995). Manuel très pratique qui recense les besoins et les mesures recommandées en ce qui concerne les équipements de télécommunication à utiliser pour les secours d'urgence (210 pages). Rapport sur la Question 16/2 135 PNUD/IAPSO, Programme des Nations Unies pour le développement, Bureau du Groupe des services d'achats interorganisations, Items for Emergency Relief, Telecommunications Equipment (Copenhague, 1994). L'introduction de la Partie 1 «Specifications» décrit les besoins spécifiques d'un réseau type de télécommunication d'urgence (20 pages). HCR, Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, Procédure du HCR pour les télécommunications radio (Genève, 1995), Brèves instructions données aux utilisateurs de communications radioélectriques mobiles en ondes métriques et décimétriques pour utilisation sur le terrain, y compris les listes témoins, les instructions en cas d'urgence, la liste des mots codes ainsi que l'alphabet d'épellation de l'OACI (18 pages). VITA (Volunteers in Technical Assistance) (Ed.), VITASAT / VITACOM / Packet Radio, A Communications Technology for the Third World (Arlington VA, 1994). Trois brochures sur les principes et les spécifications techniques d'un système de communication de données utilisant les satellites LEO, équipé d'un ordinateur portable, d'un contrôleur TNC et de liaisons à ondes métriques/ décimétriques de faible puissance pour les communications de données (20 pages). Wallace, William A., On Managing Disasters: The use of Decision-Aid Technologies (New York, 1989). Dans l'analyse qu'il fait des progrès technologiques compte tenu de leur incidence sur les secours en cas de catastrophe, et plus particulièrement sur les télécommunications d'urgence et le rôle des médias, l'auteur indique que l'influence de la politique des pouvoirs publics et de la coopération internationale sera plus déterminante que celle des progrès technologiques (46 pages). Wood, Mark, Disaster Communications, (Publié par la Disaster Relief Communications Foundation) (Topsham, Angleterre, 1995 et 1996). Manuel de formation couvrant les aspects techniques, opérationnels et réglementaires de tous les types de télécommunication d'urgence, les liaisons à ondes métriques/décimétriques, à ondes décamétriques et par satellite, et les différents modes, la téléphonie, SITOR, les données, etc. Une annexe contient les documents techniques et réglementaires (148 pages + annexes). Zimmermann, Hans, Crisis Response Communications: Telecommunications in the Service of Humanitarian Assistance (dans: Proceedings of the International Emergency Management Society Conference, pp. 329-334, Copenhague, 1997). Donne un aperçu des possibilités actuelles, de leur limitation et des prochaines étapes vers l'utilisation optimale des moyens dont disposent et disposeront les gestionnaires des opérations en cas de catastrophe (6 pages). Zimmermann, Hans, Emergency Telecommunications with and in the Field (Genève, 1995). Décrit l'origine, le champ d'application, l'état d'avancement et la mise en œuvre future du projet du DHA sur les télécommunications d'urgence, y compris les fonctions et les activités du groupe de travail sur les télécommunications d'urgence et les travaux menés en vue de l'élaboration de la Convention internationale sur les télécommunications d'urgence (4 pages). Zimmermann, Hans, The Use of HF (Shortwave) Communications Links by DHA (Genève, 1996). Comparaison d'un réseau à ondes décamétriques avec d'autres moyens de communication; utilisation du réseau à ondes décamétriques par le DHA et l'Office des Nations Unies (3 pages). 136 Rapport sur la Question 16/2 Appendices Liste d'abréviations A Ampère A/D Analogique/numérique ac Courant alternatif Ah Ampère-heure AMTOR Protocole Amateur Teleprinting Over Radio ARES Service d'urgence radioamateur ARQ Demande de répétition automatique (technique de correction d'erreur) ASN Appel sélectif numérique ATI Alphabet télégraphique international AX.25 Protocole de couche liaison par paquet radioamateur BLU Bande latérale unique CANTO Association caraïbe des opérateurs nationaux des télécommunications CDERA Agence caraïbe de réaction aux catastrophes CED Correction d'erreur directe CICR Comité international de la Croix-Rouge CMDT Conférence mondiale de développement des télécommunications CMR Conférence mondiale des radiocommunications COU Centre des opérations d'urgence COW Cellules sur roues CP Poste de commandement CQ Appel général (à toutes les stations radioélectriques) CW Onde porteuse (radiotélégraphie morse) DAMA Accès multiple avec assignation en fonction de la demande DHA Département des affaires humanitaires (maintenant OCHA) DSL Ligne d'abonné numérique DSP Traitement du signal numérique EGO Equipe de gestion des opérations en cas de catastrophe (Nations Unies) ELT Emetteur de localisation d'urgence Fax Télécopie FD Exercice quotidien sur le terrain (amateur) FI Fréquence intermédiaire FSTV Télévision d'amateur à balayage rapide FTP Protocole de transfert de fichiers GLONASS Système mondial de navigation par satellite GMPCS Systèmes de communications personnelles mobiles mondiales par satellite GPS Système mondial de repérage GSM Système mondial de communications mobiles HAZMAT Matières dangereuses Rapport sur la Question 16/2 HCR Office du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HF Hautes fréquences (3-30 MHz) HTML Langage de balisage hypertexte IAPSO Bureau du groupe des services d'achats interorganisations (PNUD) IARU Union internationale des radioamateurs (ONG) IASC Commission permanente interagence (organisme consultatif de l'ONU) ICET Conférence intergouvernementale sur les télécommunications d'urgence IDNDR Décennie internationale de la prévention des catastrophes naturelles IFRC Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge IP Protocole Internet kW Kilowatt LAN Réseau local LEO Orbite terrestre basse (satellite) LES Station terrienne terrestre MA Modulation d'amplitude MF Modulation de fréquence MMSI Indicateur de service mobile maritime NCS Station de commande du réseau NiCd Cadmium-nickel (accumulateur) NiMH Hydrure métallique de nickel (accumulateur) NOTAM Avis aux navigateurs aériens NVIS Onde ionosphérique à incidence quasi verticale (propagation) OACI Organisation de l'aviation civile internationale OCHA Office pour la coordination des affaires humanitaires (Nations Unies) OMI Organisation maritime internationale OMS Organisation mondiale de la santé (Nations Unies) ONG Organisation non gouvernementale ONUG Office des Nations Unies à Genève OSG Orbite géostationnaire (satellite) OSOCC Centre opérationnel de coordination sur le terrain PACSAT Satellite avec transpondeur par radio en mode paquet PACTOR Radio par mode paquet PAM Programme alimentaire mondial PBBS Panneau d'affichage électronique par paquet PBX Autocommutateur privé PCS Systèmes de communication personnelle PDG Président-Directeur général PLB Radiobalise individuelle de repérage PNUD Programme des Nations Unies pour le développement POP Protocole POP POTS Système téléphonique ordinaire RBS Station de base radioélectrique 137 138 Rapport sur la Question 16/2 RF Fréquence radioélectrique RMTP Réseau mobile terrestre public RNIS Réseau numérique avec intégration des services RTPC Réseau téléphonique public commuté RTTY Radiotéléimprimeur (radiotélégraphie à impression directe à bande étroite) SDA Sélection directe à l'arrivée SDR Unité suisse d'opérations de secours; fonction radioélectrique définie par logiciel SELCAL Appel sélectif SET Test de simulation de situations d'urgence SITOR Téléimprimeur Simplex sur radio (système de radiotélégraphie à impression directe à bande étroite utilisé dans le service mobile maritime) SMDSM Système mondial de détresse et de sécurité en mer SOLAS Sauvegarde de la vie humaine en mer SRSA Agence suédoise des services de secours SSTV Télévision d'amateur à analyse lente TCO Fonctionnaire chargé de la coordination des télécommunications TCP/IP Protocole de commande de transmission/Protocole Internet TNC Contrôleur de nœuds de terminal (radio par paquet) TOS Taux d'ondes stationnaires UHF Ondes décimétriques (30-3 000 MHz) UIT Union internationale des télécommunications UIT-D Secteur du développement des télécommunications (UIT) UIT-R Secteur des radiocommunications (UIT) UIT-T Secteur de la normalisation des télécommunications (UIT) UNDAC Organisme des Nations Unies pour la coordination et l'évaluation des catastrophes UNICEF Fonds des Nations Unies pour l'enfance USAT Nanostation USD Dollar des Etats-Unis V Volt VHF Ondes métriques (30-300 MHz) VITA Volunteers in Technical Assistance VSAT Microstation W Watt WAN Réseau étendu WAP Protocole d'application hertzienne WGET Groupe de travail chargé des télécommunications en cas d'urgence WLL Boucle locale hertzienne (généralement remplacée par l'accès hertzien fixe (FWA) WWW World Wide Web Rapport sur la Question 16/2 139 Signaux du code Morse 1 1.1 Les caractères d'écriture qui peuvent être utilisés et les signaux qui leur correspondent dans le code Morse sont indiqués ci-après: 1.1.1 Lettres a .− i .. r .−. accentué b c d e e f −... −.−. −.. . ..−.. ..−. g −−. h .... 1.1.2 .−−−− ..−−− ... −− ....− ..... s t u v w x ... − ..− ...− .−− −..− p q .−−. −−.− y z −.−− −−.. 6 7 8 9 0 −.... −−... −− .. −−−−. −−−−− Signes de ponctuation et signes divers Point ..................................................................................... Virgule .................................................................................. Deux-points ou signe de division ......................................... Point d'interrogation ou demande de répétition d'une transmission non comprise .................................................... Apostrophe ........................................................................... Trait d'union, tiret ou signe de soustraction ......................... Barre de fraction ou signe de division ................................. Parenthèse de gauche (ouverte) ............................................ Parenthèse de droite (fermée) ............................................... Guillemets (avant et après les mots) ..................................... Double trait ........................................................................... Compris ................................................................................ Erreur (huit points) ............................................................... Croix ou signe d'addition ...................................................... Invitation à transmettre ......................................................... Attente .................................................................................. Fin de travail ......................................................................... Signal de commencement (commencement de toute transmission) ........................................................................ Signe de multiplication ......................................................... _______________ 1 .−−− −.− .−.. −− −. −−− Chiffres 1 2 3 4 5 1.1.3 j k l m n o Extrait de la Recommandation UIT-T F.1, Division B. [.] [,] [:] .−.−.− −−..−− −−−... [?] ['] [–] [/] [(] [)] [« »] [=] ..−−.. .−−−−. −....− −..−. −.−−. −.−−.− .−..−. −...− ...−. ........ .−.−. −.− .−... ...−.− [+] [×] −.−.− −..− 140 Rapport sur la Question 16/2 Table d'épellation des lettres2 Lettre à transmettre A Alfa AL FAH B Bravo BRA VO C Charlie TCHAH LI ou CHAR LI D Delta DEL TAH E Echo ÈK O F Foxtrot FOX TROTT G Golf GOLF H Hotel HO TÈLL I India IN DI AH J Juliett DJOU LI ÈTT K Kilo KI LO L Lima LI MAH M Mike MA ÏK N November NO VÈMM BER O Oscar OSS KAR P Papa PAH PAH Q Quebec KÉ BEK R Romeo RO MI O S Sierra SI ER RAH T Tango TANG GO U Uniform YOU NI FORM ou OU NI FORM V Victor VIK TAR W Whiskey OUISS KI X X-ray EKSS RÉ Y Yankee YANG KI Z Zulu ZOU LOU _______________ 2 Prononciation du mot de code Code word to be used Extrait du Règlement des radiocommunications, Appendice S14. Rapport sur la Question 16/2 141 Epellation des chiffres Chiffre ou signe à transmettre Prononciation3 (OACI) Mot de code (Appendice S14) Prononciation du mot de code (Appendice S14) 0 ZIRO Nadazero NAH-DAH-ZE-ROH 1 OUANN Unaone OU-NAH-OUANN 2 TOU Bissotwo BIS-SO-TOU 3 TRI Terrathree TÉ-RAH-TRI 4 FO - eur Kartefour KAR-TE-FO-EUR 5 FA - ÏF Pantafive PAN-TAH-FA-ÏF 6 SIKS Soxisix SOK-SI-SIKS 7 SÈV'n Setteseven SE-TE-SEV'N 8 EÏT Oktoeight OK-TOH-EÏT 9 NAÏ - neu Novenine NO-VE-NAÏ-NEU Décimale DÈ - SI - MAL Decimal DE-SI-MAL Hundred HUN dred Thousand TAOU - ZEND Q Code4 On peut donner un sens affirmatif ou négatif à certaines abréviations du code Q en transmettant, immédiatement après l'abréviation, la lettre C ou les lettres NO (en radiotéléphonie, mot de code CHARLIE ou prononciation NO). La signification des abréviations du code Q peut être étendue ou complétée par l'adjonction appropriée d'autres abréviations, d'indicatifs d'appel, de noms de lieux, de chiffres, de numéros, etc. Les espaces en blanc contenus entre parenthèses correspondent à des indications facultatives. Ces indications sont transmises dans l'ordre où elles se trouvent dans le texte des tables ci-après. Les abréviations du code Q prennent la forme de questions quand elles sont suivies d'un point d'interrogation en radiotélégraphie et de RQ (ROMEO QUEBEC) en radiotéléphonie. Quand une abréviation employée comme question est suivie d'indications additionnelles ou complémentaires, il convient de placer le point d'interrogation ou l'abréviation RQ après ces indications. Les heures sont indiquées en temps universel coordonné (UTC) à moins d'indications contraires dans les questions ou réponses. _______________ 3 Extrait des procédures de radiotéléphonie de l'OACI. 4 Extrait de la Recommandation UIT-R M.1172, Abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications du service mobile maritime, Règlement des radiocommunications (1998). 142 Rapport sur la Question 16/2 Abréviation Question Réponse ou avis QRA Quel est le nom de votre navire (ou de votre station)? Le nom de mon navire (ou de ma station) est … QRB A quelle distance approximative vous trouvez-vous de ma station? La distance approximative entre nos stations est de … milles marins (ou kilomètres). QRG Voulez-vous m'indiquer ma fréquence exacte (ou la fréquence exacte de …)? Votre fréquence exacte (ou la fréquence exacte de …) est … kHz (ou MHz). QRH Ma fréquence varie-t-elle? Votre fréquence varie. QRI Quelle est la tonalité de mon émission? La tonalité de votre émission est… 1. bonne 2. variable 3. mauvaise. QRK Quelle est l'intelligibilité de ma transmission (ou de la transmission de … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)? L'intelligibilité de votre transmission (ou de la transmission de … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)) est … QRL Etes-vous occupé? Je suis occupé (ou je suis occupé avec … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)). Prière de ne pas brouiller. QRM Mon émission est-elle brouillée? Votre émission est brouillée … 1. mauvaise 2. médiocre 3. assez bonne 4. bonne 5. excellente. 1. votre émission n'est nullement brouillée 2. faiblement 3. modérément 4. fortement 5. très fortement. QRZ Par qui suis-je appelé? Vous êtes appelé par … (sur ... kHz (ou MHz)). QSA Quelle est la force de mes signaux (ou des signaux de … (nom ou indicatif d'appel ou les deux))? La force de vos signaux (ou des signaux de … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)) est … 1. à peine perceptible 2. faible 3. assez bonne 4. bonne 5. très bonne. QSB La force de mes signaux varie-t-elle? La force de vos signaux varie. QSO Pouvez-vous communiquer avec … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) directement (ou par relais)? Je peux communiquer avec … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) directement (ou par relais par l'intermédiaire de …). QSP Voulez-vous retransmettre à … (nom ou Je vais retransmettre à … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) gratuitement. indicatif d'appel ou les deux) gratuitement? Rapport sur la Question 16/2 Abréviation Question 143 Réponse ou avis QSV Dois-je transmettre une série de V (ou de signaux) pour réglage sur cette fréquence (ou sur … kHz (ou MHz))? Transmettez une série de V (ou de signaux) pour réglage sur cette fréquence (ou sur … kHz (ou MHz)). QSW Voulez-vous transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur … kHz (ou MHz)) (en émission de la classe …)? Je vais transmettre sur la fréquence actuelle (ou sur … kHz (ou MHz)) (en émission de la classe …). QSX Voulez-vous écouter … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) sur … kHz (ou MHz) ou dans les bandes …/voies …? J'écoute … (nom ou indicatif d'appel ou les deux) sur … kHz (ou MHz) ou dans les bandes …/voies … QSY Dois-je passer à la transmission sur une autre fréquence? Passez à la transmission sur une autre fréquence (ou sur … kHz (ou MHz)). QSZ Dois-je transmettre chaque mot ou groupe plusieurs fois? Transmettez chaque mot ou groupe deux fois (ou … fois). QTA Dois-je annuler le télégramme (ou le message) numéro …? Annulez le télégramme (ou le message) numéro … QTC Combien avez-vous de télégrammes à transmettre? J'ai … télégrammes pour vous (ou pour … (nom ou indicatif d'appel ou les deux)). QTH Quelle est votre position en latitude et en longitude (ou d'après toute autre indication)? Ma position est … latitude, … longitude (ou d'après toute autre indication). QTR Quelle est l'heure exacte? L'heure exacte est ... Abréviations et signaux divers5 Abréviation ou signal Définition AA Tout après … (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). AB Tout avant … (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). ADS Adresse (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). AR AS Attente. BK Signal employé pour interrompre une transmission en cours. BN Tout entre … et … (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). Fin de transmission. _______________ 5 Extrait de la Recommandation UIT-R M.1172, Abréviations et signaux divers à employer dans les radiocommunications du service mobile maritine, Règlement des radiocommunications (1998). 144 Rapport sur la Question 16/2 Abréviation ou signal Définition BQ Réponse à RQ. BT Signal de séparation entre les différentes parties d'une même transmission. C Oui (réponse affirmative), ou bien: le groupe qui précède doit être compris comme une affirmation. CFM Confirmez (ou Je confirme). CL Je ferme ma station. COL Collationnez (ou Je collationne). CORRECTION Annulez mon dernier mot ou groupe, la correction va suivre (utilisé en radiotéléphonie et prononcé KOR-REK-CHEUNN). CQ Appel général à toutes les stations. CS Indicatif d'appel (employé pour demander un indicatif d'appel). DE «De …» (utilisé devant le nom ou toute autre identification de la station appelante). K Invitation à transmettre. KA Signal de commencement de transmission. MIN Minute (ou Minutes). NIL Je n'ai rien à vous transmettre. NO Non (négation). NW Maintenant. OK Nous sommes d'accord (ou C'est correct). PBL Préambule (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). PSE S'il vous plaît. R Reçu. REF Référence à … (ou Référez-vous à …). RPT Répétez (ou Je répète) (ou Répétez …). RQ Indication d'une demande. SIG Signature (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). SVC Préfixe indiquant un télégramme de service. SYS Référez-vous à votre télégramme de service. TFC Trafic. TU Je vous remercie. TXT Texte (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). VA Fin de travail. WA Mot après … (à employer après un point d'interrogation en radiotélégraphie ou après RQ en radiotéléphonie (en cas de difficultés de langage) ou après RPT, pour demander une répétition). WD Mot(s) ou Groupe(s). WX Bulletin météorologique (ou Bulletin météorologique suit). ______________ Note: En radiotélégraphie, un trait horizontal surmontant les lettres qui composent un signal signifie que ces lettres doivent être transmises comme un seul signal. Rapport sur la Question 16/2 Mots code6 Force du signal et clarté Force du signal Parlé Signification FORT Votre signal est très fort, je vous entends très bien BON Votre signal est bon, je vous entends bien FAIBLE Votre signal est faible, je vous entends mal TRÈS FAIBLE Votre signal est très faible, je vous entends à peine MAUVAIS Votre signal est inaudible, je ne vous entends pas du tout Clarté Parlé Signification CLAIR Excellente qualité LISIBLE Bonne qualité DEFORMÉ J'ai du mal à vous lire BROUILLÉ J'ai du mal à vous lire à cause des interférences ILLISIBLE Je vous entends mais ne peux pas vous lire du tout Mot code Signification BIEN REÇU Confirmez que vous avez reçu mon message et exécuterez AFFIRMATIF Oui/Correct TOUT APRÈS Tout ce que vous (j'ai) avez transmis avant ... TOUT APRÈS Tout ce que vous (j'ai) avez transmis après ... BREAK Indique que le texte est séparé du reste du message BREAK BREAK (COUPEZ) Je souhaite interrompre un échange actuel de transmissions pour passer un message urgent INDICATIF D'APPEL Le groupe qui suit est un indicatif d'appel ANNULEZ Annulez le message transmis précédemment CORRECT Correct ou vous avez transmis correctement CORRECTION Une erreur a été commise dans cette transmission (ou un message est indiqué). La version correcte est ... IGNOREZ Considérez que ce message n'a pas été transmis _______________ 6 Adaptés des procédures pour les communications radio du HCR et sources supplémentaires. 145 146 Rapport sur la Question 16/2 PAS DE RÉPONSE La(les) station(s) appelée(s) ne doivent pas répondre, accuser réception, ou transmettre en rapport avec cette communication CHIFFRES Chiffres suivent (dans le message) SUIS-JE CLAIR? Clarté de mon signal? JE RÉPÈTE Je répète pour préciser ou pour souligner MESSAGE SUIT J'ai un message officiel que vous devez enregistrer (ex. par écrit) SUIVI Ecouter sur ... (fréquence) NÉGATIF Non/Incorrect À VOUS Ceci est la fin de la transmission et une réponse est nécessaire TERMINÉ J'ai terminé, je n'attends pas de réponse (A VOUS et TERMINE ne sont jamais utilisés ensemble) COLLATIONNEZ Relisez-moi le message exactement comme vous l'avez reçu TRANSMETTEZ À ... Transmettez le message suivant à tous les destinataires ou à l'adresse suivante RAPPORT Communiquez-moi l'information suivante ... MESSAGE REÇU J'ai bien reçu votre dernier message (n'est pas une réponse à une question) RÉPÉTEZ TOUT Répétez votre dernier message ou répétez la portion indiquée par «TOUT APRES» SILENCE Cessez immédiatement toute transmission et ce jusqu'à nouvel ordre SILENCE LEVÉ Les transmissions peuvent reprendre après que le SILENCE a été ordonné PARLER PLUS LENTEMENT Vos messages sont trop rapides; réduisez la vitesse STATION INCONNUE L'identité de la station qui appelle est inconnue VÉRIFIEZ Vérifiez tout le message (ou le passage indiqué) avec l'origine et renvoyez la version corrigée. A n'utiliser que selon directives ou par le destinataire du passage marqué ATTENDEZ Attendez quelques secondes VOUS RAPPELLE Attendez un peu plus longtemps, je reprendrai contact avec vous ultérieurement WILCO J'ai reçu et bien compris votre message et exécuterai (l'indication MESSAGE REÇU est sous-entendue mais n'est pas formulée) LE MOT AVANT Le mot auquel je me réfère est celui qui suit ... LE MOT APRÈS Le mot auquel je me réfère est celui juste devant ... DOUBLEZ La communication est difficile. Doublez toutes les phrases INCORRECT Votre dernière transmission était incorrecte, la version correcte est ... Rapport sur la Question 16/2 147 RECOMMANDATION UIT-R P.1144-1 GUIDE POUR L'APPLICATION DES MÉTHODES DE PRÉVISION DE LA PROPAGATION DE LA COMMISSION D'ÉTUDES 3 DES RADIOCOMMUNICATIONS (1995-1999) L'Assemblée des radiocommunications de l'UIT, considérant a) qu'il est nécessaire d'apporter de l'aide aux utilisateurs des Recommandations UIT-R de la série P (élaborées par la Commission d'études 3 des radiocommunications), recommande 1 que les renseignements contenus dans le Tableau 1 soient utilisés comme indications pour l'application des diverses méthodes de prévision de la propagation contenues dans la série P des Recommandations de l'UIT-R (développées par la Commission d'études 3 des radiocommunications). NOTE 1 – A chacune des Recommandations UIT-R qui figurent dans le Tableau 1 sont associées des colonnes qui indiquent: Domaine d'application: le ou les services ou applications auxquels est destinée la Recommandation. Type: les cas auxquels s'applique la Recommandation, tels que point à point, point à zone, visibilité directe, etc. Données de sortie: la valeur du paramètre de sortie fournie par la méthode, par exemple, affaiblissement le long du trajet. Fréquences: la gamme des fréquences pour lesquelles s'applique la Recommandation. Distances: la gamme des distances pour lesquelles s'applique la Recommandation. Pourcentage du temps: valeurs ou gamme des valeurs des pourcentages de temps pour lesquelles s'applique la Recommandation. Le pourcentage du temps correspond à celui pendant lequel la valeur du signal prévu est dépassée au cours d'une année moyenne. Pourcentage des emplacements: la gamme des pourcentages des emplacements pour lesquels s'applique la Recommandation. Le pourcentage des emplacements correspond à celui, à l'intérieur, par exemple, d'un carré de 100 à 200 m de côté, où le signal prévu est dépassé. Hauteur des terminaux: la gamme des hauteurs des antennes des terminaux pour lesquelles s'applique la Recommandation. Données d'entrée: la liste des paramètres utilisés par la méthode de la Recommandation; ces paramètres sont classés par ordre d'importance et, dans certains cas, on peut utiliser des valeurs par défaut. Le Tableau 1 contient des renseignements qui sont déjà fournis par les Recommandations elles-mêmes, mais il permet aux utilisateurs de se rendre compte rapidement des possibilités, et des limitations, des Recommandations sans avoir à se référer à leur texte. 148 Tableau 1 – Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques Méthode Domaine d'application Type Données de sortie Fréquences Distances Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements Hauteur des terminaux Données d'entrée Tous les services Point à point Champ 10 kHz à 30 MHz 1 à 10 000 km Ne s'applique pas Ne s'applique pas Au sol Fréquence Conductivité du sol Rec. UIT-R P.370 Radiodiffusion Point à zone Champ 30 MHz à 1 000 MHz 10 à 1 000 km 1, 5, 10, 50 1 à 99 Emetteur: hauteur équivalente de moins de 0 m à plus de 1 200 m Récepteur: 1,5 à 40 m Distance Hauteur de l'antenne d'émission Fréquence Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne de réception Angle de dégagement du terrain Irrégularité de terrain Pourcentage d'emplacements Rec. UIT-R P.1147 Radiodiffusion Point à zone Champ de l'onde ionosphérique 0,15 à 1,7 MHz 50 à 12 000 km 10, 50 Ne s'applique pas Ne s'applique pas Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Distance Nombre de taches solaires Puissance de l'émetteur Fréquence Rec. UIT-R P.452 Services utilisant des stations à la surface de la Terre; brouillage Point à point Affaiblissement le long du trajet 700 MHz à 30 GHz Pas spécifié mais jusqu'à et au-delà de l'horizon radioélectrique 0,001 à 50 Année moyenne et mois le plus défavorable Ne s'applique pas Aucune limite spécifiée Données de profil de trajet Fréquence Pourcentage de temps Hauteur de l'antenne d'émission Hauteur de l'antenne de réception Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Données météorologiques Rapport sur la Question 16/2 Rec. UIT-R P.368 Tableau 1 – Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques (suite) Méthode Domaine d'application Type Données de sortie Fréquences Distances Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements Hauteur des terminaux Données d'entrée 125 MHz à 15 GHz 5, 50, 95 0 à 1 800 km (Pour les applications aéronautiques, une distance horizontale de 0 km ne veut pas dire une longueur de trajet de 0 km) Ne s'applique pas H1: 15 m à 20 km H2: 1 à 20 km Mobile terrestre Point à zone Radiodiffusion Champ 1 à 3 GHz 1 à 500 km 1 à 99 1 à 99 Emetteur ≥ 1 m Distance Récepteur: 1 à 30 m Fréquence Hauteur de l'antenne d'émission Hauteur de l'antenne de réception Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements Renseignements sur le terrain Rec. UIT-R P.529 Mobile terrestre Point à zone Champ 30 MHz à 3 GHz VHF: 10 à (Application limitée 600 km au-dessus de 1,5 GHz) UHF: 1 à 100 km VHF: 1, 10, 50 UHF: 50 Non spécifié Base: 20 m à 1 km Mobile: 1 à 10 m Distance Hauteur de l'antenne de la base Fréquence Hauteur de l'antenne du mobile Pourcentage du temps Couverture du sol Rec. UIT-R P.530 Liaisons fixes en visibilité directe Affaiblissement le long du trajet Amélioration apportée par la diversité (condition de temps clair) XPD Interruption Caractéristiques d'erreur 150 MHz à 40 GHz environ Tous les pourNe s'applique pas centages de temps en condition de temps clair; 1 à 0,001 en présence de précipitations (1) Hauteur suffisante pour un dégagement du trajet Distance Hauteur de l'émetteur Fréquence Hauteur du récepteur Pourcentage du temps Données sur l'obstruction du trajet Données climatiques Mobile aéronautique Rec. UIT-R P.1146 Point à point Point à point visibilité directe Jusqu'à 200 km en visibilité directe Distance Hauteur de l'émetteur Fréquence Hauteur du récepteur Pourcentage du temps Rapport sur la Question 16/2 Affaiblissement le long du trajet Rec. UIT-R P.528 149 150 Tableau 1 – Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques (suite) Méthode Domaine d'application Type Données de sortie Fréquences Distances Pourcentage du temps Pourcentage des emplacements Hauteur des terminaux Données d'entrée Radiodiffusion Service fixe Service mobile Point à point MUF de référence 2 à 30 MHz Champ de l'onde ionosphérique Puissance disponible à l'entrée du récepteur Rapport signal/bruit LUF Fiabilité de circuit 0 à 40 000 km Tous les pourcentages Ne s'applique pas Ne s'applique pas Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Nombre de taches solaires Mois Heure(s) de la journée Fréquences Puissance de l'émetteur Type d'antenne de l'émetteur Type d'antenne du récepteur Rec. UIT-R P.534 Service fixe Service mobile Radiodiffusion Point à point par l'intermédiaire de E-sporadique Champ 0 à 4 000 km 0 à 50 Ne s'applique pas Ne s'applique pas Distance Fréquence Rec. UIT-R P.616 Service mobile maritime Rec. UIT-R P.617 Liaisons fixes transhorizon Point à point Affaiblissement le long du trajet > 30 MHz 100 à 1 000 km Ne s'applique pas Aucune limite spécifiée Fréquence Gain de l'antenne d'émission Gain de l'antenne de réception Géométrie du trajet Rec. UIT-R P.618 Service fixe par satellite Point à point Affaiblissement le long du trajet 1 à 55 GHz Toute hauteur Ne s'applique pas 0,001-5 pour d'orbite utilisable l'affaiblissement; 0,001-1 pour XPD. Aucune limite Données météorologiques Fréquence Angle d'élévation Hauteur de la station terrienne Distance et angle entre les emplacements des stations terriennes (pour le gain de diversité) Diamètre des antennes et efficacité (pour la scintillation) Angle de polarisation (pour XPD) 30 à 100 MHz Comme pour la Recommandation UIT-R P.370 Gain de diversité et XPD (en présence des précipitations) 20, 50, 90, 99, et 99,9 Rapport sur la Question 16/2 Rec. UIT-R P.533 Tableau 1 – Méthodes UIT-R de prévision de la propagation des ondes radioélectriques (fin) Méthode Domaine d'application Type Données de sortie Rec. UIT-R P.620 Coordination en fréquence de la station terrienne Distance de coordination Distance à partir de laquelle on obtient l'affaiblissement de propagation requis Rec. UIT-R P.680 Service mobile maritime par satellite Point à point Fréquences Pourcentage du temps Distances Hauteur des terminaux Données d'entrée Aucune limite spécifiée Affaiblissement de transmission minimum de base Fréquence Pourcentage du temps Angle d'élévation de la station terrienne Evanouissements 0,8 à 8 GHz dus à la surface de la mer Durée des évanouissements Brouillage (satellite adjacent) Ne s'applique pas Toute hauteur Jusqu'à 0,001% d'orbite utilisable par la distribution de RiceNakagami Aucune limite Fréquence Angle d'élévation Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée Limite de 0,01% pour le brouillage 1) Rec. UIT-R P.681 Service mobile terrestre par satellite Point à point Evanouissements sur le trajet Durée des évanouissements Durée sans évanouissement 0,8 à 20 GHz Toute hauteur Ne s'applique pas d'orbite utilisable Pourcentage de la distance parcourue 1 à 80% 1) Ne s'applique pas Aucune limite Fréquence Angle d'élévation Pourcentage de la distance parcourue Niveau approximatif de l'occultation optique Rec. UIT-R P.682 Service mobile aéronautique par satellite Point à point Evanouissements dus à la surface de la mer 1 à 2 GHz Toute hauteur Jusqu'à d'orbite utilisable 0,001% par la distribution de Rice-Nakagami 1) Ne s'applique pas Aucune limite Fréquence Angle d'élévation Polarisation Gain maximum de l'antenne dans la direction de visée Hauteur des antennes Rec. UIT-R P.684 Service fixe Point à point Champ de l'onde ionosphérique 30 à 500 MHz 0 à 40 000 km 50 Ne s'applique pas Ne s'applique pas Latitude et longitude de l'émetteur Latitude et longitude du récepteur Distance Puissance de l'émetteur Fréquence Rec. UIT-R P.843 Service fixe Service mobile Radiodiffusion Point à point par l'intermédiaire d'impulsions météoriques Puissance reçue Taux d'impulsions 30 à 100 MHz 100 à 1 000 km 0à5 Ne s'applique pas Ne s'applique pas Fréquence Distance Puissance de l'émetteur Gain des antennes 1) Rapport sur la Question 16/2 Ne s'applique pas 100 MHz à 105 GHz jusqu'à 1 200 km 0,001 à 50 Pourcentage des emplacements Pourcentage du temps d'interruption; pour la disponibilité de service, soustraire la valeur de 100. 151 ">
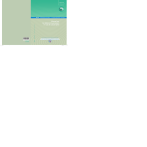
Télécharger
Fonctionnalités clés
Fournit un cadre international de réglementation.
Développe le concept national de communications en cas de catastrophe.
Décrit le rôle des organisations internationales.
Met en évidence les structures nationales de gestion.
Traite de l'atténuation des effets des catastrophes.
Aborde les télécommunications dans la réaction aux catastrophes.
Foire aux questions
Les trois niveaux sont : local, national et international.
La levée des obstacles réglementaires pour accélérer et faciliter l'utilisation des télécommunications en cas de catastrophe dans le cadre de l'assistance humanitaire internationale.
Le coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe, par le biais de l'Office des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA).




