Eyrolles L'informatique de la chaîne graphique Manuel utilisateur
PDF
Descargar
Documento
PDT_chainegraphique_XP
8/08/07
14:23
Page 2
Sous la direction de Brigitte Peltier
COURS D’INDUSTRIES
G.R.A.P.H.I.Q.U.E.S
L’informatique
de la chaîne
graphique
Pascal Prévôt
© Groupe Eyrolles 2007
ISBN : 978-2-212-12023-3
LES FICHIERS INFORMATIQUES
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Introduction
ID 2.0
P DF
Adobe
Adobe
L’ordinateur traite des informations de tous genres : textes, photos, illustrations, calculs scientifiques, images de synthèse, etc. Toutes ces données doivent
être sauvegardées et surtout structurées. Lorsqu’une application ouvre un
fichier, il faut qu’elle sache à quoi elle a à faire et comment elle doit l’analyser. Chaque application, lors de la sauvegarde d’un fichier, enregistre
les données du document dans un format particulier. Ainsi, lors de
l’ouverture du fichier, le logiciel auquel il est destiné peut lire les
données et les traiter convenablement. Chaque fichier est accompagné d’un suffixe indiquant son format (.txt, .psd, .doc, etc.),
ce qui permet une reconnaissance de l’appartenance du fichier
à une application avant même la lecture de ce dernier. Le système d’exploitation associe également une icône aux différents
types de fichier pour une identification visuelle et rapide par
l’utilisateur.
A
En réalité, un fichier enregistré sur un support informatique,
quel qu’il soit, correspond à une suite d’états d’information/non information. Par
exemple, un lecteur de CD-Rom (ou de DVD-Rom), par le biais de son laser, va
scruter la surface d’une galette en plastique (le CD-Rom lui-même) présentant des
trous qui indiquent la présence d’informations. Électriquement, la présence ou
l’absence de trous va activer des circuits électroniques pour organiser et structurer
les informations recueillies (fig. 1). En réalité la détection du « 1 » se fait lorsqu’il y
a passage d’un creux à une surface plane ou inversement. Mais cela ne gêne en rien
la démonstration. Comme vu dans le chapitre précédent, pour une meilleure compréhension par l’être humain, on codifie les
10110101
informations en bits puis en octets. Ensuite,
la gestion de ces données sera réalisée suivant
des règles « inventées » par les informaticiens,
Impulsion électrique
Rayon laser
l’ordinateur n’étant qu’une simple machiCD-Rom
ne électrique obéissant à des
ordres pré-programmés.
Trou
Quatres grands
types de formats de
fichiers sont utilisés dans
les industries graphiques : le
texte, le bitmap, le vectoriel et les polices de caractères.
Fig. 1 : de
l’impulsion
éléctrique à
l’octet
23
chap 2.indd 23
7/08/07 13:51:56
Fichiers texte
01001101
M
O
P
%
ù
+
=
£
C’est le fichier de base par excellence. C’est même le tout premier fichier qui
ait été inventé en informatique. Très vite, les premiers informaticiens ont eu
besoin de dialoguer avec les circuits électroniques de leurs machines. Il leur fallait
envoyer et visualiser des informations de façon naturelle. Le plus facile pour communiquer étant l’écrit, le clavier pour saisir des lettres et le moniteur (écran) pour visualiser des messages naquirent. Bien sûr, il
fallut codifier ce texte au format informatique et, pour que tous
les informaticiens du monde puissent s’entendre, le code ASCII
(American Standard Code for Information Interchange) fut inventé.
À chaque caractère, signe de ponctuation, action sur le clavier fut
associée une valeur numérique (fig. 2), certaines étant réservées
à la commande de périphériques : imprimantes, modems. Le
tableau T1 représente cette codification.
Un fichier texte regroupe ces codes et les restitue après traitement sous forme de lettres, de chiffres, de signes de ponctuation,
d’ordres comme la tabulation, le retour chariot, etc.
Il est à noter que le monde PC et le monde Mac n’utilisent
Fig. 2 : du
pas exactement la même codification des caractères, notamment
clavier à
l’affichage
pour les caractères accentués (numérotés de 128 à 256) et qu’il
est nécessaire de faire une conversion (parfois automatique).
0
Nul
16
Data Link Escape
32
Espace
48
0
64
@
80
P
96
`
112
p
1
Début d’en-tête
17
Contrôle périph.
33
!
49
1
65
A
81
Q
97
a
113
q
2
Début de texte
18
Contrôle périph.
34
‘‘
50
2
66
B
82
R
98
b
114
r
3
Fin de texte
19
Contrôle périph.
35
#
51
3
67
C
83
S
99
c
115
s
4 Fin de transmission
20
Contrôle périph.
36
$
52
4
68
D
84
T
100
d
116
t
5
21
Acc. de réception
37
%
53
5
69
E
85
U
101
e
117
u
6 Accusé de réception
22
Synchronisation
38
&
54
6
70
F
86
V
102
f
118
v
7
Beep
23 Fin de transmission
39
‘
55
7
71
G
87
W
103
g
119
w
8
Backspace
24
Annulation
40
(
56
8
72
H
88
X
104
h
120
x
9
Tab. horizontale
25
Fin de support
41
)
57
9
73
I
89
Y
105
i
121
y
10
Saut de ligne
26
Substitution
42
*
58
:
74
J
90
Z
106
j
122
z
11
Tab. verticale
27
Escape
43
+
59
;
75
K
91
[
107
k
123
{
12
Saut de page
28 Séparateur de fichier
44
,
60
<
76
L
92
\
108
l
124
l
13
Retour chariot
29 Séparateur de groupe
45
-
61
=
77
M
93
]
109
m
125
}
14
Fin d’extension
30 Séparateur d’enreg.
46
.
62
>
78
N
94
^
110
n
126
Demande
24
chap 2.indd 24
Tableau T1 : le code ASCII
Code ASCII
Caractère ou action correspondant
6/08/07 10:23:57
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Fichiers bitmap
Le mot bitmap veut dire carte de bits ou matrice de bits. L’écran est divisé
suivant une grille. Chaque case de cette grille est associée à une information binaire et, en fonction de cette information ; l’ordinateur, via sa carte vidéo, affiche un
point sur l’écran, appelé pixel (fig. 3). Par extension, toute image composée de
pixels est appelée bitmap. C’est le cas des images réalisées avec Adobe Photoshop
ainsi que toutes celles possédant, par exemple, l’extension .jpg, .bmp, .png, .gif, .tif...
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
Fig. 3 : l’affichage des pixels
Codage couleur des pixels
Si à l’origine chaque pixel était codé sur un bit, les besoins d’affichage en couleur ont amené les informaticiens à le coder sur un ou plusieurs octets.
Rappelons qu’un octet se compose de 8 bits permettant de coder 256 valeurs
différentes allant de 0 à 255. Si l’on associe ces valeurs à des couleurs prédéfinies
dans une palette (pour le Web, par exemple), on peut afficher un pixel en couleur
(fig. 4a) ou bien en gris si la palette correspondante se compose de différents gris
ou niveaux de gris (fig. 4b).
1 0 0 1 0 0 1 1
1 0 0 1 0 0 1 1
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
147
Palette de 256 couleurs
(Web)
Fig. 4a : palette couleur
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
147
au niveau de gris n° 147
Fig. 4b : palette de gris
25
chap 2.indd 25
6/08/07 10:23:58
0 0 1 1 1 1 0 1
0 1 1 0 0 0 0 0
Cyan = 61
Rouge = 96
0 0 0 0 0 0 1 1
1 0 1 0 0 0 1 0
Magenta = 3
Vert = 162
0 1 1 0 0 0 1 0
0 1 0 0 0 0 0 0
Jaune = 98
Bleu = 64
0 0 0 0 1 0 1 0
Noir = 10
Fig. 5a : codage en RVB
Fig. 5b : codage en CMJN
Un codage sur 2 octets permet d’accéder à environ 65 000 couleurs (affichage
en milliers de couleurs). Un codage sur 3 octets, soit 24 bits, autorise une palette
de près de 16 millions de couleurs par le biais des couleurs rouge, verte et bleue
à la base même de la colorimétrie (fig. 5a). Chacune de ces couleurs sera codée
sur un octet : 1 pour le rouge, 1 pour le vert et 1 pour le bleu (RVB ou RGB).
Un codage sur quatre octets permet de travailler en CMJN, chaque couleur étant
codée, également, sur un octet (fig. 5b). Cet affichage des pixels en fonction du
nombre de bits est appelé « profondeur d’écran » (fig. 6).
Codage noir et blanc
sur 1 bit
Codage en 256 couleurs
sur 1 octet
26
chap 2.indd 26
Codage en 256 niveaux de gris
sur 1 octet
Codage en RVB
sur 3 octets
Fig. 6 : profondeurs d’écran
6/08/07 10:23:59
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Résolution et définition d’un bitmap
Ces deux termes sont parfois confondus bien qu’ils aient des sens très différents.
La définition exprime les dimensions d’une image, c’est-à-dire sa largeur et
sa hauteur définies en pixels (fig. 7).
Fig. 7 :
définition
La résolution indique, quant à elle, le nombre de pixels existant sur une
distance de 1 pouce de cette image (fig. 8). Elle est exprimée en dot per inch (dpi)
en anglais ou point par pouce (ppp) en français. La taille d’un bitmap peut varier
en fonction du périphérique auquel il est destiné : 72 dpi pour un écran, 600 dpi
pour une imprimante laser, 1 270 ou 2 540 dpi pour une flasheuse. La figure 9
montre le même bitmap imprimé dans deux résolutions différentes. Sur le dessin
de droite, il est deux fois plus petit puisque chaque point le constituant est deux
fois plus petit que sur l’illustration de gauche.
Fig. 8 :
résolution
Fig. 9 : un même nombre
de pixels pour un
même bitmap, dans des
résolutions différentes
Calcul du poids d’un bitmap
Le poids d’une image représente la quantité de mémoire utilisée par cette
image sur un support informatique, donc le nombre d’octets constituant cette
image, exprimé en Ko, Mo ou Go.
Il est important d’en avoir une idée précise pour des raisons de productivité
évidente : les disques durs seront moins encombrés, les serveurs moins surchargés,
les transferts sur réseau et les manipulations à l’écran plus rapides, les temps de
flashage plus courts...
Même si dans la vie professionnelle quotidienne on calcule très rarement le
poids d’un fichier bitmap, savoir déterminer le poids d’une image permet de
mieux appréhender la structure d’un fichier bitmap.
27
chap 2.indd 27
6/08/07 10:23:59
100
pixels
Premier exemple : considérons une image de 100 pixels par 100 pixels codée
sur 1 bit (fig. 10). Son poids est simple à calculer.
Nous avons, pour constituer ce bitmap : 100 × 100 = 10 000 pixels.
100 pixels
Chaque pixel est codé sur 1 bit, ce qui fait : 10 000 × 1 = 10 000 bits.
Fig. 10 : Bitmap codé
sur 1 bit
1 octet fait 8 bits. Il suffit de diviser par 8 soit : 10 000 ÷ 8 = 1 250 octets (soit
1,25 kilo-octets ou 1,22 kibi-octets).
Deuxième exemple : soit une image de 25,4 × 12,7 cm, codée en niveaux de
gris, donc sur 1 octet, avec une résolution de 100 dpi (100 pixels par pouce).
Comme la résolution est exprimée en pouce (dpi), il faut ramener les dimensions de l’image en pouce. Il suffit de diviser par 2,54 (1 pouce = 2,54 cm), soit
dans notre exemple :
25,4 ÷ 2,54 = 10 pouces pour la largeur et 12,7 ÷ 2,54 = 5 pouces pour la hauteur.
On sait qu’il y a 100 pixels sur un pouce (résolution = 100 dpi), nous avons :
10 × 100 = 1 000 pixels sur la largeur et 5 × 100 = 500 pixels sur la hauteur.
Soit un total de 1 000 × 500 = 500 000 pixels pour constituer l’image.
Chaque pixel étant codé sur 1 octet cela fait : 500 000 × 1 = 500 000 octets,
soit : 500 000 ÷ 1 024 = 488,28 kio ou 488,28 ÷ 1 024 = 0,47 Mio (ou 0,5 Mo).
Si le bitmap avait été codé sur 3 octets (RVB), il aurait suffit de multiplier par
3 le nombre de pixels obtenu ci-avant, soit :
500 000 × 3 = 1 500 000 octets ou 1 500 000 ÷ 1024 = 1464,84 kio ou
1464,84 ÷ 1 024 = 1,43 Mio (ou 1,5 Ko). Pour une image en CMJN nous
aurions multiplié par 4.
On peut en déduire une formule :
En pouce
En dpi
En nb. d'octets :
2
Poids = largeur x hauteur x résolution x profondeur d'écran
1 000 ou 1 024
En kilo-octet, Mo, Go, ... (si l'on divise par 1 000)
En kibi-octets, Mio, Gio, ... (si l'on divise par 1 024)
0,125 pour du bitmap
1 pour du niveau de gris
1 pour 256 couleurs
2 pour 65 000 couleurs
3 pour du RVB
4 pour du CMJN
Diviser par 1 000 ou 1 024 autant de fois que nécessaire pour obtenir
au maximum 3 chiffres significatifs avant la virgule
(ex : 12,39 Mo et non pas 12 395,2 Ko)
28
chap 2.indd 28
6/08/07 10:23:59
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Un bitmap supporte très mal les changements d’échelle. S’il fait 4 pixels par
4 pixels, le doubler de taille augmente d’autant son nombre de pixels. Il va donc
manquer des pixels pour le définir (fig. 11a). La première solution consiste donc à
doubler la taille des pixels, ce qui rend le bitmap « grossier » (fig. 11b). On appelle
cela la « pixellisation ». L’idéal serait de garder la même grosseur de pixel et d’inventer des pixels intermédiaires (fig. 11c). Il s’agit du rééchantillonnage. Plusieurs
algorithmes sont disponibles et suivant leur capacité, ils prennent plus ou moins
en compte leur environnement. Cependant, le rééchantillonnage a ses limites :
toutes les images ne le supportent pas et peuvent alors devenir floues (fig. 12).
Pixels
manquants
Fig. 11a : pas assez
de pixels
Fig. 11b : pixellisation
Fig. 11c : rééchantillonnage
Image de départ
(72 dpi)
Image agrandie 2 fois sans
rééchantillonnage
d’où une pixellisation
Image agrandie 2 fois avec
rééchantillonnage à 300 dpi
Fig. 12 : même image avec et sans rééchantillonnage
29
chap 2.indd 29
6/08/07 10:24:00
Fichiers vectoriels
Les fichiers bitmap sont gourmands en mémoire. La figure 13 représente une
image en bitmap. Il s’agit d’un simple trait. Cependant, pour le définir, il faut l’inclure dans un carré de 100 pixels par 100 pixels, le trait étant représenté par des
points noirs, tous les autres pixels par des points blancs. Ces points blancs existent
bel et bien et sont codés de la même manière que les points noirs (sur 1 bit, 1, 2,
3 ou 4 octets) et utilisent donc autant de mémoire qu’eux. Pour définir ce simple
trait, il faut coder 100 × 100 = 10 000 pixels et donc au moins autant d’informations.
0
100
0
0
100
100
0
100
Fig. 13 : bitmap de 100 pixels par 100 pixels
L’idée du vectoriel est de diminuer le nombre d’informations pour définir un
graphisme en indiquant uniquement des coordonnées et le type de graphisme.
Par exemple, en vectoriel, le trait de la figure 13 serait défini par ses coordonnées
(0,0), (100,100) et l’instruction « ligne ». Cela fait 5 informations contre 10 000
dans le cas d’un bitmap. Les fichiers s’en trouvent nettement réduits et il suffit
d’avoir un interpréteur, c’est-à-dire un logiciel capable d’analyser les informations
vectorielles et de les transformer en informations bitmap pour l’affichage sur écran
(fig. 14). Rappelons que l’affichage à l’écran est forcément bitmap puisque l’écran
est une matrice de pixels.
Travailler en vectoriel présente le très gros avantage de pouvoir adapter la
résolution aux périphériques de sortie (écran, imprimante, flasheuse, CTP).
La figure 9 de la page 27 montre que la taille d’affichage (ou d’impression) varie
en fonction de la résolution, c’est-à-dire en fonction de la grosseur des pixels que
restitue un périphérique. Cela veut dire que les formats des documents réalisés sur
ordinateur seraient différents s’ils étaient imprimés sur imprimante jet d’encre à
600 dpi ou sur une flasheuse à 2 500 dpi par exemple.
30
chap 2.indd 30
6/08/07 10:24:01
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Écran
Carte vidéo
Interpréteur
Fichier vectoriel
Bitmap
(0,0)
(100,
10
Ligne 0)
Fig. 14 : du vectoriel au bitmap
Instructions vectorielles
Les instructions vectorielles manipulent une page globalement et placent les
éléments constituant cette page dans un système de coordonnées. L’exemple de la
figure 15 montre qu’une même ligne sera imprimée dans les mêmes dimensions et
positionnée au même endroit sur une feuille de papier quelle que soit la résolution
de l’imprimante. L’interpréteur calcule le nombre de pixels correspondant à une
dimension. Par exemple, la coordonnée « x » du point « P » sera positionnée sur
le pixel n° 590 pour une résolution de 300 dpi et sur le pixel n° 1 180 pour une
résolution de 600 dpi, mais sera située à 50 mm du bord de la feuille dans les deux
cas. Cette nature mathématique autorise toutes les manipulations, notamment les
agrandissements. Un simple coefficient permet de recalculer les coordonnées d’un
objet graphique et de redéfinir les pixels qui le composent. A contrario, un bitmap
ne subit pas d’agrandissement sans pixellisation.
148,5 mm ou 1 754 pixels
148,5 mm ou 3 508 pixels
0
0
x
0
x
0
P x = 50 mm ou 1 180 pixels
210 mm ou 4 960 pixels
210 mm ou 2 480 pixels
P x = 50 mm ou 590 pixels
y = 60 mm
ou
708 pixels
y = 60 mm
ou
1 416 pixels
P'x' = 100 mm
P'x' = 100 mm
y' = 180 mm
y' = 180 mm
y
y
300 dpi
600 dpi
Fig. 15 : coordonnées globales et coordonnées en pixels
chap 2.indd 31
31
6/08/07 10:24:01
Le PostScript
+
+
+
+
Le PostScript est devenu un standard dans les industries graphiques et peut
s’importer dans grand nombre de logiciels de PAO. Il a été inventé par la société
américaine Adobe Systems Inc, et c’est un langage de programmation au même
titre que d’autres langages informatiques tels que le Basic, le C ou le Pascal. Son
rôle est avant tout de contrôler l’ensemble d’une page imprimée en terme de
qualité indépendamment de la résolution de sortie des périphériques d’impression. C’est donc un langage de description de page manipulant des objets graphiques de base comme les droites ou les courbes de Bézier (fig. 16), permettant
de construire toute autre forme géométrique : rectangles, cercles, polices de caractères, etc. (fig. 17).
P2
P2
P3
Fig. 17 : objets
graphiques définis par
des courbes de Bézier
P4
P1
P1
P4
P3
Fig. 16 : courbes de Bézier
À l’instar de monsieur Jourdain qui faisait de la prose sans le savoir, l’opérateur PAO programme en PostScript à travers son écran. Lorsqu’il dessine dans
Illustrator, par exemple, le logiciel transforme les manipulations effectuées en
instructions PostScript compréhensibles par n’importe quelle imprimante
PostScript (fig. 18). Heureusement, car PostScript est un langage difficile demandant de solides connaissances en programmation.
Les courbes de Bézier
Inventées par un ingénieur français travaillant sur les flux aérodynamiques
chez un grand constructeur automobile, les courbes de Bézier sont devenues
célèbres grâce à PostScript. Elles permettent de dessiner n’importe quelle courbe
avec très peu d’informations, ce qui colle parfaitement à la philosophie de
PostScript. En effet, seuls quatre points sont nécessaires quelle que soit la forme
de la courbe.
32
chap 2.indd 32
6/08/07 10:24:02
LES FICHIERS INFORMATIQUES
%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: Adobe Illustrator(TM)
%%Title: (Exemple de page)
%%BoundingBox: 33 51 202 282
Impression
M
o
103
153
204
103
0.5
om
32 51 moveto
77 51 lineto
115 moveto
66 lineto
115 lineto
115 lineto
setgray
96 157 moveto
132 196 curveto
96 231 curveto
59 194 curveto
96 158 curveto
Momo
70 283 moveto
/Times-Bold findfont
(Momo) show
Interpréteur
Showpage
%%end
Document réalisé à l'écran
Fichier PostScript généré
(texte)
Fig. 18 : du dessin aux
instructions PostScript
Le format d’enregistrement du PostScript est l’EPS (de son vrai nom EPSF,
Encapsulated PostScript File). Un fichier EPS est constitué de quatre grandes
parties (fig. 19).
La première comprend l’en-tête où figurent tous les commentaires concernant
le document comme le nom du fichier, la version du logiciel qui
l’a créé, l’encombrement total de l’impression (bounding box), les
couleurs utilisées, etc. (fig. 20). Elles sont récupérées par des logiciels dédiés au traitement des documents. Puis viennent toutes les
instructions, méthodes, procédures et fonctions nécessaires pour
dessiner la page.
%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: Adobe Illustrator(TM)
%%Title: (Exemple de page)
%%BoundingBox: 33 51 202 282
32 51 moveto
77 51 lineto
103
153
204
103
0.5
115 moveto
66 lineto
115 lineto
115 lineto
setgray
96 157 moveto
132 196 curveto
96 231 curveto
59 194 curveto
96 158 curveto
70 283 moveto
/Times-Bold findfont
(Momo) show
Showpage
%%end
Fig. 19 : structure
d’un fichier EPS
La fin de fichier regroupe des informations utiles à l’interpréteur du périphérique. L’en-tête et la fin du fichier sont communs
à tous les fichiers PostScript alors que le corps est totalement différent d’un fichier à l’autre, en fonction des éléments à imprimer.
La dernière partie comprend la visualisation en bitmap du
document à imprimer. On peut considérer cette visualisation
comme une photo de la page. C’est cette image bitmap qui est
en fait importée par les autres logiciels. Elle peut être considérée
comme la basse résolution du fichier EPS (ne pas confondre avec
la vignette qui est l’icône du fichier visible dans les fenêtres du
bureau). Cette visualisation peut être enregistrée sous différents
formats et profondeurs d’écran. Un enregistrement en 1 bit
fournira un aperçu en noir et blanc même si le document est en
couleur. Cependant, cela n’altèrera en rien le fichier PostScript
qui, de toutes façons, restituera les couleurs au moment de l’impression (fig. 21).
33
chap 2.indd 33
6/08/07 10:24:02
Version de Postscript
Logiciel qui a créé le fichier
%!PS
%%Cr Adobe3
e
%%AI ator: .0
Adob
8_Cr
e
%%Fo
e
r: ( atorVe Illust
rsio
%%Ti
rato
Pasc
n
t
r
%%Cr le: (R al Prév : 10.0 (R) 8.
ecta
0
ô
eati
ngle t) (Ed
%%Bo
onDa
ucat
.
u
ion
%%Hi ndingB te: 14/ ai)
ox:
nati
03/0
ResB
47 6
%%Do
onal
7 23
ound
5
c
e)
:10
%%Do umentP ingBox: 4 287
79
r
c
%%+ umentS ocessCo 47.635 6
7 65
uppl
lors
proc
4.15
iedR
%%+
: Bl
set
53 2
e
p
a
%%+ rocset AGM_Gra source ck
86.4
s: p
d
p
385
rocs
%%+ rocset Adobe_C ient 1
795.
.
et A
o
proc
0
A
4268
%%+
dobe
set dobe_I lorImag 0
l
p
_lev
e
%%+ rocset Adobe_p lustra _AI6 1
el2_
t
.
a
proc
o
A
AI5
3
t
r
d
tern
_AI5
obe_
0
%AI5
set
1.2
_
c
A
1
s
_
I
0
%AI3 FileFo Adobe_s how 2. 5 1.0 .3 0
0
r
0
h
_
%AI7 ColorU mat 4.0 ading_ 8
AI8
sage
_Ima
1.0
: Co
%%CM
geSe
0
l
Y
%%AI KProce ttings: or
s
6
%%+ _Color sColor: 0
S
P
%AI3 PD: 1 eparati 1 1 1
1 ([
2
o
_
R
%AI3 Templa 1 0 0 6 nSet:
1 1 ep\216
t
0
_
r
(
%AI3 TileBo eBox: 2 45 2
2 1 AI6 De age])
x: 1
98.5
_Doc
fa
0
1
%AI5
u
_Art mentPr 14 583 420.38 0 1 0 ult Col
96 2
evie
%AI5
0
Size
8
3
2
98.5 0 0 0 or Sepa
w
_
%AI5 RulerU : 595.2 : None
ra
0
420.
n
7
_
3896 0 0 -1 tion Se
%AI5 ArtFla its: 1 56 841
t)
-1 (
.889
gs:
_Tar
)
8
0 0
%AI5
getR
0
_
%AI8 NumLay esoluti 1 0 0
ers:
on:
_Ope
1 0
%AI5
800
nToV
0
1
_
%%Pa OpenVi iew: -3
e
2
g
%%AI eOrigi wLayers 0 856.
8896
n:11
: 7
3_Pa
%%AI
perR
0.81
14
3
1006
%%Cr _Margi ect:-11
719
n
e
26 0
%%Co ationD :11 -14 832 58
4
a
p
1 11
user yright te: (04 -12 10 -10
42 0
: ((
/10/
dict
0
93)
put
/Ado C) 19
()
87-1
be_l
/pac
9
evel
96 A
keda
2
d
_
obe
AI5
{
rray
S
2
y
6 di
s
wher
ct d tems I
user
e no
nc
up b
d
t
/pac ict be
egin orpora
gi
ted
keda
{
All
rray n
Righ
ts R
arra
eser
} bi y asto
ved)
r
n
/set d def e reado
nly
pack
/cur
ing
r
end entpac /pop lo
king
ad
0
fals def
e de
} if
f
pop
user
dict
/ini
tial /defau
ltpa
{
ize
ckin
g cu
Adob
rren
} bi e_leve
tpac
l2_A
nd d
king
I5 b
/ter
e
put
egin
mina f
true
{
te
setp
acki
curr
ng
entd
{
ict
Adob
e_le
end
v
el2_
} if
AI5
eq
} bi
%%En nd def
dDat
%%En
a
dCom
%%Be
m
ginP ents
rolo
g
Nom du document
Encombrement de l'impression
Couleurs utilisées
Instructions PostScript
Fig. 20 : exemple
de fichier PostScript
Un des autres avantages de PostScript est sa capacité à être transférable sur
tous les systèmes d’exploitation. Cela s’explique tout simplement par le fait qu’un
fichier PostScript est, en fait, du texte codé sur les 128 premiers caractères du code
ASCII, ce qui évite tous les caractères spéciaux et accentués et rien n’est plus facile
pour un ordinateur que de lire un fichier texte.
PostScript s’est donc vite imposé dans le processus de publication. Cependant,
il a rapidement trouvé ses limites. Hormis le fait qu’il génère des fichiers volumineux, il n’enregistre pas les polices de caractères mais juste leurs attributs : nom,
graisse, corps, etc. Si un fichier PS est envoyé à un intervenant tiers pour être
exploité (sortie de films sur flasheuse notammment), la police utilisée risque de
n’être pas exactement la même. Un « Garamont de Monotype » n’est pas construit
identiquement à celui d’Adobe ou d’ITC, par exemple, et que dire des polices,
installées sur des systèmes d’exploitation divers ? Le transfert d’un document Mac
vers un PC (ou inversement) pose de gros problèmes, notamment de chasse et il
est peu probable de retrouver la mise en page originelle.
34
chap 2.indd 34
7/08/07 15:23:56
LES FICHIERS INFORMATIQUES
%!PS-Adobe-3.0
%%Creator: Adobe Illustrator(TM)
%%Title: (Exemple de page)
%%BoundingBox: 33 51 202 282
Impression de
l'illustration à importer
32 51 moveto
77 51 lineto
115 moveto
66 lineto
115 lineto
115 lineto
setgray
Ol
ebo
d
ess
in
96 157 moveto
132 196 curveto
96 231 curveto
59 194 curveto
96 158 curveto
!
Olebodessin !
103
153
204
103
0.5
Bla bla blabla
bla bla bla bla
bla bla blabla
bla bla bla bla
bla bla blabla
bla bla bla bla
bla bla blabla
bla bla bla bla
70 283 moveto
/Times-Bold findfont
(Momo) show
Showpage
%%end
Bla bla blabla bla bla bla bla
bla bla blabla bla bla bla bla
Olebodessin !
Mise en page
Fichier PostScript
de l'illustration à importer
Olebodessin !
Fig. 21 : même une figure avec
un aperçu noir et blanc sera
imprimée en couleurs
Création et enregistrement
de l'illustration à importer
Le saviez-vous ?
L’inventeur du PostScript, qui est aussi le créateur de l’entreprise Adobe
Systems Inc, s’appelle John Warnock. Titulaire d’une maîtrise en mathématiques et d’un doctorat en informatique, il commence ses travaux d’association de
visualisation-écran et de mémoire d’écran au début des années 1970. Il rejoint
ensuite le PARC (Palo Alto Research Center) de Xerox Corporation (où furent
inventées la souris et l’interface graphique) et développe, en 1978 avec Martin
Newell, un premier langage de description de page appelé JAM. Ce langage
donne naissance à Interpress mais celui ci n’arrive pas à s’imposer. En 1982, il
développe le langage PostScript, avec Charles Geshchke.
PostScript obtient ses lettres de noblesse dans les arts graphiques grâce à la
sortie en 1984 du premier Macintosh et de l’imprimante Apple LaserWriter.
35
chap 2.indd 35
6/08/07 10:24:02
Le PDF
Le PDF est une évolution de PostScript. Il a été créé pour pallier les imperfections de ce dernier. Bien souvent un document s’imprime difficilement en raison
d’erreurs PostScript. Cela est dû au fait que les interpréteurs PostScript ne « parlent » pas forcément tous exactement le même langage PostScript. Les constructeurs de périphériques de sortie ou les éditeurs de logiciels implantent dans leurs
produits leur propre interpréteur et donc le programment différemment (le
PostScript est un langage de programmation !). Pour simplifier, on peut parler de
« dialecte PostScript » et la restitution d’un rectangle, par exemple, ne s’exprimera
pas exactement de la même manière d’un constructeur à l’autre, même s’ils parlent
tous les deux d’un rectangle.
PS
Interpréteur X
Interpréteur Y
Fig. 22 : problème de communication en PostScript
Cela veut dire que si les instructions du dialecte PostScript n° 1 sont envoyées
à l’interpréteur qui parle le dialecte PostScript n° 2, il peut y avoir des problèmes de communication et le rectangle demandé risque ne plus être tout à fait un
rectangle. En réalité, cela ne peut pas se passer avec un motif géométrique aussi
simple qu’un rectangle mais s’il s’agit d’un document complexe avec des dégradés,
beaucoup de polices de caractères ou des tracés compliqués, la probabilité de ne
pas se retrouver avec le résultat attendu est grande (fig. 22). D’où l’importance de
travailler avec des interpréteurs de même marque lorsque cela est possible, ou bien
avec un seul et unique interpréteur pour tous les périphériques de sortie. Cela
évite de se retrouver avec des milliers d’exemplaires en sortie de presse offset différents du bon à tirer que le client a signé et validé.
Le PDF contourne ce problème en indiquant seulement des ordres généraux,
des « objets graphiques ». En fait, un rectangle (pour reprendre notre exemple)
sera codé « rectangle » et peu importe la manière dont un interpréteur le restituera
puisqu’on lui demandera juste de réaliser un rectangle. Qu’il le fasse avec le dialecte PostScript X ou le dialecte PostScript Y, il fera un rectangle. C’est simple et
efficace et cela préserve la mise en page (polices, illustrations, graphiques...) telle
36
chap 2.indd 36
6/08/07 10:24:04
LES FICHIERS INFORMATIQUES
que souhaitée par l’opérateur PAO. Comme PostScript, le codage d’un fichier
PDF se fait en ASCII. En partant de ce constat, le PDF devient un format de
fichier ultra-portable, c’est-à-dire capable d’être lu avec certitude sur tous les systèmes d’exploitation de n’importe quel ordinateur au monde. D’ailleurs PDF veut
dire : Portable Document Format (format de document portable). Adobe qui l’a
créé a très bien compris l’intérêt d’un tel type de fichier et a fourni gratuitement
à la planète entière un logiciel permettant de lire un document PDF sur tous les
ordinateurs (Mac, PC, Linux) : Acrobat Reader. Cette ouverture a fait le succès du
PDF et son utilisation s’est très largement répandue dans de nombreux domaines
de l’informatique (bureautique, organiseurs numériques personnels, téléphones
portables, etc.).
Les fichiers PDF peuvent comporter des photos (bitmap), être paramétrables,
sécurisés et interactifs. On peut même y rechercher de l’information facilement.
Ils sont donc optimisables pour leur utilisation finale (fig. 23).
Un document PDF concernant un manuel d’utilisation en ligne pourra comporter des signets, ainsi que des hyperliens pour y naviguer facilement de page
en page. Un document destiné à
l’affichage à l’écran pourra, lui,
ne comporter que des images
à 72 dpi (c’est souvent le cas des
bons à tirer envoyés par e-mail).
Un document destiné à l’impression sera paramétré avec des images en haute résolution et comprendra les traits de coupe, les
repères de montage, les gammes,
etc. Des styles pré-programmés
(ebook, écran, impression, presse,
styles personnalisés, fichiers légers,
etc.) sont disponibles dans beaucoup d’applications destinées à la
production de produits imprimés.
Fig. 23 : styles PDF
La sécurité d’accès aux documents n’est pas oubliée. On peut adjoindre à un
fichier PDF un mot de passe pour autoriser son ouverture et/ou sa modification,
en interdire son impression ou en extraire des éléments (schéma, texte, etc.). Des
standardisations du PDF comme le PDF-X, le PDF-A, etc., augmentent encore la
sécurité et la fiabilité des fichiers destinés à l’impression.
37
chap 2.indd 37
6/08/07 10:24:05
Les polices numériques
Petit corps
agrandi
Petit
corps
Grand
corps
Fig. 24 : le dessin d’une
lettre change en fonction
de son corps
Les bons vieux caractères en plomb de l’imprimerie ont été avantageusement
remplacés par les polices de caractères numériques. Une police est l’ensemble des
déclinaisons d’un type de caractère d’imprimerie (romain, gras, italique, gras-italique, condensé, etc.). Les polices de caractères sont conçues par des spécialistes. La
déclinaison en italique d’une lettre n’est pas seulement sa déformation penchée,
tout comme son changement de corps (taille) n’est pas une simple réduction. Le
dessin d’une lettre va donc changer en fonction de sa déclinaison ou de sa taille.
Les graveurs et fabricants de caractères en plomb (les fondeurs) prenaient en
compte ces variations pour pallier les impératifs techniques de l’impression, pour
éviter des phénomènes de bouchage dans les contre-poinçons des caractères de
petits corps par exemple (fig. 24). Un professionnel des industries graphiques se
doit donc d’utiliser les polices à bon escient : ne pas pencher ses caractères pour en
faire de l’italique, ne pas utiliser la fonction « gras » d’un logiciel de mise en page
pour les caractères gras, ne pas étroitiser (réduction horizontale) pour les caractères
« condensés », entre autres (fig. 25).
La nature même d’un caractère numérique pose des problèmes de reproduc-
Déclinaisons normales
Times roman
Times roman
italique
Times gras
Times gras-italique
Times roman
penché
Times roman
graissé
Times roman
graissé et penché
Helvetica
régular
Helvetica gras
condensé
Déclinaisons "trafiquées"
Helvetica gras
étroitisé
Fig. 25 : déclinaison des caractères
tion. Ce caractère doit être restitué le plus fidèlement possible, c’est-à-dire reconstitué avec des pixels. Il faut pouvoir adapter le dessin du caractère à la résolution
du périphérique de sortie. C’est particulièrement vrai pour les petits corps et les
caractères présentant des zones très fines. Par exemple, si une partie du caractère
est définie à 2,5 pixels de large, le périphérique de sortie ne sera pas en mesure de
l’afficher. En effet, 2,5 pixels deviendront 2 ou 3 pixels. Pour de basses résolutions,
cela peut avoir une incidence visuelle déplorable. Des algorithmes, appelés hints et
incorporés au fichier de la police numérique optimisent ces problèmes.
38
chap 2.indd 38
6/08/07 10:24:06
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Les formats de fichier des polices de caractères
Il existe 3 grands types de formats couramment utilisés en industries graphiques : les polices PostScript type 1, les polices True Type et les polices Open Type
(ou unicode).
Fig. 26a : sans
antialiasing
PostScript type 1
Ce sont les plus anciennes, mais aussi les plus fiables qui hantent nos ordinateurs. Elles ont été développées par l’inventeur même de PostScript : Adobe.
Leur particularité est d’être « constituées » de deux fichiers distincts : un fichier
bitmap pour l’affichage à l’écran (dans les corps 8, 10, 12, 18, 24) et un fichier
vectoriel pour l’impression. L’ensemble est regroupé dans des « valises » (suitcases
en anglais), c’est-à-dire un type de dossier très particulier et reconnaissable par le
système d’exploitation (fig. 27). Si l’agrandissement des caractères à l’impression
ne pose aucun problème du fait de leur nature vectorielle, l’affichage à l’écran des
bitmaps crée une pixellisation. Ce problème est contourné grâce à des logiciels
du type ATM intégrés dans le système, comme dans Mac OS X par exemple. Ces
logiciels utilisent une technique appelée « antialiasing » qui lisse les contours des
caractères en utilisant des niveaux de gris (fig. 26b). Les polices PostScript Type 1
sont généralement développées par les créateurs de logiciels. Elles sont fiables, sans
surprise et vivement conseillées pour un usage professionnel.
Fig. 26b : avec
antialiasing
Mac OS 9
Fichier
vectoriel
Fichier
bitmap
Mac OS 10
Valise
Fichiers vectoriels
et bitmap
+
Times
Valise
Fichier
vectoriel
+
Times
+
Times bold
Windows
Fichier
bitmap
+
LWFN
LWFN
Times
Times bold
.lwfn
.lwfn
FFIL
.ffil
.pfm
.pfb
Times
Times bold
Fig. 27 : icônes des fichiers de polices PostScript type 1
39
chap 2.indd 39
6/08/07 10:24:06
Police True Type
Elles ont été développées par Apple et Microsoft. Chacune de ces polices est
constituée d’un seul fichier vectoriel. Il sert autant à l’affichage à l’écran qu’à l’impression. Le seul véritable inconvénient est que ce type de police de caractères n’est
pas toujours totalement compatible avec les interpréteurs PostScript. Certains
caractères n’apparaissent pas ou bien sont remplacés par un petit rectangle blanc
bordé de noir. C’est bien évidemment du plus mauvais effet dans un document
professionnel. Attention, ces polices peuvent être restituées correctement sur une
imprimante laser ou jet d’encre mais pas lors de l’opération de flashage des films
ou des plaques sur CTP. Leur usage est déconseillé en industries graphiques, à
moins d’être certain de leur bon fonctionnement. Si vous travaillez avec des partenaires de la chaîne graphique, demandez-leur si leurs interpréteurs (les RIP)
savent « digérer » les polices True Type. Si vous n’êtes pas sûr que cela soit le cas,
vectorisez vos caractères. La vectorisation, consiste en la transformation en tracés
vectoriels purs et durs. Vos caractères ne réagissent plus comme du texte éditable
et transformable (texte actif ), mais deviennent de simples dessins et il n’est plus
possible de modifier le texte.
Mac OS 9
Fichier
vectoriel
Mac OS 10
Fichier
vectoriel
Fichier
vectoriel
TTF
DFONT
.ttf
.dfont
Fig. 28 : icônes des fichiers de polices True Type
Fig. 29 : ligature
des 3 lettres f, f et i
Windows
Fichier
vectoriel
.ttf
Polices Open Type
La tendance à la compatibilité totale entre systèmes d’exploitation a poussé
Adobe et Microsoft à développer un format de polices de caractères universel.
Comme True Type, ce format n’utilise qu’un seul type de fichiers pour l’affichage à l’écran comme pour l’impression. En fait, un même fichier regroupe à
la fois les polices vectorielles et bitmap ou True Type, autant pour Mac OS et
Windows, dans leurs différentes déclinaisons, ainsi que leurs définitions métriques. Contrairement aux autres formats cités plus avant, chaque caractère est codé
sur deux octets. Cela autorise un jeu d’environ 65 000 caractères contre 256.
Les polices Open Type (pour les plus sophistiquées) peuvent posséder toutes les
variantes de caractères, comme les ligatures (groupe de lettres reliées entre elles,
fig. 29), lettres ornées, les vraies petites capitales, les fractions, etc., ainsi que tous
40
chap 2.indd 40
6/08/07 10:24:10
LES FICHIERS INFORMATIQUES
Windows
Mac OS 10
OTF
.otf
les signes et caractères des langues étrangères, même non latines (arabe, cyrillique,
grec…). Elles sont bien sûr utilisables sans conversion sur tous les systèmes d’exploitation et évitent les problèmes d’incompatibilité (un document sur Macintosh
sera restitué sans problème sur un PC et inversement).
.otf
Fig. 30 : icônes des
polices Open Type
Macintosh
Fichier
vectoriel
Fichier
bitmap
Windows
Fichier
vectoriel
Fichier
bitmap
Fichier
vectoriel
Fichier
bitmap
Fichier
vectoriel
Fichier
bitmap
Times cyrillic
Times
Times
Times cyrillic
Times grec
Times grec bold
Times grec
Times grec bold
OU
OTF
Times.otf
Fig. 31 : exemple de contenu
d’une police
Times.otf
Gestion des polices
Il est nécessaire de faire un tri très sélectif des polices que l’on possède sur son
système informatique et une typothèque (l’ensemble des polices dont dispose un
utilisateur) doit être parfaitement gérée tant en termes de qualité que de quantité. Certaines polices de caractères sont de bien meilleure qualité que d’autres.
Les polices téléchargées gratuitement sur Internet doivent être bannies d’une
typothèque professionnelle. En effet, ces polices ne contiennent pas forcément
de hints et donc ne sont pas optimisées (c’est long et coûteux à développer et cela
nécessite beaucoup de moyens), elles ne possèdent pas forcément tous les caractères, notamment ceux accentués. Elles peuvent également poser de gros problèmes
à l’impression.
Un nombre important de polices nuit à la créativité. En effet, quelle police
choisir pour illustrer le message à faire passer quand le choix est trop important ?
Les chances de se tromper sont grandes et l’on risque de privilégier ses propres
41
chap 2.indd 41
6/08/07 10:24:12
goûts artistiques au détriment de l’efficacité. Il vaut mieux se contenter de quelques polices que l’on maîtrise bien (au sens artistique).
La multiplicité des polices est source de ralentissement de la machine. Il faut
savoir que les polices sont chargées en mémoire vive lors du démarrage de l’ordinateur. Donc, plus il y en a et plus ça « rame ». Les logiciels dédiés (comme Suitcase,
livre des polices, etc.) permettent d’activer seulement les polices utilisées pour un
travail bien précis. De plus, ils permettent une gestion plus efficace : suppression
des doublons, suppression sans risque des polices inutiles, installation automatique dans les bons dossiers du système d’exploitation, visualisation des caractères,
classement par thèmes, production d’un catalogue des polices disponibles, etc.
Attention cependant de ne pas supprimer « les polices système » de votre ordinateur. Ces polices sont absolument nécessaires au bon fonctionnement de votre
machine car utilisées par le système d’exploitation (affichage du nom des fenêtres
par exemple).
Les polices numériques sont des fichiers informatiques et sont soumises aux
droits d’auteur. Il est formellement interdit de les dupliquer. Il est juste toléré de
joindre les polices d’un document que l’on a créé à un partenaire tiers (un flasheur
par exemple), pour qu’il puisse traiter le document dans de bonnes conditions.
Ces polices de même nom et de même dessin peuvent ne pas avoir les mêmes
caractéristiques informatiques (qualité d’affichage, chasse, format, etc.). Après
traitement du document, le partenaire tiers doit enlever les polices prêtées de son
système informatique.
Glyphes ou caractères ?
Ces deux notions sont souvent confondues. Un glyphe est la forme donnée à
un caractère. Par exemple, le « e » bas de casse et le « e » petite capitale forment
un même caractère : le « e », mais deux glyphes distincts. Un glyphe peut aussi
représenter plusieurs caractères comme les ligatures (ffi, œ, par exemple).
42
chap 2.indd 42
6/08/07 10:24:19
">
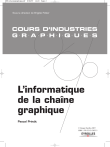
Enlace público actualizado
El enlace público a tu chat ha sido actualizado.



